A propos de L’Enseignement de la torture de Catherine Perret, paru au Seuil
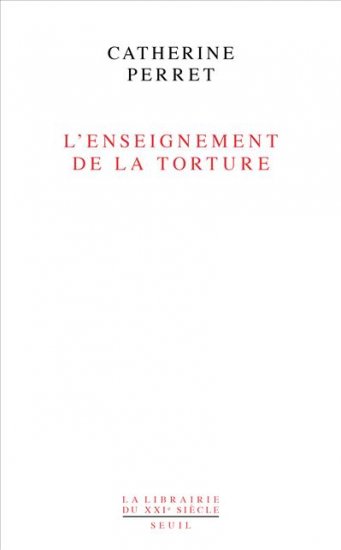
Catherine Perret ne pose pas ces concepts en philosophe qu’elle est assurément. Elle n’impose rien. Elle lit une Å“uvre, celle de Jean Améry. Elle suit avec attention les témoignages et la pensée de cet auteur et déplie les enjeux conceptuels qui s’y attachent.
Jean Améry est autrichien. Il est né en Autriche, il a grandi en Autriche, apprend en Autriche, fréquente le cercle de l’école de Vienne. Il est un intellectuel viennois tout simplement, ayant, comme sa famille d’ailleurs, oublié qu’il était juif. Sa mère est elle-même catholique d’origine juive. En 1943, alors qu’il est exilé en Belgique, il est arrêté par la Gestapo, torturé et envoyé à Auschwitz. Il survivra à la torture et aux camps d’extermination nazie. Après la guerre, il devient journaliste et écrivain. Il laisse après son suicide en 1978 une Å“uvre dense, exigeante et mal connue. Catherine Perret nous la restitue dans sa profondeur et sa complexité.
L’expérience déterminante que Catherine Perret met en avant à partir des livres de Jean Améry est celle de la torture. Elle est l’anéantissement qui précède l’autre, celui de l’entrée au camp. La politique d’écriture de Jean Améry est celle d’un corps branlant, suspendu au vide et à la douleur. Pendu à un crochet, suspendu dans le vide, le corps de Jean Améry cède :
« En ce qui me concerne, je dus abandonner très vite. C’est à ce moment que se produisit dans le haut de mon dos un craquement et une déchirure que mon corps à ce jour n’a pas encore oubliés. Je sentis mes épaules se déboîter. Le poids même du corps avait provoqué la luxation, je tombai dans le vide et tout mon corps pendait maintenant au bout de mes bras disloqués, étirés vers le haut par-derrière et retournés jusqu’à se retrouver par-dessus ma tête. Torture, du latin torquere, tordre : quelle leçon de choses par l’étymologie ! En même temps les coups assénés avec le nerf de bÅ“uf pleuvaient dru sur mon corps et nombre d’entre eux transpercèrent purement et simplement l’étoffe légère du pantalon d’été que je portais ce jour-là , le 23 juillet 1943.  » [2].
Le corps du torturé est l’enjeu premier, la question essentielle d’une relecture politique de la torture d’une part et de l’identité du torturé d’autre part. Le corps est le lieu du retournement et de la perte d’identité, perte d’identité de soi et perte d’identité sociale. Le retournement est politique. Il est même le geste politique de la torture.
« Retourner la peau, exhiber la chaire, faire disparaitre la distance entre nous qui est indissociable de l’écran sensible de la peau, c’est opérer une révolution culturelle dont l’ambition est de refaçonner l’ordre sensible, d’ « organiser  », comme on dit au camp, la sensibilité.  » [3]
Le livre de Catherine Perret opère un double mouvement. Elle se plonge d’abord au plus précis et au plus dense d’une destruction de la sensibilité comme régime d’organisation du camp d’extermination. Catherine Perret puise dans la phénoménologie et dans la psychanalyse les clés d’une appréhension de cette mécanique de dépossession d’humanité. C’est au travers des notion de chair, de cri et surtout de peau que Perret décrit cette « expérience d’un effondrement spirituel  » (L’enseignement de la torture, p. 161). Elle amplifie son analyse en proposant une discussion serrée autour des concept de Moi-Peau / Corps-Moi / Nous-Peau la peau étant la digue du sensible que la logique nazie fait immédiatement sauter : la peau comme espace de distance et d’inviolabilité qui fait confiance dans le monde [4] est profanée par le nazisme. Cette « hyperesthésie négative  » [5], ou « exercice négatif de la sensibilité  » est bien ce qui nie l’existence même et le sens du commun, l’inscription du sens de l’individu dans une communauté.
Catherine Perret nous le rappelle : « La sensation est ce que je reçois du monde ; elle fait de moi un objet du monde. Le sens communautaire est ce qui oriente la sensation  » [6]. Avant d’être désigné par Catherine Perret comme un enjeu de résistance, l’anéantissement du sensible est anéantissement de l’homme. C’est ce qu’elle décrit au début de l’essai avec l’arrivée de Jean Améry à Auschwitz. Elle souligne avec Améry « l’impact foudroyant que le camp eut sur ceux qui étaient supposés incarner la culture  » [7]. Il est d’abord privé de toute sensibilité, mais en plus sa structuration intellectuelle le rend incrédule et incapable de résistance. Catherine Perret souligne qu’Améry pointe quatre « principes de la non-résistance de l’esprit : la fonction heuristique du doute, l’amour des catégories, la culture esthétique et la sacralisation de la parole  » [8]. Le projet rationnel de production des morts exhibé par le nazisme, la mort comme protocole rompt tout processus intellectuel, tout rattachement anthropologique du sujet. La mécanique de déshumanisation comme principe d’anéantissement est une négation totale [9] qui ouvre une nouvelle logique : celle de l’extermination comme logique de la totalité (avec décompte... la logique de comptabilité étant une forme de la déshumanisation).
Il ne reste donc plus rien sinon le corps. C’est par le corps, c’est par le corps torturé, assigné à une sortie de l’humanité et voué à la mort que Jean Améry reconquiert une identité. Catherine Perret reprend alors les mots d’Améry : « J’avais compris qu’il y a des situations où le corps devient notre Moi tout entier et notre destin tout entier. J’étais mon corps et rien que cela. (...) J’étais Moi sous forme de coup, pour moi et pour l’adversaire.  » [10]
C’est ici que Catherine Perret développe l’enjeu central de l’ouvrage : reconfigurer une pensée politique de la torture sans éviter de discuter les enjeux et les impasses d’une pensée morale de la torture qui recouvre cette question politique. Il faut dire ici que Catherine Perret fait un travail délicat et sensible. D’une part elle replace avec une grande rigueur et précision les contextes intellectuels. D’autre part, elle accompagne et prolonge une discussion critique avec Primo Levi et Imre Kertész. La chose n’est pas aisée. Mais sa probité intellectuelle offre une place à l’analyse historique pour cerner les argumentations autour de la « décision du corps  » pour Améry contre l’idée de la « zone grise  » de Levi qui impose une vision morale de la torture comme culture de la souffrance [11].
C’est à partir de cette réflexion serrée sur la place du corps torturé comme sujet de l’histoire que Catherine Perret peut démonter le renversement opéré par Améry. Là où Primo Levi faisait de la torture une question morale inscrite dans une culture de la violence, Améry pose la torture comme question politique, et donc rappelle la nature politique du corps, y compris dans la torture, y compris dans la déshumanisation et la perte radicale du moi.
« Améry montre ainsi qu’il n’y a pas de politique qui ne procède de la représentation de la manière dont les corps parlants demeurent, qu’ils le sachent ou non, appendus au lien social, et non, comme ils sont tentés de le croire, penseurs, concepteurs, constructeurs de ce lien.  » [12]
Or, au sortir de la guerre, Jean Améry est bien seul à envisager un renversement d’une trop stricte anthropologie sociale du corps par une lecture politique de la torture. Le déni qui suit la guerre et la libération des camps, cette longue période de reconstruction passe sous un relatif silence la position exigeante de Jean Améry qui, prenant « la décision du corps  » fait, pense le « moi  » comme corps et déplie la logique d’un « Moi (qui) fait corps avec sa peau : « Les frontières de mon corps sont les frontières de mon Moi. La surface de ma peau m’abrite du monde étranger : au niveau de cette surface, j’ai le droit, s’il est vrai que je doive faire confiance, de n’avoir à sentir que ce que je veux sentir.  » [13]
Le corps est une question centrale pour penser la radicalité de la destruction de l’humain par la torture et par la négation totale des camps nazis. Il est le lieu de la logique d’extermination. En même temps, Catherine Perret (avec Jean Améry) dialectise cette question du corps en rappelant qu’il est aussi le lieu de la résistance, celui de la sensation, de la peau.
« Plus on progresse dans ce qui, de la résistance, tient à ce qu’on pourrait appeler des « états du corps  », la capacité qu’ont les corps de « se mettre  » dans tel ou tel état, plus la question de la relation entre les corps s’impose comme essentielle. La sensibilité s’y révèle littéralement « sens communautaire  »  » [14]
Mais avec la torture, le corps révèle une résistance nue, celle d’Améry faisant face à sa honte, et faisant face au bourreau, non pas au nom de la dignité d’un homme ou de l’homme, mais au nom du lien social, au nom de la peau comme principe de société.
[1] Catherine Perret redialectise la question du bourreau et de la victime à partir de la figure du bourreau sadien et sortir d’une construction en relation entre bourreau et victime afin de poser le tortionnaire et le nazi comme « logique de l’extermination  » (L’enseignement de la torture, p. 95) et non simple relation de négation.
[2] Jean Améry, cité par Catherine Perret, L’enseignement de la torture p. 81. Voir Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, traduit de l’allemand par Françoise Wuilmart, Le Méjan, Actes Sud, 2005, p. 81
[3] L’enseignement de la torture, p. 127
[4] L’enseignement de la torture, p. 179
[5] L’enseignement de la torture, p. 182
[6] L’enseignement de la torture, p. 184
[7] L’enseignement de la torture, p. 22
[8] L’enseignement de la torture, p. 22
[9] L’enseignement de la torture, p. 94
[10] Jean Améry cité par Perret L’enseignement de la torture, p. 64
[11] L’enseignement de la torture, p. 77. Catherine Perret procédera avec la même méticulosité méthodologique et argumentative lorsqu’elle décrira la torture au regard de Sade et du sadisme à partir de sa (ses) réception(s) française.
[12] L’enseignement de la torture, pp. 128-129
[13] Jean Améry, cité par Perret, L’enseignement de la torture, p. 167
[14] L’enseignement de la torture, p. 193