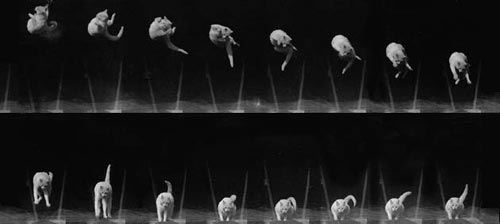| |
« L’espion
infiltré »
Cette façon de regarder de près ce
monde qui, au nom de son infinie bonté, s'offre à notre
intelligence, invite à observer
les interstices et les non dits. Quelques jours d'interrègne entre
un Léon IV et un Benoît III ont suffit pour que la rumeur
publique y insinue la Papesse Jeanne. Le recours aux archives est indispensable,
parce que là, le monde est détaillé, et multiplié,
compliqué, creusé, etc., là se multiplient les interstices,
non seulement par une description objective du monde, mais par les erreurs
et les mensonges, et les fables volontaires. Le recours aux archives
invite aussi à ce déplacement qui me libère de ma
propre culture (ma propre crétinerie) : l'exotisme ou l'étrangeté est
salutaire; on sait que l'estrangement, une description de notre ordinaire
par les yeux d'un étranger ou d'un enfant loup, donne de meilleurs
résultats qu'un reportage à la langue pauvre.
Le recours
aux archives : l'histoire (au sens d'Histoire et Géographie)
et la littérature (comme bibliothèque entière) est
aussi l'endroit où nous autres puisons nos mythologies : Papesse
Jeanne, Fantômas et Wiston Churchill.Le grand écart chez
Senges entre les sources, entre les types de sources utilisées
et confrontées,
tient aussi de cet « esprit de métaphore, sans retenue ni
limite », et d’une admiration joyeuse de la complexité du
monde (et de la bibliothèque-monde). Mais non d’un « truc » de
petit malin, d’un nivellement virant au kitsch : cet acharnement
ne ment pas, il est revendication de divergence, forcenée, salutaire.
Mais la question alors se pose, dans un afflux de sources qu’on
imagine (puisque les sources appellent les sources, comme la langue appelle
la
langue jusqu’à faire écrire des livres), de la résistance
du jet lui-même, de l’écriture en tant que geste en
lui-même fécond, dans un travail où lectures et relectures
prennent une place telle :
En dehors des textes courts (des nouvelles de quelques pages ou de quelques
lignes), le recours aux sources est nécessaire : je suis bien conscient
qu'il y a là une perversion. Disons que, tantôt l'étude
des sources l'emporte, et cavale devant le texte, tantôt le texte
cavale, et les sources rattrapent. Et parfois, la lecture d'un document
(un seul mot peut-être) incite sur-le-champ à l'écriture
d'un épisode. A un moment donné, à force de travail,
les sources sont plus ou moins bien assimilées, et je me sens parfaitement
dans le bain : l'espion infiltré.
retour sommaire « Rien de commun, rien de rien »
S’interrogeant sur la pratique, à la table
en somme (et dans la tête et le corps de celui d’à la
table), et revenant aux sources comme Senges revient aux sources (littéralement
comme dans le récit, révisant la bible à l’envers),
on tisse un lien, dont on ne sait d’abord que faire : consultant
l’expéditive notice biographique des quatrièmes de
couverture, on a appris qu’il y a la musique, très présente,
autour de la table de travail, et précédant, il y a longtemps,
l’écriture. Taraudé toujours par l’idée
du geste, on se demande quelle musique, on se demande quel lien il y
a, pour lui, entre musique et écriture. Alors on lui demande :
Pour
ce qui concerne la pratique musicale : l'interprétation est
la moindre des choses; il y a eu aussi une petite poignée de compositions
: s'agissant de musique populaire et de jazz, il n'est pas nécessaire
d'avoir les compétences de Gustav Mahler pour prétendre
signer une partition, il faut néanmoins maîtriser un bon
nombre de règles d'harmonie, et ce type de contrepoint propre à la
musique afro-américaine (c'est-à-dire aussi afro-européenne).
Ce qui est particulier au jazz, c'est que les règles de compositions
sont également les règles de l'improvisation (donc, de
l'interprétation);
et certains musiciens de jazz ont noté qu'improviser revenait à composer à l'instant.
Alors
je tiens à dire qu'il n'y a aucun rapport, mais vraiment
aucun, entre une page musicale et une page de texte, même si certains
amuseurs publics s'ingénient à prétendre le contraire,
histoire de rabâcher une fois de plus les mêmes métaphores.
La tierce mineure n'a pas d'équivalent en littérature,
ni l'accord de septième de dominante, ni la barre de reprise,
ni le mode mixolydien joué sur le triton de l'accord (mixolydien
n'ayant rien à voir
avec la myxomatose). Bien sûr, il est toujours possible d'associer
métaphoriquement littérature et musique (on pourrait même
essayer avec les exemples ci-dessus), mais ces métaphores ne doivent
pas nous autoriser la paresse d'esprit, qui consiste à poser une
fois pour toutes des équivalences sans les interroger. On a pu
entendre ici ou là des fiers-à-bras répéter
les mêmes
vieilles lunes à propos d'écriture musicale, de fugue et
de partition, sans se donner la peine de voir ce que vraiment pourraient
apporter de telles métaphores si, techniquement, elles étaient
décortiquées. (Butor l'a fait précisément
pour la fugue, dans son « Emploi du temps » : avec un résultat
mitigé : au moins, il avait pris la peine d'aller au-delà du
lieu commun, et d'appliquer à la lettre une idée jusqu'alors
un peu gratuite.)
Evidemment, j'ai fait les mêmes métaphores
faciles, comme tout le monde.
Métaphoriquement, admettons des accointances entre
prose et musique, pour le plaisir (on peut, après tout, comparer
une page à une
tranche de jambon ou à la peau de saint Barthélemy) : à condition
de ne pas entretenir niaisement des lieux communs. On peut donner à un
texte le titre d'intermezzo, de divertimento, de coda, de marche funèbre,
de contrechant, etc ( je ne m'en priverai pas) — c'est très
agréable pour l'œil et l'oreille
et l'esprit (peut-être très utile, aussi), seulement cela
ne nous apprend rien, d'un simple point de vue technique. Une comparaison à ras
de terre (prosaïque) de la musique et de la littérature en
arrive à ce constat : rien de commun. Je parle en tâcheron,
qui refuserait momentanément la vérité de la métaphore
: rien de rien.
Reste que la pratique musicale enseigne à l'apprenti à ne
pas mépriser le travail : contrairement au poète sui generis, à l'inspiré ou
pseudo inspiré tirant un alexandrin du néant par son nombril,
le musicien n'a d'autre choix que d'en passer par le calvaire de la répétition
: les gammes. Et le compositeur, Mahler même, apprend ce qu'est
un intervalle de sixte : il se tient alors droit sur sa chaise, et cette
posture,
il la conserve, y compris le jour où il devient Mahler, et qu'il
a derrière lui le Chant de la Terre. Une humilité que connaissent
aussi bien les dessinateurs, surtout ceux du cinquecento, que connaissent
les architectes, les cinéastes (certaines cinéastes), les
danseurs, mais que le petit poète dans sa confrérie de
poètes
méprise en règle générale. Les ateliers d'écriture
ne doivent pas nous faire oublier que pour la plupart des blousons dorés
de la littérature, la prose nous vient comme le mucus. Le savoir-faire
est tenu pour louche, en France au moins, il n'est qu'à voir dans
quelle étrange admiration condescendante on tient les Oulipiens,
et Perec avec eux; il est louche parce qu'il serait le recours de l'impuissant
ou, pire, l'horrible masque du mensonge. Or, depuis que les situationnistes
ont été vitrifiés, paix à leur âme,
un exorciste est appelé chaque fois que le faux pointe sa corne;
et la vérité, hier apanage de la terre, aujourd'hui du
moi-moi, est la dernière vertu, et le seul critère de valeur
(d'usage et d'échange).
Enfin, le monde musical est un monde presque
bienheureux, où l'indistinction
entre fond et forme n'a jamais été l'objet d'un seul débat.
(À vérifier).
Il
y a dans ce propos comme dans le texte, l’idée, affirmée
puis raffirmée, de travail de la lettre et de la langue, l’acceptation
aussi du texte comme énergie vitale et source nécessaire
du texte (qui ne jaillit pas du pétrole d’un derrick). On
songe, tiens, aux liens qui unissent (sans contrat ni bague au doigt,
juste estime et amitié) Pierre Senges et les deux bibliophiles
de la revue R de Réel, où il a été invité à intervenir à moult
reprises — et notamment pour un article sur la lettre R.
L’Histoire,
ainsi regardée, par d’autres trous dans
la lorgnette (le petit trou mais d’autres, encore, fuites et feintes
creusées sur les côtés) devient émouvante,
car ainsi qu’il affirme composer dans les marges d’un livre
considéré comme
déjà existant, il fait de l’Histoire des marges,
ré-illumine
des effacés, des troisièmes rôles (sur qui la lumière
n’avait souvent été qu’un flash, à peines
vus, sitôt oubliés) : à l’exemple de cet art
pondéraire en lui-même, dont on a peine à croire
qu’il
ait réellement existé — l’image à suivre
le prouve:

Première de couverture du livre 'Art pondéraire'
dont le nom de l'auteur m'échappe à l'instant (je le retrouverai
si nécessaire).
Preuve s'il en est que 'art pondéraire' n'est pas un néologisme,
mais un archéologisme
exhumé.
Cherchant les influences maîtresses, majeures, dans
ce pied-de-nez aux dogmatismes, ,on remonte, remonte, passe et repasse
et s’arrête
chez l’aveugle :
« Les éléments de l’ébahissement »
Borges, je crois
: je suis tombé assez tôt
sur ce personnage, tel qu'en lui-même, mythologique, lointain,
déjà sphynx
et monument, j'ai trouvé dans ses nouvelles ce que je cherchais
peut-être sans le savoir depuis pas mal de temps (tout ceci se déroule à l'adolescence,
si pleine de l'idée de Bildungsroman), c'est-à-dire un concentré d'intelligence.
La preuve est faite qu'une œuvre d'art irréfutable en tant
qu'œuvre d'art (et en tant qu'émotion) peut naître de
la raison pure, pour ainsi dire. Enfin, pouvoir faire l'éloge de
la spéculation, pour reprendre ce terme de Borges lui-même,
un terme parfait puisqu'il évoque à la fois les aventures épiques
et lyrique se déroulant sous un crâne et les effets d'illusion
des miroirs (car Borges, pour qui le découvre, c'est les jeux de
la logique et cette façon de savoir s'abandonner comme spectateur
aux images qui ont apparemment le moins recours à la raison : palais
des Mille et une nuits, tigres, déserts, spadassins, sorciers, magiciens,
fantômes).
La lecture de Borges
intervient souvent comme une rupture dans le cours d'une culture classique
: les livres de Borges supposent
cette culture
et l'ouvrent en deux, comme on ouvre en deux le sanglier rôti pour
en faire sortir toute une farce de cuisine de Rabelais dans le Satyricon
de Fellini; mais ça fonctionne également y compris quand
on n'a pas encore totalement acquis cette culture classique, ce qui était
mon cas : le lectures ultérieures sont curieusement empreintes de
borgesisme, le regard et la raison s'en trouvent certainement dévoyés.
Chez
Borges (et voilà ce qui sert d'exemple), les éléments
de la culture la plus pointue ne sont plus prétexte à thèses, à gravité, à pédantisme,
ni même à simple disputatio, mais s'assemblent comme des motifs
de récit (comme on assemblerait une jouvencelle et un monstre pour
créer le suspens). Ils sont aussi les éléments de
l'ébahissement : ce n'est pas nouveau, puisque l'érudition
est déjà chez Schwob, ou Flaubert, ou Jean Paul Richter une
forme d'enchantement, qui suscite la réflexion, mais ça l'est
de façon pus intense, ou bien on a l'impression qu'en la matière
Borges fait autorité, et représente maintenant à lui
seul l'érudition comme conte de fées. Les héritiers
de cette conception sont nombreux, et bien sûr je fais partie de
ce très grand nombre, mais une grande part de cet encyclopédisme-comme-livret-d'opéra
vient aussi d'un auteur qui n'a rien de Borgesien (puisqu'il le précède
de beaucoup), Szentkuthy. (C'est de lui, par exemple, que vient l'idée
(évoquée plus haut ?) de mythologie moderne remplaçant
Mercure et Zeus par Frédéric II et Charlemagne.)
D'autres éléments
d'une grande importance trouvés
chez Borges (mais provenant également d'ailleurs), la réconciliation
avec le récit et avec le plaisir du texte (ou plaisir de la narration,
sans complaisance mais sans mépris) et l'humour. L'humour, qui se
trouve à chaque ligne de ses essais de façon intense, est
l'équivalent de cette élévation au carré que
Borges narrateur ne cesse de pratiquer dans ses nouvelles : il s'agit dans
les deux cas de recul, d'écart, de prise de distance, que ce soit
une formidable spirale narrative à la fin de « la Loterie à Babylone »'
(ou « la Quête d'Averroès ») ou l'incessant
commentaire du commentaire des articles théoriques.
Autre chose : Borges,
qui s'était senti incapable d'écrire
un récit, justement, a feint d'écrire un essai pour sournoisement
composer un récit, d'où est née cette manière
si particulière de fiction indiscernable de l'essai et vice-versa.
D'autres sauront s'y prendre de la même façon, mais encore
une fois Borges se pose en patron inévitable. Voilà aussi
qui sert diablement de leçon.
Pour ce qui concerne
plus précisément la fiction de France
Culture (une remarquable spirale narrative produite pour une « fiction
du samedi », intitulée Ombre et le ver luisant)
, Borges était tapis derrière, mais aussi ses disciples
plus ou moins directs, comme Casares (Morel évidemment), Cortazar
et Saer, tous argentins. La fiction, à mon avis, n'est pas à la
hauteur de ces modèles, mais son sujet (Borges aurait dit « son
argument ») l'est encore.
On continue de remonter,
reproduisant le mouvement de lecture du jardinier de Ruines-de-Rome.
On déterre jusqu’aux racines
pour voir, on gratte jusque sous les pieds du bureau : continue donc à relire
l’entretien dans le sens inverse, qui avait débuté ainsi
:
Il n'y a donc pas de commencement déterminé : autrement dit,
on ne peut déterminer de commencement, mais cette indétermination
n'est pas celle du commencement du temps, avant lequel il n'y a rien, elle évoque
plutôt la séparation du jaune au bleu, introuvable dans un
halo verdâtre. Il y a pourtant eu un jour où, consciemment
(voir plus haut) j'ai décidé de consacrer un intervalle de
temps, le matin, à l'exercice d'écriture : mais ce jour-là est
oublié (en faveur d'un progressif glissement de la non-écriture à l'écriture
complète, ceci dit avec un peu d'emphase). Longtemps, l'exercice
d'écriture n'est associé en aucune manière à l'idée
(ou l'ambition, ou même l'angoisse) de publication : le mot d'écrivain
est le dernier que je prononcerai sur mon lit de mort, et encore, j'espère
que je trouverai mieux. Tout alors oui recommencé, reprend, car,
le texte appelant le texte, il y en un de nouveau, arrivé à la
table de travail (sur le azertyuiopqdfg clavier, c’est gênant),
en cours de rédaction
de cet article. Pour une nouvelle collection de textes et d’images, « On
se demande comment de tels livres arrivent entre les mains du public » (de
son vrai nom), menée par les complices de R de Réel, Pierre
Senges a collaboré à distance avec l’étonnant
dessinateur Killoffer (un des fondateurs de l’association). Le livre
formé par cette union est un bel objet, rectangle et divagant, confrontation
amusée de deux regards lointains, sur ce qui, au pied de la lettre,
réunit les hommes : la ville.

A propos de Géométrie dans
la poussière: la règle
du jeu inventé par les directeurs de la collection Raphaël
Meltz et Laetitia Bianchi consiste, précisément, à ne
pas illustrer un texte ni légender
une image.
Concrètement, j'ai reçu une première salve
de dessins killofferiens en juin de l'année dernière, que
j'ai volontairement entraperçus,
de même que l'on perçoit en ville, dans des reflets de vitrines,
des spectacles immédiatement
perdus. J'ai été frappé par ces fresques sur papier,
puis je les ai rangées dans l'enveloppe, d'où je les retirais
de temps à autre très
brièvement et très rarement, histoire de me laisser surprendre à nouveau.
Le thème du texte étant celui de la ville, j'ai écrit
une série
de chapitres inspirés ou non par le souvenir que j'avais des images
de Killoffer (des trognes, du mouvement, du chaos, des lignes brisées,
des enchevêtrements
- et puis quelques détails, comme ce bol de cacahuètes).
Les textes ont été envoyés à Killoffer, qui
a poursuivi son travail de dessinateur après avoir
lu l'ensemble. Mais je ne sais pas dans quelle mesure la lecture des
pages lui ont inspiré des croquis.
Le texte lui garde son mystère
et ne trace aucune ligne trop droite, s’attarde sur des détails
qu’il sait rendre essentiel,
entre insomniaques et cacahuètes. Comment alors ne pas finir sur
un morceau de la presque fin de ce livre :
«
Nous pourrons nous contenter de mourir en toute simplicité, à tel
endroit déterminé de ta capitale, après une logue
agonie qui aura le style capiteux des fins de règne (un style
tendu et paresseux, plongé dans une sérénité que
personne ne cherchera à définir précisément
de peur de la perdre — une fin de règne porteuse pourtant
de débuts d’intrigues, comme les germes d’un temps à venir).
Nous ne jouerons plus aux échecs, nous nous tiendrons de chaque
côté d’un échiquier, sans bouger ni le petit
doigt, ni le fou, ni la tour — et tous tes secrétaires auront
l’ordre de ne pas nous déranger tant que dure cette immobilité. »

Guénaël Boutouillet
retour sommaire |
![]() tracer
des lettres
tracer
des lettres![]() histoire de pousser
plus loin le raisonnement
histoire de pousser
plus loin le raisonnement![]() tout exact de
dos
tout exact de
dos![]() une trajectoire
une trajectoire![]() l'espion infiltré
l'espion infiltré![]() rien de commun,
rien de rien
rien de commun,
rien de rien![]() les
éléments de l'ébahissement
les
éléments de l'ébahissement![]() bibliographie
et liens
bibliographie
et liens