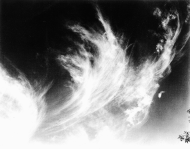|
sur
Alfred
Stieglitz, et
Valérie Belin, Clarisse
Doussot, Thibaut
Cuisset, Laurence Rondoni, Rémi Vinet et Anne-Lise
Broyer
Je fais mien le constat
selon lequel photographier produit des effets en retour. Le
photographe et l'image dont il est l'auteur ne sont pas
quittes. L'acte et le processus de photographier induisent
des phénomènes d'interférence, pour ne
pas dire de contamination. Les images fragmentent le monde
et sont fragmentées par celui-ci. Si l'on s'appuie
sur la présupposition simplifiée que le monde
est réel, que le monde est le réel, on peut
envisager que l'émiettement du réel, donc de
nous-mêmes, est sans fin. Je fais mienne
l'idée, certes audacieuse, que l'image photographie
son auteur. L'image est une photographie de qui la
réalise, l'exécute, l'effectue, au sens
où ce qui tiendrait lieu d'intention voire de projet
serait constitué d'un effet que la photographie
visualise dès lors qu'elle paraît. Dans un
autre contexte, Giulio Paolini suggère, d'une formule
singulière : " L'oeuvre imagine l'auteur. "
Au-delà de l'objet que l'on photographie (ces objets
sont par définition innombrables, infinis), ce que
fixe une image, ce qui est fixé par elle et en elle,
c'est au demeurant une situation : une situation du monde,
de sa réalité, de sa complexité. La
complexité du monde est une chance pour les
photographes et pour la photographie. D'une démarche
à l'autre, le processus d'aspiration du réel
dans l'image et de l'image dans le réel, est
évidemment plus ou moins intense, plus ou moins
préhensible. Au sujet des couleurs de certains
tableaux de Cézanne par exemple, Rilke note : "
Là, toute la réalité est de son
côté. " Il sera donc question de situations
fragmentées du monde dans des images et des
modalités selon lesquelles, dans le temps de la prise
de vue, pour ainsi dire dans la prise de vue, le monde
fragmente les images et les images sont fragmentées
par celui-ci. Il sera question des conséquences
plastiques de ces dispositifs de fragmentation
simultanés. La forme de la proposition est celle
d'une construction, sorte d'architecture : un parcours non
linéaire dans une architecture ; parcours
personnalisé entre des oeuvres qui instruisent l'oeil
et la pensée de l'état (des états) du
monde, et déterminent des êtres que les images
du monde en elles réfléchissent.
Alfred Stieglitz s'est
exprimé avec lucidité et simplicité sur
la photographie et sur ses mécanismes. En une phrase,
il suggère un point de départ possible pour
une réflexion sur la photographie dans le rapport aux
effets qu'elle induit : " Le plus important est de retenir
un moment, d'enregistrer quelque chose si
complètement que ceux qui le voient revivront un
équivalent de ce qui a été
exprimé. " Je souligne l'expression enregistrer
quelque chose si complètement et le mot
équivalent. Pour donner à voir ce qu'il a
perçu, Stieglitz entend proposer un équivalent
et non, précise-t-il, " ce que
l'événement signifie pour (lui). " Le sens, la
réflexion sur le sens, sont nécessairement
postérieurs : " Ce n'est qu'après avoir
créé un équivalent de ce qui m'a
touché que je commence à penser à sa
signification. " Qu'est-ce qu'un équivalent ?
Enracinée dans l'étymologie latine
(æquivalere), apparaît d'abord l'idée
d'une valeur qui serait la même en qualité ou
en quantité, ou sur les deux registres. Ce que veut
Stieglitz, ce que veux sa photographie, c'est donner
l'équivalent de ce que lui même ou de ce que la
photographie a reçu. On peut également
évoquer l'acception du mot rapporté au domaine
de la physique. Dans la théorie de Joule, "
l'équivalent mécanique de la valeur est le
rapport constant entre le travail et la quantité de
chaleur échangées par transformation de
l'énergie ". Nous nous éloignons en apparence
du champ de la photographie. Néanmoins le principe de
transformation de l'énergie, d'une certaine
énergie, n'est pas sans rapport avec la
volonté de Stieglitz de restituer dans ses images
l'énergie qui a scintillé dans l'oeil de son
viseur et l'a troublé. Il y a aussi, dans cette
notion d'équivalence, l'idée certes un peu
folle mais ô combien touchante, de totalité.
Rilke, déjà cité, parle en tant que
poète (et son état de poète l'autorise
à parler ainsi) d'une " passion de la totalité
". Le rêve de restituer dans des images la
totalité de sa vision de photographe animait
secrètement Alfred Stieglitz. Initiateur de ce qu'on
appelle aujourd'hui encore la " photographie directe ",
Stieglitz était par principe opposé à
toute manipulation, à tous les traitements qu'il
qualifiait d' " hybrides ", singulièrement en
matière de tirage. Dans cet esprit, en regard ce type
de positionnement et de pratique, il faut entendre et saisir
la volonté d' " enregistrer quelque chose si
complètement ". Cette volonté permet que les
effets du réel sur l'image et les effets de l'image
sur son auteur s'exercent eux aussi complètement. La
perspective n'est pas de saisir le réel tel qu'il
est, selon la conviction des photographes de la Nouvelle
Objectivité : il ne s'agit pas de mettre en retrait
la subjectivité pour " permettre au monde de se fixer
sur la plaque ", ni d'envisager que l'image devienne " le
révélateur de la vérité
graphique du monde " (Danielle Sallenave à propos de
Kertész). Il s'agit de saisir le réel tel que
l'oeil du photographe le perçoit avec
intensité. Cette densité du regard, qui ne
s'éprouve probablement que lorsque l'oeil voit par le
viseur de l'appareil, est ce qui s'entend
expressément dans le désir insensé d' "
enregistrer quelque chose si complètement ". Seul le
photographe peut éprouver qu'il a pris dans le
réel tout ce dont son image a besoin pour être.
À la mesure où l'enregistrement est complet,
les mécanismes d'effet, d'effet en retour, peuvent
s'exercer. Stieglitz sut précisément resituer
l'importance de la subjectivité dans l'acte
photographique. Pour lui, l'auteur d'une photographie doit
se donner, quoi qu'il advienne, une vision par la
totalité de soi. Ainsi les objets qu'il aborde
sont-ils de plus en plus difficiles, de plus en plus
impossibles à photographier. Ses clichés de
nuages permettent de comprendre l'ampleur de ses
conceptions. N'emploie-t-il pas a dessein l'expression "
mettre à l'épreuve ma philosophie de la vie "
? N'est-il pas soucieux de prouver que ses photographies ne
sont pas dues à leur sujet, auquel elles ne sont pas
réductibles : " Pas à certains arbres,
insiste-t-il, à certains visages, à des
intérieurs ou à quelque privilège " ?
Il précise, non son humour : " Les nuages
appartiennent à tout le monde ". L'ambition d'Alfred
Stieglitz fut de produire des photographies qui ressemblent
tellement à des photographies que " si l'on a des
yeux et que l'on sait voir, on ne peut jamais les oublier,
même si on ne les a regardées qu'une fois. " Sa
déclaration probablement la plus décisive, car
la plus instructive pour la compréhension de son
oeuvre et de son apport à la modernité,
pourrait être : " Mes photographies sont une image du
chaos du monde et de ma relation avec ce chaos. Mes tirages
montrent la remise en question de l'équilibre de
l'homme et son éternelle bataille pour le
rétablir. "
  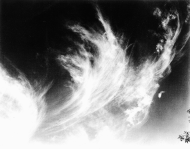
Je propose à présent
quelques images de photographes d'aujourd'hui. Je les ai
retenues car elles me semblent en mesure de soutenir, sinon
d'étoffer, les réflexions qui m'occupent. Ces
images sont venues dans mon regard et j'entends dire comment
elles y sont présentes, comment je puis nommer cet
état de présence, un peu comme si nous
étions convenus, sous les auspices de Wittgenstein,
de poursuivre " la description du monde au moyen de noms ".
Les noms ont ceci de remarquable qu'ils savent, dit l'auteur
du Tractatus, " caractériser la communauté
d'une forme et d'un contenu. "
Dans un texte récent, Pierre
Wat affirme : " Valérie Belin photographie comme on
autopsie. " Le forfait semble en l'occurrence longuement et
mûrement préparé. Les objets
photographiés sont précisément
cadrés. L'oeil du photographe a-t-il voulu entrer
tout entièrement dans le viseur pour extraire du
réel l'exacte intensité nécessaire
à chaque image ? Cet oeil semble animé d'un
unique souci : soumettre le regard de l'observateur aux
mêmes nécessités. Photographies à
prendre tout entièrement ou à laisser.
D'autant qu'une espèce de violence est inscrite dans
certaines de ces images : voitures accidentées,
morceaux de viande. Serait-ce l'intention, l'unique
intention du photographe, que de nous mettre en situation de
réagir à un genre de représentation
dont le caractère de violence serait l'enjeu ? Dans
une série antérieure, la photographie d'un
vêtement déposé dans une boîte
dont on a seulement retiré le couvercle, un
vêtement séparé du corps
désormais absent qui l'a porté, ne
contient-elle pas une violence équivalente à
celle, en apparence plus explicite, que communique au
premier abord l'image d'un véhicule accidenté
? L'évocation, la mise en exergue de la violence
n'apparaît pourtant pas comme le propos premier ou
majeur de Valérie Belin. Sur un ensemble de sujets
différenciés, le positionnement et la nature
de l'image sont en définitive semblables. Un regard
furtif sur ces tirages grand format pourrait nous laisser
croire que le photographe a souhaité effectuer un
constat, que sa perspective est d'établir un
recensement, une typologie. L'oeil de Valérie Belin
n'est pas celui d'un sociologue. Son ambition est
plutôt de comprendre ce que la photographie, eu
égard à ses mécanismes
spécifiques, peut extraire du fragment de
réalité pris pour objet. Qu'est-ce qu'un
fragment de réalité peut donner en propre
à une photographie ? Qu'est-ce qu'une photographie
peut extraire en propre du fragment de la
réalité qu'elle convoite ? Qu'est-ce qui se
transmet de si singulier entre l'oeil et le réel que
peut seule favoriser et accomplir une photographie ?
Qu'est-ce qui s'invente là ? Ce qui s'invente n'est
rien de moins qu'une représentation de la
photographie en elle-même, disposition par laquelle
une image devient, ce n'est pas si simple, le lieu de sa
propre représentation. Lieu séparé de
l'oeil du photographe autant que du réel, lieu
positionné entre les deux, si l'on
préfère. Là, dans un entre-deux
magique, s'exerce la responsabilité du photographe.
Cette responsabilité ne peut se réduire
à un enjeu formel, au seul souci d'obtenir un
agencement de formes et de matières agréable
à l'oeil de l'amateur. La responsabilité du
photographe n'est-elle pas de favoriser l'émergence
d'un espace visuel (virtuel) où la totalité de
sa vision est rassemblée ?
Les images de Clarisse Doussot sont
aussi des natures mortes. Elles intriguent par leur
simplicité. Un objet qui contient peu
d'éléments est réputé simple
à proportion qu'il n'est pas décomposable. Il
m'apparaît que cette définition s'applique. Je
ne peux croire que l'auteur de ces images n'ait le souci
d'une simplicité. Chaque photographie, avec si peu
d'éléments, s'impose comme l'image sans
ambiguïté d'un état des choses. Chaque
photographie s'acquitte de cette simplicité, comme
si, en chacune d'elle, l'image tenait lieu d'explication et
nous en dispensait. Au sujet des photographes pratiquent le
" flou ", Jean-Claude Lemagny avait proposé la
formule " reconquérir la présence des choses
". Même si la démarche de Clarisse Doussot se
situe à l'opposé de cette pratique, les mots "
conquérir ", " présence ", " choses " me
semblent adaptés. Les choses photographiées ne
passent pas devant notre oeil. Elles sont établies
dans l'image et, par la grâce d'une certaine
lumière, de certaines couleurs, imposent une sorte de
motif sensible dont la capacité d'attraction est
indéniable. Dans la réalité
quotidienne, nous n'aurions peut-être pas
considéré cet arrangement visuel
constitué d'un ou deux sacs plastiques monochromes.
Or, voici que nous l'observons, interrogatifs. Il y a
là une addition, un effet d'addition, de
densités. On ne sait quoi apparaît. Cette
configuration sobre et soignée fixe une sensation qui
ne relève pas, là encore, de la seule
tentation esthétique. Ces photographies ne
procèdent pas d'un geste improvisé, même
s'il fut est intuitif à l'origine. Elles instituent
un espace homogène, comme autosuffisant, à
l'écart du désordre et de la
dissémination du monde. Espace clos, mais pas
oppressant : articulé, concentré. Tout a
été discrètement agencé pour
qu'un " acte photographique " délibéré
ait lieu, et de fait il a lieu. Cet acte ne relève
pas d'une attitude froide ou distante. On ne perçoit
en effet aucune légèreté, aucune
superficialité. On distingue une matière
paradoxale, à la mesure où chaque photographie
fait advenir une sensation d'immatérialité.
Sans doute est-ce dans l'expression sobre et résolue
de ce rendu paradoxal que ces photographies trouvent leur
force, que s'origine le sentiment d'une dense
immobilité qu'elles procurent.
  
L'immobilité pourrait
être le thème émanant des photographies
de Thibaut Cuisset. Inutile de les décrire : leur
description s'effectue instantanément dans le regard
de qui les considère. Il est dit dans un catalogue
que ces paysages ont l'air " inachevé " ou ont un air
d'inachevé. La limpidité des tirages, leurs
évidentes qualités techniques (cadrage,
couleur, lumière), donnent le sentiment d'achever ce
qui peut-être ne le fut pas. N'est-ce pas
l'intensité de regard du photographe qui donne
à ces images une structure, un rythme, un calme (ce
n'est pas contradictoire), une étrange "
pureté " ? La référence à la
peinture va de soi. Formes et tonalités
évoquent les paysages de l'Italie et la peinture
italienne, celle du Quatrocento notamment (certaines images
ont été réalisées lors d'un
séjour à la Villa Médicis). Il ne
s'agit pas de photographies d'architecture (genre
identifié), ni même strictement de
photographies de paysage. On identifie certes de
l'architecture et du paysage, mais aussi (et surtout) un
regard sur des architectures et sur des paysages.
Développer un propos sur les aspects techniques (les
angles de prise de vue ne sont pas indifférents dans
ce travail) pourrait être envisagé. Le
savoir-faire est ici tout entièrement affecté
au service d'une perception dont la vertu pourrait
être de déposer de la simplicité et de
la rigueur dans un réel qui n'en offre pas (banlieues
désertées par exemple). Thibaut Cuisset est
à sa manière un " précisionniste ",
catégorie pas plus scientifique qu'une autre dans
laquelle la critique situe notamment l'oeuvre de Paul Stand.
Il ne recherche pas pour autant la seule précision du
détail. Il capte dans le réel suffisamment de
détails pour que la structure de chaque image soit
adéquate, à la mesure où tous les
éléments structurels sensibles paraissent
s'accorder en une miraculeuse équation.

Les photographies de Laurence
Rondoni sont intuitives et instinctives. Mais il convient de
s'accorder sur le sens des mots " intuition " et " instinct
". Intuitio veut dire " regarder attentivement ". Regarder
ce qui apparaît et ce qui s'efface. Regarder
simultanément, si cela se peut, l'apparition et
l'effacement. Regarder peut-être entre ce qui
apparaît et ce qui s'efface. C'est cela qui se
présente à moi lorsque je fixe (comment faire
autrement que les fixer ?) ces images. Quant à "
l'instinct ", il caractérise une tendance
innée et puissante. Laurence Rondoni puise ses images
autant en elle que hors d'elle. Ses photographies
résultent d'un arrachement entre un corps et le
réel. Comme quoi une image que l'on saisi (je m'en
tiens à une supposition et pourquoi pas à une
interprétation) pourrait ne pas être
captée seulement par les yeux : par des gestes sans
doute, par un mouvement, une puissance, qui agissent le
corps. On aperçoit des personnages, plus
familièrement des personnes. Parfois peu distinctes
il est vrai, mais bien visibles. " Ces autres, questionne
Jacques Borel dans L'effacement, est-ce de toi qu'ils
rêvent en toi, ou de qui encore, de qui, de quel
passé, de quel lointain avenir peut-être ? "
L'interrogation est aussi troublante que l'image. Ces
photographies sont après tout des questions. Elles
ont une disposition à accueillir des corps, eux aussi
probablement intuitifs, instinctifs ; en quelque sorte,
elles en prennent soin. C'est ce qui distingue un fragment
en littérature d'une image, elle même pourtant
détachée du réel tel un fragment. " Les
fragments s'écrivent comme séparations
inaccomplies ", rappelle Maurice Blanchot. Sans doute ces
images préservent-elles la séparation de tout
accomplissement. En elles, l'effet de fragmentation est
incomplet, puisque des corps sont là, même
bougés, partiels, même dans l'ombre. Ainsi
a-t-on le loisir de les voir réapparaître. A
contrario, du blanc qui sépare deux fragments sur une
page ne transparaît visiblement plus rien.

Les photographies de Rémi
Vinet ne sont pas des portraits. D'un mot plus
indéterminé, plus elliptique, ce sont des "
figures ", du moins est-ce ainsi que le photographe
lui-même les qualifie. " Figure ", bien sûr,
cela veut dire forme. La signification première est "
forme extérieure d'un corps ". Rémi Vinet va
chercher ces " figures " dans de ses propres images en
effectuant un deuxième cliché, que l'on
pourrait dire de détail, à l'intérieur
d'une de ses photographies projetée. Est-ce la
première image, d'où il extrait des visages,
qui souffre de trop de complexité ? Dans ce cas, la
démarche est opportune qui consiste à
pénétrer cette complexité pour la
décomposer, l'apaiser, l'accepter, et peut-être
de la comprendre. Est-ce à l'inverse
l'évidence d'une simplicité apparente de la
vue d'ensemble qui pousse le photographe à entrer
dans son image pour en approcher la densité et
procéder à un examen de détail afin de
localiser dans son regard ce qui l'a motivé ? " Il
faut encore fragmenter les fragments, fractionner la voix,
le souffle... ", suggérait Gérard Arseguel
dans son livre Décharges. Les " figures " de
Rémi Vinet sont des trous dans ses propres
photographies. Dans les excavités apparaissent des
visages. La méthode consiste à commencer par
regarder à l'intérieur de son propre regard,
et puis à détailler ce regard, à
l'explorer, fragment par fragment. N'est-ce pas ce à
quoi devrait se consacrer tout photographe ?
Reconquérir une image à l'intérieur de
l'image. Ne jamais s'en tenir à ce que l'on
perçoit au premier abord. Faire en sorte que l'image
advienne en se détachant d'elle-même. Cela
exige beaucoup de patience, de doigté, de
lucidité. Parfois les photographies donnent la
sensation qu'elles dissimulent quelque chose. Trop de
réel peut-être est entré dans l'image.
Les " figures " de Rémi Vinet produisent une
sensation inverse. Quelque chose &endash; un visage, on se
sait quoi à l'intérieur d'un visage &endash;
se montre à découvert. Signifier cette mise
à jour ou au jour est suffisant et dispense d'autres
commentaires. Il me suffit de voir ces visages tel qu'ils
sont apparus, dans un autre espace, un autre temps, une
autre lumière.
  
Je regarde les images d'Anne-Lise
Broyer comme des photographies anonymes. Je ne sais rien de
l'auteur. J'imagine que les images décrivent autour
de l'oeil et de la mémoire du photographe un vaste
cercle qui s'agrandit au fur et à mesure que les vues
s'additionnent. J'ignore tout de ce qui pourrait ici tenir
lieu de centre. " Maintenant, allez jusqu'à la
pièce la plus reculée, tout au fond d'un de
ces vastes bâtiments, suggère Tanizaki
Junichirô dans son Éloge de l'ombre, les
cloisons mobiles et les paravents dorés,
placés dans une obscurité qu'aucune
lumière ne pénètre jamais, captent
l'extrême pointe de la clarté du lointain
jardin dont je ne sais combien de pièces les
séparent... " Ces images de petites dimensions
captent on ne sait quelle lointaine clarté. Et c'est
cela que je regarde. Je regarde en elles l'espèce
rare de clarté qui les fait apparaître. Ne pas
savoir me semble un atout pour regarder une photographie. Je
ne me réfère pas au " savoir photographique ",
à cette connaissance rudimentaire que l'on obtient
sans trop de peine de la fréquentation des images,
même lorsqu'on n'est pas photographe. J'évoque
et j'approuve le non-savoir des circonstances. Quelle
était la situation ? Qui était là et
pourquoi ? Quel était le jour et l'heure ? Ces
détails ont peu d'importance. Roland Barthes a
tranché un éventuel débat sur la
question de la contextualité des images par ces mots
: " Telle photo m'advient, telle autre non. " Dans ces
photographies, les circonstances (de la prise de vue),
l'information sur le contexte, sont d'autant moins à
considérer qu'il s'agit, vraisemblablement, d'images
réalisées dans le territoire intime de
l'auteur. Est-il suffisant et satisfaisant de
répéter que la photographie est " un art de
l'instant, de l'instantané " ? Ce que je regarde,
est-ce un instant que la photographie aurait (et a de fait)
fixé ? N'est-ce pas plutôt ce qui, dans cet
instant, s'est tout à la fois décalé et
absenté ? Je ne puis dire précisément
ce que ces photographies ont enregistré, ou alors je
puis suggérer qu'elles ont enregistré du
temps, quelque chose comme une matière du temps, hors
du temps réel, combinaison d'une présence et
d'une absence, d'une présence absente ou d'une
absence présente ? Ces photographies tirent leur
lumière, et éclairent en cela le temps
qu'elles ont arrêté, non d'une
éclaircie, naturelle ou artificielle, mais d'un
obscurcissement. Nous savons depuis les recherches de
Schulze, qui datent du XVIII° siècle, que loin
d'être chassée par la lumière,
l'obscurité est produite par elle. Est-ce le
réel capté par l'oeil du photographe qui
suscite cet effet d'obscurcissement ou de peu de
clarté ? Ou est-ce au contraire le mécanisme
de la prise de vue, y compris dans ses effets chimiques, qui
éclaire discrètement l'obscurité ? Ces
images gardent le silence sur la réciprocité
de ces effets.
  
Évoquant une photographie
célèbre de Robert Frank prise à Londres
en 1932, Jean-Marie Schaeffer indique : " Il n'y a rien de
particulier à voir, sinon cette chose inattendue,
incompréhensible, une chose qu'on n'a jamais vue et
qu'on ne verra jamais, sinon dans cette photo, dans cette
promenade imaginaire débouchant sur une fraction de
seconde de réel quasi perceptif : un chien en
suspension quelque part dans l'espace aérien de la
cour... " Ce que j'ai observé dans les photographies
présentées n'est visible que dans ces
photographies et parce que ce sont des photographies. Cela
va de soi et pourtant l'affirmer est audacieux.
Curieusement, Schaeffer pointe (et même
dénonce) " le refus de l'image de contenter notre
désir de plénitude " et affirme que ce refus "
nous amène à chercher ailleurs le
complément qui fait défaut : dans le
réel qui est hors-champ peut-être. " Il
déclare tout de go que cette photographie de Frank
est un " scandale " ... Bien sûr qu'une photographie
qui n'est qu'une photographie et qui se montre comme telle
est un scandale. C'est parce que les photographies que nous
regardons sont un scandale qu'elles méritent
d'être regardées. C'est parce que nous avons vu
de nos yeux ce scandale que nous savons qu'il n'y a, dans
ces images, rien d'autre à regarder. Voilà ce
que nous montre, d'elle-même et de la
réalité, la photographie, en effet.
4 février &endash; 24 avril
1999
Revu et corrigé au mois
d'avril 2000
Bibliographie
Arseguel, Gérard,
Décharges, Collection Gramma, Christian Bourgois
Éditeur, Paris, 1979
Barthes, Roland, La chambre
claire, Note sur la photographie, Cahiers du Cinéma,
Gallimard, Seuil, Paris, 1980
Bonfait, Olivier, " Moments
d'éternité ", in catalogue Thibaut Cuisset,
Paysages d'Italie, Villa Médicis, Rome, 1993
Blanchot, Maurice,
L'écriture du désastre, Gallimard, Paris,
1980
Borel, Jacques,
L'effacement, Gallimard, Paris, 1998
Junichirô, Tanizaki,
Éloge de l'ombre, traduction de japonais par
René Sieffert, POF, Paris, 1995
Lemagny, Jean-Claude, " De
quoi parlons-nous ? ", in Bonjour, Monsieur Lemagny,
Nouvelles de la photographie, Comité national de la
gravure française, Paris, 1996
Paolini, Giulio, Voix off,
traduction par Anne Machet, textes rassemblés et
préfacés par Alain Coulange, Collection
Gramma, Éditions W, Mâcon, 1986
Rilke, Rainer Maria,
Lettres sur Cézanne, traduites de l'allemand et
présentées par Philippe Jaccottet, Le Don des
Langues, Seuil, Paris, 1991
Sallenave, Danielle, "
Voir, c'est lire ", in André Kertész, Photo
Poche, Centre national de la photographie, Paris, 1985
Schaeffer, Jean-Marie,
L'image précaire, Du dispositif photographique,
Seuil, Paris, 1987
Stieglitz, Alfred, propos
cités par Dorothy Norman, in Alfred Stieglitz,
Collection Aperture Masters of Photography, traduction en
français par Jacques Bosser, Könemann Verlags,
Cologne, 1997
Wat, Pierre, " Memento mori
", in catalogue Valérie Belin, Photographies
1997-1998, Galerie Xippas, Paris, Centre d'art contemporain,
Vassivière-en-Limousin, Arthothèque, Caen, Le
Prieuré Saint-Michel, Crouttes, 1999
Wittgenstein, Ludwig,
Carnets 1914-1916, édition et traduction de Gilles
Gaston Granger, Gallimard, Paris, 1997
|