« Cette attirance pour le flou et l’immensité de l’abîme devant lequel nous nous trouvons » (L’Ogre)

À la découverte de cette nouvelle et belle maison d’édition : entretien avec ses deux fondateurs, Aurélien Blanchard et Benoit Laureau
Chaque "rentrée littéraire" se voyant un peu plus phagocytée par quelque(s) titre(s) qui font événement (et font plus rarement littérature), la naissance en ce mois de janvier 2015, de cette petite maison neuve au programme alléchant et ambitieux, entre premiers romans (Fabien Clouette, Mathieu Brosseau qu’on connait bien sur remue) et rééditions nécessaires (Aventures dans l’irréalité immédiate de Blecher, a par exemple été couronné de l’excellent prix Nocturne en 2013), méritait d’être saluée. En attendant de découvrir ses deux premiers titres en librairie, mardi 6 janvier, nous sommes allés à la rencontre de l’Ogre.
L’ogre est bicéphale : nous avons rencontré ses deux têtes, Benoit Laureau et Aurélien Blanchard, qui nous présentent ici leur projet et programme éditorial.
(Guénaë l Boutouillet)

"Avec l’Ogre, nous souhaitons défendre des livres qui, d’une manière ou d’une autre, mettent à mal notre sens de la réalité, traitent de ce moment drôle ou terrifiant où les choses et les gens ne semblent plus être ce qu’ils sont d’habitude, où le dehors arrête d’être sage et bien rangé.(...)".
De quels chemins personnels, littéraires, ce nom et ce projet procèdent-ils ? Quels en furent les tâtonnements, individuels et collectifs ?
Benoit Laureau : Pour ma part la question de l’irréalité, ou celle d’un chaos calme à l’intérieur duquel se chevauchent plusieurs réalités, a commencé par la découverte, enfant, de deux univers, celui des pierres et des insectes, tous deux synonymes de beauté et d’horreur, qui me semblaient beaucoup plus réels que je ne pourrais jamais l’être. Puis, en grandissant, les lectures de Dostoïevski, Schulz, Artaud ou Gombrowicz – Klaus Hoffer et Blecher plus récemment –, ont conforté ce goà »t pour les marges, l’envers et l’invisible, qui composent l’essentiel de notre matière, et cette attirance pour le flou et l’immensité de l’abîme devant lequel nous nous trouvons. Quand j’ai proposé à Aurélien de monter l’Ogre, c’est exactement sur ce point que nous nous sommes retrouvés, cette notion de basculement.
Travailler à La Quinzaine littéraire et côtoyer pendant ces années Maurice Nadeau a joué un rôle fondamental dans l’émergence de cette idée. D’abord d’un point de vue littéraire, j’ai découvert à travers son travail de critique et d’éditeur tout un pan d’irréalité passée ou contemporaine. Puis son exigence et son obstination à considérer l’édition comme un espace dans lequel les langues sont libres de se déployer et de cartographier le réel dans toutes ces dimensions – pourvu qu’elles nous proposent une vision différente du monde – ont achevé de me convaincre que la fiction était un merveilleux outil de remédiation du réel, et qu’il nous appartenait de valoriser cette dimension de la littérature.
Pour autant, la question de ce qu’est l’irréalité reste difficile à définir. Pour moi ce serait une sorte d’« hyper-fiction  » qui sature le réel à coup de langue. Car c’est bien de ça qu’il s’agit, de permettre l’émergence d’une langue de l’irréalité, qui ne soit ni celle du réalisme magique, ni celle du fantastique. Au fond, plus que de lui donner du sens, l’irréalité permettrait d’informer le réel, de le nourrir, de laisser apparaître à travers lui toutes ses strates et chevauchements, comme on pèlerait un oignon, sauf qu’une fois le réel pelé, c’est l’abîme.
Quant au nom de l’Ogre je laisserais Aurélien répondre puisqu’il en est l’auteur…
Aurélien Blanchard : En ce qui concerne le cheminement personnel et littéraire, je ne vais pas m’étendre longtemps dessus : par bien des côtés, il rejoint les expériences de lecture de Benoit. J’ai, comme lui, un faible pour les lectures dont je ne ressors pas indemne, de celles qui me renvoient à mes propres faiblesses ainsi qu’à la protéiformité du monde, de celles qui remettent en cause ma perception normée du réel. Pendant longtemps, j’ai voulu laisser intacte la littérature, ne pas en faire un objet de travail, afin d’en conserver la saveur et, surtout, le pouvoir de transformation. D’où mes études de philosophie, et, par la suite, mon travail d’éditeur en sciences humaines (aux Éditions Amsterdam). Quand Benoit est venu me proposer de monter une maison, je pense que j’étais enfin prêt à faire ce pas, à faire mon métier de ce qui est le plus important pour moi. Au passage, la référence à l’oignon que fait Benoit me touche particulièrement, parce qu’elle me rappelle une longue tirade de Peer Gynt dont je m’étais servie en exergue de mon mémoire de maîtrise sur Musil. J’avais d’ailleurs, à l’époque, hésité à travailler sur Gombrowicz, comme quoi, il n’y a pas de hasard...
En ce qui concerne le cheminement collectif, il a été simple : pendant des mois, nous nous sommes fait lire, beaucoup lire, afin de définir notre dénominateur commun littéraire le plus précisément possible (l’idée étant de ne faire que des livres qui nous bottent tous les deux).
L’« Irréalité  », à mes yeux, c’est le réel, en tant qu’il ne peut être qu’interprétation du réel, et que ces interprétations sont beaucoup moins normées qu’on ne le croit. Dans un vocabulaire nietzschéen, donc, une littérature de l’irréalité serait une littérature qui se donnerait pour ce qu’elle est, une interprétation du texte du réel, au plus près, avec tout ce que cela veut dire d’incohérences, d’éclatements et de restes que l’on ne peut ramener à une univocité, ce qui arrive toujours dès que l’on tâche de respecter les règles de la probité philologique, à savoir ne rien ajouter ou retrancher au texte.
Au début, et c’est justement ce qui définit peut-être au plus près notre ligne éditoriale, nous avions un autre nom en tête : les éditions du funambule. Encore une fois, une allusion à l’abîme, à l’idée (et, surtout, à la perception enfantine que nous partagions Benoit et moi) que nous sommes perpétuellement en équilibre précaire sur un fil, le mince fil de la normalité et de la santé mentale, et que nous menaçons en permanence de basculer.
Finalement, nous avons pensé à l’Ogre. Au-delà des conceptualisations a posteriori que nous avons pu faire autour de ce nom, très prosaïquement, nous avons pu vérifier que c’est un nom qui le suscite désir, le fantasme. Tout le monde sait ce que c’est, un Ogre, et pourtant, cela va de Shrek au Grand Autre. Benoit y voit d’ailleurs une sorte de piège, de duperie permettant d’engager le lecteur sur des chemins où il n’était pas au départ désireux de s’aventurer.
B. L . : Oui, un piège ! Comme le dit Aurélien, tout le monde projette quelque chose dans l’Ogre, sans que cela soit clairement défini et, souvent, on oublie sa dimension terrible. L’imaginaire lié à l’Ogre fonctionne comme une illusion, un souvenir d’enfance, ce n’est qu’après que l’on réalise qu’il est avant tout un mangeur d’enfant.
2. Début 2015, premières parutions pour L’Ogre. Pouvez-nous nous les présenter, ces livres qui paraîtront cette année ?

AB : Le premier titre que nous publions en janvier, Aventures dans l’irréalité immédiate, de Max Blecher, revêt une importance particulière pour Benoit et moi. :, C’est, en effet la lecture de ce livre qui a scellé notre association. Maurice Nadeau l’avait publié chez Denoë l en 1973, nous avons décidé de le faire retraduire du roumain par Elena Guritanu – la traduction initiale, si elle était belle, avait tendance à camoufler les bizarreries de la langue de Blecher, ce qui en faisait presque une belle étrangère –, et de le faire suivre d’un roman inédit du même auteur, Cœurs cicatrisés.
Aventures dans l’irréalité immédiate est l’histoire, à la première personne, d’un garçon d’une douzaine d’années découvrant le monde et la sexualité dans une petite ville roumaine. Plus précisément, il s’agit du récit hallucinatoire de la déformation de ses perceptions sensorielles, de la manière dont certains lieux, par exemple, saturent ses sens, provoquent des crises et déforment la perception qu’il a de son corps et du monde environnant. C’est une lecture avant tout corporelle, physique, et Blecher réussit, chose extraordinaire, à mettre des mots sur des expériences que nous avons tous plus ou moins faites enfants.
Cœur cicatrisé est une sorte de roman miroir, pour le coup largement autobiographique, qui met en scène un jeune Roumain d’une vingtaine d’années parti faire des études de chimie à Paris, découvrant qu’il est atteint d’une tuberculose osseuse et obligé de partir au sanatorium de Berck. Alors commence le douloureux récit de la déréalisation de son corps, de ce corps désormais malade, déliquescent. À la troisième personne, et plein de distance ironique vis-à -vis de son protagoniste, Cœur cicatrisés est, contrairement à ce que l’on pourrait croire, un roman très drôle, où l’on découvre une communauté essayant de vivre le plus normalement possible : les personnages font la fête, tentent d’avoir des relations amoureuses, etc. Il y règne la même ironie douce amère de La Montagne magique (si l’on en ôte l’intellectualisme) : une sorte de valse de quasi-fantômes, hors du monde, mimant de leur mieux les gestes des vivants.
BL : Oui tout à fait, j’aime beaucoup cette idée de danse macabre. En fait on a souvent considéré que Blecher était un surréaliste (il avait été apporté par Breton en France) mais pour moi Blecher est surtout un écrivain du corps malade qui nous offre deux visions radicale de son rapport au monde. La première, fiévreuse et halluciné, décrit la saturation provoquée par la découverte sensorielle et physique du monde et de la réalité physique des choses. La deuxième, est douloureuse, ankylosée, pleine des courbatures qui suivent la fièvre. On peut prendre de la distance, en rire comme le fait Blecher, mais cela ne suffit pas à faire disparaitre la souffrance et le terrible dessèchement de ce cœur cicatrisé.
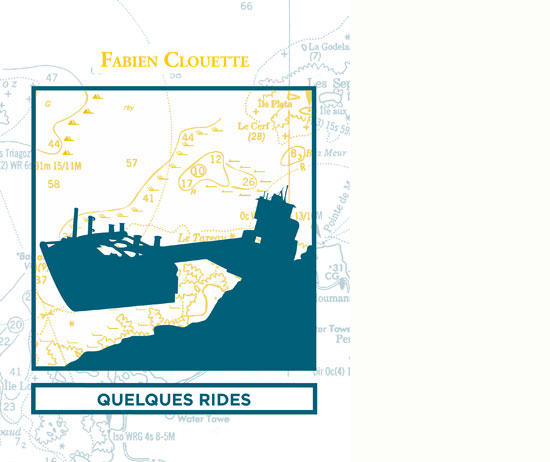
Le deuxième roman de ce « couple  » de la rentrée est un premier roman, écrit par un jeune cinéaste de 25 ans, Fabien Clouette. « Quelques rides  » est très important pour nous puisqu’il s’agit de notre première découverte en tant qu’éditeur. L’histoire est très simple : un jeune homme, Capvrai, légèrement habité par son frère cadet décédé quand ils étaient enfants, dirige l’hôtel que ses parents on construit en bord de mer dans ce qui pourrait être un petit village agrégé autour d’un cimetière marin. En attirant l’attention de la municipalité sur un terrain voisin, il va provoquer la construction d’un deuxième hôtel, satisfaisant les ambitions de développement de la communauté, et la destruction du sien, déserté par les clients. Victime d’une situation dont il est pourtant acteur, il va se débattre pour conserver ce qu’il peut, et commettre trois homicides, certains volontaires et d’autres non. Le récit de cette lutte nous est raconté par Cashon l’assistant médical du psychiatre chargé de l’évaluer pendant son procès.
Ce qui est très beau dans l’ambition de Clouette c’est qu’il nous restitue le récit de cette mutation de territoire dans un mouvement constant de perception où le lecteur est invité à suivre les lubies et focalisation du narrateur entre l’esprit torturé de Capvrai – personnage qui n’est pas sans rappeler celui de Mickael K, sa vie, son temps de Coetzee, toujours en marge, acteur passif en dehors des mécanique du monde – et les témoignages de ceux qu’il côtoie, entre un présent allongé et un passé flou, éclaté. Il s’ensuit une narration mouvante, ancrée dans des images rémanentes que le lecteur habite tout le long du livre. Finalement, au fil d’une tension très twinpeaksienne, et d’une langue tout en verticalité, Clouette fait surgir l’irréalité de ces quelques rides qui parcourent l’eau une fois l’objet coulé, une fois l’événement passé.
AB : Ce qui est extraordinaire, dans Quelques rides, c’est que la machine interprétative qui se met en branle devant toute fiction tourne à vide. Le lecteur, emporté par la tension qui anime le texte, une tension proche du polar, cherche en vain le secret, l’implicite, ce qui donnerait du sens aux actions des protagonistes. Mais il n’y a pas de secrets, tout est dit dans le résumé des faits des premières pages. Alors cette machine s’emballe, ce qui créé un espace cognitif où les images sont libres de se déployées. Si je devais défendre ce texte pour une seule raison, certes très subjective, c’est que ces images, des mois après ma dernière lecture, me hantent encore.

Puis en mars nous publierons deux ouvrages dont l’irréalité s’ancre avant tout dans la langue qu’ils déploient. Le premier, Dans la maison qui recule de Maurice Mourier est une relecture absurde et souvent très drôle du Château de Kafka qui emprunte énormément à la langue et à l’univers de Rabelais. Un peu comme le fruit d’une union monstrueuse, à la fois carnavalesque et inquiétant.
BL : Pour l’accompagner nous avons choisi de publier Ma fille folie de l’écrivain sarde Savina Dolores Massa, un roman étrange et drôle qui a fait scandale à sa sortie en Italie. Comme avec Dans la maison qui recule ce sont les rapports à la langue, à la religion et à la sexualité qui sont questionnées, cette fois-ci au travers de l’histoire d’une marginale dans un petit village sarde qui vie une maternité fantasmée.
Pour terminer ce tour d’horizon nous publierons en mai deux auteurs français. Data Transport, de Mathieu Brosseau, un jeune poète donc c’est le premier roman, raconte l’histoire d’un homme repêché par un cargo en pleine mer, ayant perdu la mémoire ainsi que l’usage de la parole. Au fil des pages, il va peut-être retrouver la mémoire, ou tout du moins s’en inventer une.
AB : Nous ferons très peu de réédition, mais nous n’avons pas pu résister à l’idée de republier L’Orage et la Loutre. Ce roman fantastique de Lucien Ganyaire, passé complètement inaperçu à sa sortie dans les années 1970, raconte l’histoire d’un homme qui se retrouve seul quand le monde se fige et le temps s’arrête.
La maison d’édition développe une identité visuelle assez forte (pas de photos, des dessins et des influences cartographiques...), quels ont été vos parti-pris graphiques ?
A.B. : Nous avons passé beaucoup de temps avec Benoit à élaborer une charte graphique qui nous plaise à tous les deux. Trois choses nous tenaient dès le départ à cÅ“ur : que ce soit joli, évidemment, au moins à nos yeux ; que ce soit aisément identifiable (« Oh, un nouvel Ogre !  ») ; et qu’il y ait un dessin. On tenait beaucoup, beaucoup au dessin.
B.L. : Et puis il y avait le format aussi, on voulait quelque chose de trapu et généreux, avec des marges, et de l’espace.
Pour le logo ça a été simple on voulait une bouche… L’idée du graphisme des couvertures est quant à elle venue lors d’une visite à la librairie Le Monte-en-l’air où je suis tombé sur un très beau livre reprenant des couvertures de romans américains des années 1870-1910. L’idée de la première de couverture, du carré et du cartouche fonctionnant avec des aplats vient de là . Il fallait aussi retrouver la matière des couvertures en tissus sans que cela soit répétitif et coà »teux, l’idée d’un fond graphique s’est imposée comme ca.
Puis nous avons commencé à travailler avec Arthur Pumarelli sur des déclinaisons possibles et son dessin nous a plu. Il lit tous les textes, et nous discutons ensemble de ses propositions, qui sans avoir de vocation illustratives, ont pour but de créer une sorte d’écho au texte. Chaque couverture fait l’objet un choix de couleurs et de plusieurs dessins, la seule constante, qui vient d’Arthur, est le détournement graphique d’un élément animal, végétal ou mécanique tiré d’anciennes planches d’illustration scientifique et technique. En fait le dessin principal devient presque un leurre parce qu’il s’amuse a glisser dans chaque couverture des clefs graphiques qui interprètent beaucoup plus le texte que l’illustration elle-même. Par exemple le fond graphique de Blecher est un papier peint composé exclusivement d’ophiures (un échinoderme, voisin des étoiles e mer) et la carte de « Quelques rides  » s’anime avec les différents indices de l’échelle de Beaufort auquel le titre du livre fait référence…

Le site de l’Ogre.
Présentation des livres sur le site.