Mireille Gansel : Traduire comme transhumer
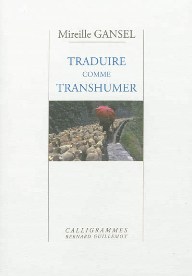
Le livre se compose d’une vingtaine de petits textes, qui dessinent une passionnante autobiographie de traductrice : depuis la scène inaugurale d’une lettre lue en hongrois et traduite par le père, au dernier ouvrage traduit, celui de l’ethnologue Eugénie Goldstern, née à Odessa en 1884. Chacun de ces textes relate une avancée dans la compréhension de ce que signifie la tâche du traducteur, accompagnée par la conviction, tôt acquise, de ce qu’ « aucun mot parlant de l’humain n’est intraduisible ».
La traductrice ainsi est celle qui franchit les distances – transhume –, part à la rencontre de l’autre, pour une intelligence plus fine de sa langue, de chacun de ses mots. Ces rencontres jalonnent l’ouvrage, faisant revivre en quelques traits les figures de Hélène Weigel, des poètes Reiner Kunze et Peter Huchel, au cœur d’une RDA muselant leur parole, mais également celles des poètes vietnamiens, tels Xuan Dieu, qui l’accueillent alors qu’elle participe au projet d’une anthologie de la poésie vietnamienne entendant témoigner de la culture plurimillénaire du Vietnam – en réponse à la terrible menace de Mac Namara : « on réduira ce pays à l’âge de pierre ».
Qu’est-ce que traduire ? Nulle réponse théorique n’est ici apportée à la question : on suit pas à pas, de voyage en voyage, la traductrice confrontée dans sa tâche quotidienne au « comment traduire » : comment traduire le terme « sensibel » dans le titre « Sensible Wege » du recueil de Reiner Kunze ? Comment traduire le vietnamien, son chant, sa culture ? Comment traduire Nelly Sachs, enfin, chemin le plus périlleux peut-être, sans aucun recours à l’auteure, dont l’allemand dit le désastre de la Shoah, et recèle, en son cœur, la lumière intacte de l’hébreu.
Pour chaque œuvre, Mireille Gansel se met en chemin, avec une patience, une ouverture à l’autre, une humilité dont rend compte, dans chacun de ces petits textes, son style précis, sans emphase – justement sensible.
Portrait de traductrice, ce livre est également porteur de la nostalgie d’une langue, l’allemand parlé en Europe centrale avant-guerre, non pas le « pur » allemand prussien, mais un allemand mêlé d’accents et de tournures, langue métisse évoquée lors d’une rencontre avec Imre Kertesz :
« Bien des années plus tard, dans un café de Berlin, il m’expliquera qu’il écrit en hongrois mais qu’il pense toujours dans cet allemand de l’empire austro-hongrois. Cette langue « supra-nationale », sans frontière, trans-frontière, dans laquelle il avait grandi. Territoire inaliénable qu’aucun barbelé, aucun mirador n’auront pu réduire, ni enfermer. Qu’aucune barbarie n’aura pu enténébrer. »
Traduire comme transhumer c’est, semble-t-il, partir en quête de ce territoire inaliénable : aller vers l’autre pour l’accueillir. [1]