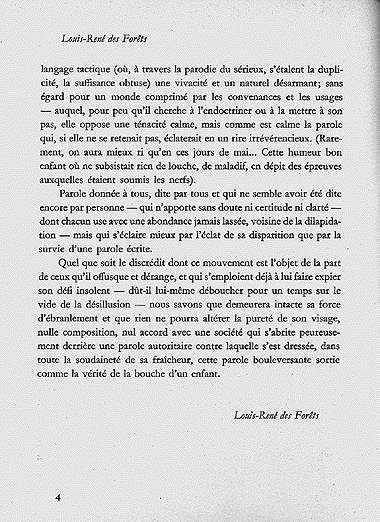document 2 : L'Éphémère, n°6, été 1968, pp. 3 et 4
Le seul texte publié par des Forêts dans la revue L'Éphémère
(qu'il avait fondée
avec Bonnefoy, du Bouchet, Celan, Dupin, Leiris et Picon). Ce document
figure sur le site de la
petite bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères,
où figure le dossier (téléchargeable) réalisé
par Dominique Rabaté sur Louis-René des Forêts.