Pierre Autin-Grenier / Une entrecôte drôlement politisée
pour saluer fraternellement Jean-Claude Izzo, toujours présent
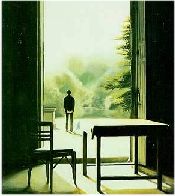
|
Pierre Autin-Grenier / Une entrecôte drôlement politisée pour saluer fraternellement Jean-Claude Izzo, toujours présent
|
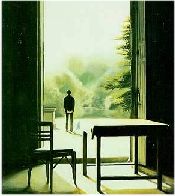 |
| Pierre Autin-Grenier poète, écrivain a publié des recueils de poèmes, des nouvelles et des récits. Les derniers livres sont parus à l'Arpenteur : Je ne suis pas un héros (1993) et Toute une vie bien ratée (1997). |
|
|
UNE ENTRECÔTE DRÔLEMENT POLITISÉE Onze heures et demie, je dégringole l’escalier et fonce
chez le boucher pour attraper l’entrecôte que je compte fricoter
à midi à la marchand de vin ; je tombe dans la boutique
sur François Mitterrand en train de discuter le bout de gras avec
un type que, de prime abord, je ne reconnais pas. Pour sûr ce n’est
ni Beckett ni Cioran, plutôt un aigre fausset à la Guitton
et des propos qui vont avec ; “Deux bons doigts dans l’entrecôte”
je dis au boucher un rien amusé de me voir, l’air intrigué,
tendre l’oreille par-dessus ses rillettes pour tenter de saisir quelques
bribes du bavardage ambiant. En cinq-six coups secs de hachoir dans ma
bidoche sur son étal il me saucissonne complètement les
derniers mots du Président et maintenant c’est la petite musique
de fin d’émission ; “Une page de publicité avant
la Bourse” annonce l’animatrice dans l’enceinte accrochée
au mur sous un effrayant massacre de cerf d’au moins dix cors. Plaisante
magie des archives radiophoniques qui permet d’entendre, comme en
public et en direct, l’ancien Président disserter d’outre-tombe
du Temps et de l’Éternité avec un philosophe stéphanois
mort lui aussi cependant que votre boucher, la mine réjouie, essuie
ses mains sanguinolentes au pan de son tablier : “Emballez, c’est
pesé! Et avec ça ? ” Ma grand-mère Jeanne, morte inopinément à un poil de ses cent ans, n’a pas vu non plus, sous son bibi à plumes et son chignon à épingles, printemps ni étés passer et son bel âge, comme ça, d’un coup d’aile s’est envolé avant qu’elle n’ait seulement songé une seconde à voyager. Mais ses vingt ans étaient temps des charrettes à bourricot bien sûr et, canuse toute l’année vissée à sa mécanique Jacquard sous l’oeil américain du contremaître et la poigne de fer d’un patron à lorgnon, quelle sortie de secours aurait-elle pu s’inventer pour échapper à l’incendie de toute une vie ? François Mitterrand n’était même pas encore né à l’époque, mon boucher non plus et mon entrecôte itou, mais le capitalisme n’avait pas attendu pour faire déjà pas mal de dégâts dans le camp du prolétariat. Grand-mère, elle aurait pu s’acoquiner avec Lénine, elle était de la classe 70 elle aussi, et avec lui faire du chambard pour changer tout ça. Mais à force de répéter “A quoi bon ?” et toujours attendre de meilleures occasions, 36 est passé, 68 par-dessus le marché et grand-mère m’a laissé, orphelin de la Révolution, à croupetons au pied du canapé sur la moquette du salon avec seulement un vieux Dylan à l’harmonica dans les oreilles et le poster noir et blanc du Che pour rêver. ! Nuestra Revolucion es eterna ! “Salut, camarade mémé !” je dis quand même en sifflant une dernière bière et, merci, ça sera tout pour aujourd’hui. Comme je remonte à pinces l’avenue Pierre Overney, en quête une fois de plus d’un tabouret de bar et d’un paquet de tabac, me voilà secoué soudain de violents tiraillements d’estomac. Tout un régiment de chasseurs d’Afrique, en continu crache mitraille au fond de mes entrailles et pas pour le plaisir de la rigolade, croyez-moi, mais bien pour mettre en capilotade toute ma machinerie intérieure avec ferme intention de l’amener à prompte capitulation ; encore quelques pruneaux de ce calibre dans la brioche, je rends mon tablier et je suis cuit. C’est la reddition en rase campagne et le corbillard en cinq sec pour le crématorium du coin. Roulant à longueur de journée ma mort entre mes doigts, j’avais jusque-là plutôt envisagé de quitter sur la pointe des pieds cette planète pourrie en vomissant dans l’évier des restants de poumons mélangés à des morceaux de cibiches ou tout autre agonie du même acabit mais je n’avais encore jamais imaginé pouvoir crever dans la rue d’une espèce de guerre d’Algérie en plein ventre. Je ne pouvais raisonnablement mettre en cause la digestion d’une entrecôte sortie tout droit de chez un boucher branché en permanence sur France Culture ni même les digressions de Jean Guitton pour endormir la roublardise de Mitterrand ; non, la situation douloureuse dans laquelle je me trouvais résultait à n’en point douter de tous ces “A quoi bon ?” accumulés, de toutes les occasions manquées, du temps trop vite passé par là-dessus telle une flambée de carnaval et, surtout, d’un manque de projet révolutionnaire sérieux susceptible de solidement décider de mon quotidien. Ayant réussi quand même à dégoter un tabouret de bar où m’accorder une trêve entre deux convulsions, accrocher un instant au zinc mes tripes et mes crampes, j’allumai une clope et ce n’est pas tout, je me dis en faisant signe au garçon pour un ballon de blanc, il est temps maintenant d’engager l’action. Retourner l’entrecôte telle une vulgaire crêpe et reprendre toute l’histoire du début ?… Si vous en avez le courage, pourquoi pas ?, moi je veux bien. Mais alors de quelque côté qu’on la saisisse, pile ou face, de quelque façon qu’on l’accommode, Bercy ou Bordelaise, rouge ou blanc, cela ne semble devoir y changer ni couic ni couac, vous comprenez. C’est alors que me traverse la cervelle comme la tige pointue d’une brochette l’idée pourtant bien évidente de regarder à travers mon entrecôte pour voir d’où elle vient vraiment ; qui sont ses parents, quel a été son milieu naturel, a-t-elle été heureuse dans sa plus tendre enfance ?, enfin toutes ces données élémentaires qui font qu’on peut se montrer fière par la suite d’être devenue une belle et honnête entrecôte pardi ! Parce que c’est bien les choses qui sont derrière les choses qu’il faut aller regarder de près et non se contenter des simples apparences bien sûr. Ce qui m’est révélé ainsi d’entrée m’étourdit d’étonnement et bientôt me mène, de surprise en surprise, jusqu’à l’enchantement. Au pied du Vésuve, là-bas sous le ciel d’Italie, dans un bistrot proche du port et des bateaux, son papa barman napolitain derrière son comptoir entre deux cappuccinos joue à l’harmonica Bella Ciao. Peut-être il s’appelle Gennaro ? Sa maman, jadis couturière du côté de Madrid, a connu Durruti et même fait, dans l’ardeur des luttes, un petit bout de chemin avec lui ; sur une chaise dans un coin du café elle ravaude des chaussettes avec un oeuf à repriser. Peut-être elle s’appelle Isabelle, ou alors Dolorès comme la Pasionaria, allez savoir ! Et puis, plus j’écarquille les yeux pour mieux voir à travers cet extraordinaire miroir magique d’entrecôte, plus se dessine nettement un arbre généalogique aux fabuleuses racines traçantes qui s’étendent d’une terre l’autre, de Dunkerque à Tamanrasset, d’Istanbul Lisbonne, avec au bout des branches des Nazim d’Ankara, des Fatima de Tizi-Ouzou, des Hassan de Tanger, Bachir de Beyrouth, Yannis de Malvoisie et même un Jean-Claude, poète à Marseille que je reconnais à sa gueule pas possible d’écureuil étonné sous ses cheveux au vent ! Vrai, je me dis, si mon boucher voit ça les bras lui en tombent. Gennaro, Isabelle, Dolorès, Nazim, Fatima, Hassan, Bachir, Yannis, Jean-Claude ! Quand toute cette tripotée de pingouins, plus quelques autres encore, a traversé d’un même élan et sans autre formalité mon entrecôte pour débouler telle quelle dans ma carrée, croyez-moi évadé du pavillon des agités si vous voulez, mais je vous fiche mon billet que ce fut d’un coup 14 Juillet et sacré rigodon dans toute la maison ! On a dégringolé chez le boucher pour du gîte à la noix et du paleron et concocter ensemble un méga boeuf bourguignon ; dans son enceinte accrochée au mur sous le massacre de cerf, la Bourse venait brusquement de s’effondrer. Extrait de “L’Éternité est inutile” (à
paraître)
|