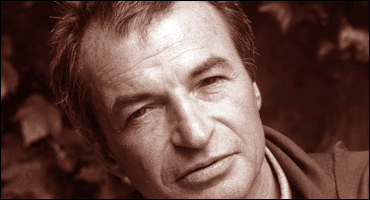
retour remue.net
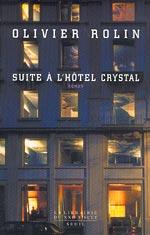
François
Bon / salut à Olivier Rolin
Comme Jean Echenoz ou Pierre Michon, ses amis, ou son propre frère,
Jean Rolin, Olivier Rolin est un auteur nécessaire parce
qu'il est avant tout inventeur de formes. Il exige de l'écriture,
pour qu'elle déploie son champ narratif, d'investir un territoire
formel de sa relation au monde qui n'ait pas de précédent,
et que l'enjeu littéraire ou formel, ou politique, ou géographique
de cette relation soit énonçable. Ainsi, de Port Soudan
à L'Invention du monde via Phénomène
Futur nous avons suivi Olivier dans des projets chaque fois comme
une idée qu'on aurait dû avoir chacun, depuis longtemps.
La différence, c'est que lui il l'a eue!
Ainsi de Tigre en papier, quand bien même aucun de nous
n'avait vue si rapprochée
et si intérieure de ces mouvements de l'après 68, dans cette
déambulation nocturne de la DS 19 révélant Paris
dans son fantasme benjaminien de la ville de toutes les révoltes
possibles, même si non accomplies.
Ainsi de cette Suite à l'Hôtel Crystal qui vient
de paraître: où la narration s'ancre sur les mille chambres
traversées (ou censées l'être) dans toutes les errances,
confins du monde, bords de Bretagne ou salon du livre de Brive. Et chaque
fois, par un glissement lui-même explorant à la Perec l'ensemble
possible des figures d'emboîtement, Rolin se reconstruit en
tant que narrateur via une figure prise à l'ensemble du kaléidoscope
romanesque, où les personnages deviennent peur à peu récurrents
- alors c'est notre confiance dans le réel qui devient l'objet
de miroitement, de doutes...
Quant à ceux que l'endurance, la solidité des frères
Rolin épate toujours, ils seront moins surpris que beaucoup
d'autres du texte ci-dessous, la fenêtre du petit bureau face à
la mer (Olivier Rolin navigue en Bretagne par tous temps), dialoguant
de façon si intime avec les ouvertures de Claude Simon (celle des
Géorgiques par exemple).
FB
NOTA: la réflexion sur le visuel de ce texte fait que je résiste
à la tentation de l'accompagner d'une image - mais on se reportera
au n°3 des Cahiers de l'école de Blois..
Olivier Rolin sur Internet
![]() sur remue.net, entretien Yves Charnet - Olivier
Rolin paru dans le n° 14 de Scherzo
sur remue.net, entretien Yves Charnet - Olivier
Rolin paru dans le n° 14 de Scherzo
![]() aux éditions Verdier, dossier La
Langue, d'Olivier Rolin
aux éditions Verdier, dossier La
Langue, d'Olivier Rolin
![]() à propos de Tigre
en papier, un entretien sur le site Ombres Blanches
à propos de Tigre
en papier, un entretien sur le site Ombres Blanches
![]() un numéro spécial de la Femelle
du Requin, entretien, plus un inédit
un numéro spécial de la Femelle
du Requin, entretien, plus un inédit
![]() Jean-Claude
Lebrun à propos de Tigre en papier
Jean-Claude
Lebrun à propos de Tigre en papier
![]()
Vue de ma table de travail
© Olivier Rolin
Il y a un premier plan, au centre de quoi rayonne l’écran de l’ordinateur où s’inscrit la description du premier plan: c’est à travers (ou à la surface de) ce rectangle opalescent que les choses vues essaient de passer dans les mots, de se transformer en mots (mais « ces deux mondes sont étanches », selon Francis Ponge). A gauche, un pan de mur perpendiculaire. Perpendiculaire à quoi ? Aux « plans » arbitrairement, et virtuellement, découpés. Perpendiculaire à l’horizon. Des lambeaux d’un papier peint ancien, entre le blanc crème et le bleu horizon, justement, ont été intentionnellement conservés jusqu’à une hauteur d’environ 1 mètre sur ce mur, peint en blanc au-dessus, et sur lequel est accrochée (mais je n’en vois que le coin inférieur gauche) une reproduction du « Fort carré d’Antibes » par Nicolas de Staël. Je n’en vois que le coin inférieur gauche, mais je sais qu’il y a des gris de plomb, des blancs plumeux, des bleus qui répètent ceux du « petit pan de mur » et aussi ceux du paysage marin au 3è plan. L’ordinateur est posé sur un panneau de bois sombre (une porte couchée sur des tréteaux) revêtu d’une plaque de liège. A sa gauche il y a un téléphone d’un modèle assez ancien, bleu, et un répondeur noir, de modèle « Fidelis 6800 », hideux, évoquant quelque chose entre une pierre tombale et la représentation traditionnelle des Tables de la Loi. A sa droite une lampe de bureau à abat-jour noir hémisphérique est fixée par une pince au bord de la table. Une boîte de thé Earl Grey de la Compagnie coloniale sert de pot à crayons et stylos. Deux couteaux pliants, une gomme, un flacon à pans coupés d’encre Waterman noire, diverses feuilles de papier sur lesquelles reposent une paire de lunettes à monture métallique et un taille-crayon en forme de sous-marin fabriqué en République populaire de Chine, un petit carnet de notes édité par la BN et dont la couverture est illustrée par une photo de divers manuscrits de Valéry, Apollinaire, Diderot, Butor, Jankélévitch, Brantôme, Aragon, Chateaubriand, une carte postale représentant la baie vue de l’autre côté (regardant donc vers le point d’où j’observe et décris), sont posés sur la table et complètent le premier plan.
Le second plan (ou ce qu’il me plaît d’appeler ainsi) est constitué, à environ cinq mètres de moi, par le mur de la maison, percé d’une porte-fenêtre vitrée et d’une fenêtre à deux vantaux. En-deçà, à l’intérieur, tout est immobile (sauf les lettres qui avancent sur l’écran de l’ordinateur, et ma main sur le clavier), au-delà, à l’extérieur, tout ou presque est mobile (sauf la ligne de la côte de l’autre côté de la baie). Tout à fait à gauche de ce plan, j’aperçois un bout d’une bibliothèque réservée aux écrits maritimes, et dont les rayons supportent, outre les livres, un bric-à-brac de menus objets liés à la navigation (maquettes à quatre sous, jumelles etc.). Puis un fauteuil de rotin à moitié démantibulé, blanc, sur lequel sont jetés des nattes de plage (fabriquées, comme le taille-crayons, en République populaire de Chine), un sac de couchage roulé, rayé de bleu roi et de blanc, et un Panama à ruban noir venant de chez Christy’s à Londres. Sur le pan de mur au-dessus de ce fauteuil est accroché un dessin botanique représentant une plante dont le nom m’est inconnu (mais il se pourrait bien qu’il s’agisse de cannabis), à longues feuilles lancéolées et menues fleurs bleues en grappe ; ce dessin est collé sur un carton bleu, et encadré de bois sombre. Au-delà s’ouvre la porte-fenêtre à six rangées de trois petits carreaux, tenus par une huisserie de bois marron assez moche. L’embrasure est encadrée d’une moulure peinte en gris clair (le mur lui-même est blanc). A droite de la porte, retenus de tomber par l’angle curviligne que forme avec le mur une table ronde, sont appuyés quelques bâtons de marche ; l’un d’eux est une branche de bouleau que je me souviens parfaitement avoir coupée en 1992, en Lozère, alors que j’écrivais une série de petits textes sur des objets naturels de la Margeride: j’y suis assez attaché ; un autre est une canne dans un style afro-pacotille, dont la poignée est constituée par un tigre peinturluré (Mobutu en avait des comme ça, en mieux assurément). La table ronde, marquetée dans un style arabisant, porte une boussole chinoise, une paire de jumelles, et un grand pot de verre dans lequel sont plantés des rameaux de saule très sinueux, frisés (je les trouve eux aussi assez « chinois »), portant encore quelques chatons duveteux, et deux grandes « éoliennes de plage » en plastique, l’une rose l’autre verte (je ne sais pas, ou bien j’ai oublié, le nom de ce jouet ; un ami que je consulte au moyen du téléphone bleu précédemment évoqué me suggère qu’il pourrait s’appeler « moulin à vent », c’est bien possible et pourtant ce nom n’a pas l’évidence du temps retrouvé); lorsque le soleil les frappe (mais ce n’est pas le cas en ce moment), leurs pales vrillées jettent sur les murs des reflets diaprés ( qui m’évoquent les « lichens de soleil » du Bateau ivre). Sur le mur au-dessus de la table est accroché un dessin, encadré d’une baguette de bois clair, représentant un Iris Xyphioides – Iris faux – Xyphium . A droite s’ouvre la fenêtre, à l’huisserie peinte en gris, et dont l’ embrasure est encadrée, comme celle de la porte, de moulures grises. Sur l’appui sont posés une coupe de bois sombre, une bouteille de verre blanc contenant des morceaux de verre polychromes, usés par la mer (ces fragments de verre poli et les « éoliennes de plage » m’évoquent très vivement mon enfance), une « jeannette » en bois, massive (je ne suis pas sûr que ce mot soit encore bien compréhensible), un bouquet de fleurs sèches dans un pot de porcelaine gris, et un petit tableau encadré de bois noir, très laid, mais auquel je tiens parce qu’il m’a été offert en 1997 par un peintre, en Sibérie, et qui représente un paysage du lac Baïkal ( avec des vagues couleur d’huître comme celles que j’aperçois au « troisième plan »). A droite de la fenêtre, une armoire rustique en bois sombre.
Pour être complet, pour être honnête avec les choses il faut ajouter qu’entre le « premier » et le « second » plan , arbitrairement choisis, construits (pas tout à fait arbitrairement : le premier plan peut être dit tel parce qu’en effet, en deçà de lui il n’y a rien ; quand au « second », il est la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, ou encore, je l’ai dit, ce qui est essentiellement immobile et ce qui est essentiellement mobile ; ce sont plutôt les limites de ces « plans », l’épaisseur que je leur donne, qui sont arbitraires et construites), entre le premier et le second plan donc s’étend un espace interlope où s’entasse de gauche à droite un fourbi consistant en : un bout de table ronde métallique, blanche, une chaise pliante blanche, deux fauteuils genre transat sous la fenêtre, une table ovale en acajou dite « de bateau », un fauteuil d’osier à coussins de jeans bleus, un tapis de laine blanche, ou qui l’a été, plusieurs gravures et un manteau de cheminée en bois sombre portant une maquette de bateau sous verre, devinés plutôt qu’aperçus tout à fait à droite de mon champ visuel.
L’extérieur, le règne du mobile, se laisse voir d’abord, à gauche (« d’abord » parce que je décide, pour les besoins du « passage en mots » qui s’opère dans le rectangle opalescent au centre du premier plan, que la description va aller dans ce sens), à travers les carreaux de la porte vitrée (qui projettent d’autres rectangles lumineux sur les dalles grises du sol). De bas en haut, quatre bandes : les dalles inégales de la terrasse, que l’eau d’une averse récente fait briller sous le soleil revenu. Au-dessus, la mer, où « maint diamant d’imperceptible écume » scintille dans un gris-vert qui, je l’ai dit, évoque la chair d’une huître ; des coffres ou corps-morts (qu’ici les gens appellent « tangons », mais le mot est impropre) y font de petites taches d’un rouge vif ; sept bateaux de pêche y sont au mouillage, ainsi que quelques barcasses appelées ici « plates », leurs étraves unanimement dirigées vers la droite (l’Ouest) sous l’action combinée du vent de Sud-Ouest et de la marée descendante ; les coques des bateaux de pêche sont peintes de bandes, diversement conjuguées, de bleu, de vert et de blanc ; l’extrémité de la branche d’un rosier, ainsi que le sommet hirsute, un peu balais de chiottes, d’un genêt, se découpent sur ce fond (et masquent en partie les bateaux) ; les feuilles du rosier, vertes pour les plus anciennes, rouges pour les toutes récentes, frémissent dans le vent ; je distingue trois boutons ; le rosier grimpe contre le mur de la maison tandis que le genêt pousse sur la pente en-dessous de la terrasse ; les rameaux du genêt sont animés d’un mouvement d’oscillation beaucoup plus lent que celui, vif, des feuilles du rosier ; toute cette bande est barrée horizontalement par un garde-corps en alu (assez moche). Au-dessus, la côte de l’autre côté de la baie, où des champs recouverts de plastique brillent comme du papier d’alu sur un fond vert sombre ; tout à fait à gauche, un peu en avant de la côte, un îlot en forme de bernique, sur lequel les marées hautes ont laissé une trace noire ; à droite un banc de rochers très plats, à peine émergeants, dessine une ligne noire un peu dentelée. Encore au-dessus le ciel qui de ce côté (vers l’Est) est encore sombre, couleur plume de pigeon (tandis qu’à travers la fenêtre, vers l’Ouest, il est bleu avec, au-dessus de l’autre rive, des cumulus d’un blanc nacré). « En haut du ciel», si je puis m’exprimer ainsi, se découpe l’armature rouillée d’une petite marquise ; des vitrages dépolis, plusieurs cassés, y sont sertis.
Le temps que je résolve (tant bien que mal, plutôt mal que bien, à mon avis) quelques problèmes techniques posés par cette description (comment rendre compte à la fois de l’étagement vertical, plan, des quatre bandes formées par la terrasse, la mer, la côte et le ciel, mais aussi de la profondeur qui éloigne le genêt, etc., de la branche de rosier ?), le temps que j’essaie de résoudre ces problèmes, donc, le temps a changé, et le ciel vu par la fenêtre, à droite, n’est plus bleu et nuageux, mais uniformément gris (illustration de la mobilité dont l’extérieur est le domaine). La côte en-dessous est divisée en une bande supérieure grise, plus éloignée, sur laquelle il pleut déjà, et un premier plan de rochers fauves crêtés de quelques pins vert sombre. La mer est d’un gris-vert qui m’évoque le bronze (ou bien qui est peut-être ce qu’on appelle, au sens propre, « glauque »). Elle est à demi masquée par la coque en plastique bleu d’une annexe retournée, et par la lame droite et mince d’un safran, une épave trouvée en mer, peinte en rouge sang de bœuf, appuyées toutes deux contre le garde-corps bornant la terrasse. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre on voit la palissade de paille, rendue grise par les intempéries, qui sépare ma terrasse de celle de la maison voisine, et, en dessous, les feuilles longues, d’un vert un peu rongé de jaune, d’un massif d’agapanthes.
Cela c’est ce qui est « sous mes yeux ». Mais on peut penser (je pense) que ce que je vois est fait aussi de ce que, stricto sensu, je ne vois pas, mais dont je sais la présence et dont ma mémoire rétablit l’image : derrière moi, une bibliothèque et, sur un rayon de cette bibliothèque, une gouache sur papier et une peinture sur bois qui représentent, l’une assez naïvement, imitant une carte postale, l’autre dans un style qui ressemble à celui de Nicolas de Staël (et notamment du « Fort d’Antibes »), des vues de la baie ; de l’autre côté du mur (« second plan »), une clématite en fleurs ; à gauche de la porte vitrée, la cale du petit port de pêche et, de l’autre côté de la baie, la pointe avec trois îlots dont l’un porte un phare ; à l’arrière des bateaux de pêche, leurs noms, dont certains me plaisent (« Samedi soir », « Hermione », « Apocalypse »…) ; à droite, derrière la palissade de paille, la ville de P. : avec la digue du port qui semble une muraille et deux clochers qui ont l’air de minarets, elle m’évoque une vue d’un port de Turquie (Antalya ?) figurant dans le cartouche d’une carte marine dressée au XIXè siècle qui se trouve dans ma chambre à Paris. Idéalement, au-delà de ces points invisibles mais présents, on peut de proche en proche convoquer le monde entier. Pratiquement on s’en abstient, et le paysage en reste là.
© Olivier Rolin