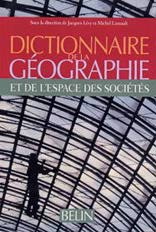
à propos de "l'urbain sans figure"
Michel Lussault est géographe. Parmi ses plus récents travaux, en collaboration avec Jacques Lévy, un Dictionnaire de la géographie qui, à l'instar du Dictionnaire Littéraire chez PUF, s'impose déjà comme un référent par sa façon de réviser et redisposer les concepts essentiels, qui nous servent à dire l'espace, la ville, le territoire du quotidien.Le rapport personnel qu'a Michel Lussault pour Balzac ou Georges Perec n'y est pas pour rien.
Il a fondé à Tours la Maison des Sciences de l'Homme, villes et territoires.
Le texte qui suit est la courte introduction à une réflexion sur "l'urbain sans figure". Paradoxalement, cette introduction s'appuie sur six brèves visions descriptives de figures de l'urbain, ou l'urbain avec figures, dans une marche qui n'est pas qu'historique.
L'étude dans son intégralité sera publiée prochainement aux éditions de la Découverte. Parce que cette introduction et ces concepts concernent de très près le travail littéraire, depuis Walter Benjamin jusqu'à Georges Perec ou Gracq, et ce que je dois, pour ma propre approche de la ville, à l'amitié de géographes, dont ML, je le remercie de cette autorisation de mise en ligne, en avant-première, d'une réflexion aussi proche de nos chantiers de la langue.
F Bon
Perec géographe ? grâce à Lussault et Levy, Georges Perec a sa propre entrée dans le Dictionnaire de la géographie, nous reproduisons l'article
Michel Lussault / l'urbain
sans figure
une introduction

Abraham Boss, Remise de Mantoue à Charles de Gonzague Nevers
1
Soit une gravure d’Abraham Bosse, Remise de Mantoue à Charles
de Gonzague-Nevers. Datée de 1631, elle fait partie d’une
famille de gravures qui montrent un grand personnage, au premier plan,
souvent à cheval, accompagné de sa suite et regardant le
destinataire, assiéger ou prendre possession d’une ville,
qui se tient à l’arrière-plan, fréquemment en
contrebas, le spectateur la voyant ainsi en surplomb, de façon oblique.
Abraham Bosse en a gravé plusieurs de ce genre. Peu importe ici
l’épisode auquel il est fait référence — en
l’occurrence la récupération par le duc de Nevers, à la
faveur de la trêve de Ratisbonne et de la paix de Cherasco, de la
ville de Mantoue dont les impériaux l’avaient auparavant privé.
Ce qui m’intéresse, c’est de signaler que Mantoue se
présente sous la forme d’un archétype visuel, celui
du « portrait de ville » (sans doute assez éloigné de
la réalité topographique et physionomique de Mantoue) : une
cité, regardée comme un paysage, ceinte de murs, au bord
d’une rivière, compacte, mais avec des jardins et des enclos
non bâtis, hérissée de clochers. Le portrait de ville
fut une figure des plus prisées et l’on ne compte plus ses
occurrences, soit comme sujet iconographique principal, soit comme élément
d’une composition plus vaste. Produit en série, sa diffusion
fut considérable, à l’échelle du monde européen.
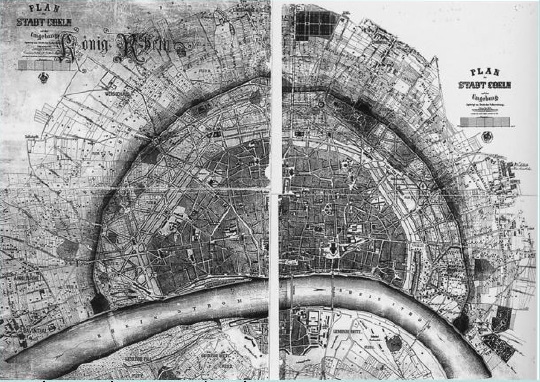
Joseph Stubben, plan d'extension de la ville de Cologne
2.
Soit un document de 1880 : le plan d’extension de la ville de Cologne,
proposé par Joseph Stubben, qui remporta en 1881 le concours destiné à définir
les modalités d’aménagement de Cologne, ville confrontée à une
expansion spatiale non contrôlée, à une industrialisation
importante, à une dynamique démographique et sociale bousculant
de fond en comble la société citadine classique. Le travail
de Stubben s’inscrit dans un ensemble de grande ampleur : celui des
plans directeurs de grandes villes mis en place par les autorités
afin de maîtriser une croissance dont on avait pris conscience qu’elle
subvertissait les cadres de la ville du XVIIIe siècle. La réponse élaborée
par Stubben aux problèmes de Cologne articule les deux entités
au moyen d’un Ring semi circulaire butant au nord et au sud sur le
Rhin. Il délimite ce nouvel ensemble par une seconde ligne semi
circulaire, parallèle au Ring et qui sépare l’espace
urbain (composé de la vieille ville et du périmètre
urbanisable dégagé, par la libération des emprises
militaires, les deux associés via le Ring) de l’espace rural
et agricole, dont on reconnaît le parcellaire caractéristique.
Il « irrigue » l’ensemble urbain de larges avenues rectilignes
convergeant vers des « places de circulation » à partir
desquelles s’organise tout un réseau viaire qui distribue
la circulation urbaine et périurbaine. Cette image est un second
témoignage d’un ordre figuratif où, bien que les signes
des mutations en cours soient flagrants, les destinateurs comme les destinataires
s’attachent encore à ce qu’existe une ville ordonnée
et délimitée.
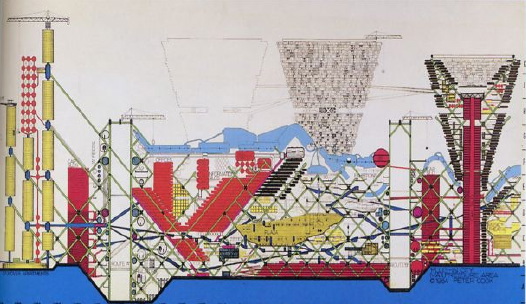
© Archigram, Plug in the city
3
Soit un document célèbre produit par le groupe Archigram,
en 1964, intitulé Plug in City. On y voit non pas une totalité,
mais un fragment, en coupe, d’une réalité urbaine étrange.
Les membres d’Archigram tentent de promouvoir l’idée
que l’urbain se constitue à partir de la connexion à l’infini
d’unités simples à d’autres unités simple.
Ils poursuivent ainsi le but de libérer l’architecture de
la contrainte de la ville (en tant qu’ordre préétabli)
et d’affranchir l’urbanisation dans son ensemble des contraintes
du territoire (l’espace préexistant). Ils proposent une grammaire
générative permettant de construire un système illimité et
homogène, décollé du sol et de ses contingences, dont
la généralisation finira par abolir toute structure, y compris
celle qui était à l’origine de cette mise en place.
L’urbain connecté serait alors partout et nulle part, labyrinthe
sans fin offert à la dérive sans entrave du citadin libéré des
pesanteurs passées : on peut donc l’offrir à la vue
non sous la forme du plan qui enserre et rassemble une totalité signifiante,
mais sous l’espèce d’une coupe verticale qui aspectualise
un agencement possible d’un fragment parmi d’autres, sans limites
ni seuil, puisque jamais on n’y entre pas plus qu’on en sort.

Valenciennes, vu d'avion
(© site mairie de Valenciennes)
4
Soit une série de photographies aériennes de l’aire
urbaine de Valenciennes. Elles nous montrent, en vue légèrement
oblique, prise d’une altitude assez basse pour que les détails
soient parfaitement visibles, un espace urbain peu dense et peu divers,
au moins dans cette apparence qu’il prend là, même en
centre d’agglomération, et marqué en particulier par
l’importance des voies routières et des ronds-points, omniprésents.
Un espace dont la limite est indécise, qui englobe à l’évidence
d’importants périmètres non-bâtis (jardins, friches,
bois, parcelles agricoles). Il s’agit d’une image caractéristique
de l’urbanité contemporaine française. On en trouverait
des milliers, des millions d’autres, comparables. Autant de témoignages
anonymes de l’existence d’une étendue urbaine qui paraît
discontinue et quasiment illimitée, homomorphe d’une localisation à une
autre ; à tel point que vu d’ici, de ce point haut, la notion
de localisation semble pratiquement sans intérêt pour appréhender
cet agencement spatial, ou en tout cas d’un intérêt
secondaire, ne saturant pas l’ensemble du jeu de référence.




Tokyo au quotidien, images F Bon, janvier 2004
5
Soit le film Lost in translation, de Sofia Coppola (2003), qui offre
de suivre la dérive urbaine de deux personnages, américains égarés à Tokyo,
où la déprime liée au dépaysement radical le
dispute à la douce euphorie de la rencontre amoureuse. Il n’est
pas douteux que Tokyo constitue plus qu’un décor mais un véritable
sujet du film — un quasi-personnage. Le film fait spectacle d’une
métropole insaisissable (un des protagonistes, lors d’une
superbe scène, observant Tokyo de la fenêtre de sa chambre
située à un étage élevé d’un hôtel
de luxe, échoue à comprendre visuellement l’agrégat
urbain qu’il contemple à ses pieds, ce que traduit le mouvement
oscillant de la caméra d’une extrémité du champ
de vision de l’héroïne à l’autre) en même
temps que saturée de lumières, de bruits, de mouvements,
offrant en permanence des sensations nombreuses et inédites. Bref
un milieu au sein duquel on s’immerge sans repères, sans qu’une
position de surplomb ne permette de se donner des cadres, d’identifier
des lignes de force.

New York, le 11 septembre 2001
6
Soit, enfin, un quelconque reportage sur un fait de guerre se déroulant
au sein d’une organisation urbaine : Groznyï, Bagdad, Kaboul,
Gaza aujourd’hui, Sarajevo, Beyrouth hier et l’on ne serait
pas en peine, hélas, d’allonger la liste, à laquelle
on pourrait ajouter les images des grands accidents urbains, des catastrophes
amples, qui marquent de leur présence continuelle les flux médiatiques.
Partout les mêmes images, filmées en général
par un caméraman en déplacement, traversant le champ de ruine
: des bâtiments béants, des places saccagées, des débris
jonchant partout le sol, des véhicules calcinés ou en feu,
des routes éventrées, des citadins exténués
et traumatisés, des traces de sang, des cadavres, des traces d’une
vie quotidienne dévastée et des signes d’une débrouille
généralisée afin de survivre. Un chaos, chaque jour à nos
yeux présenté, et dont les images, prises de plus en plus
souvent par les acteurs eux-mêmes de ces faits de guerre et/ou d’accidents,
enregistrent et diffusent l’innommable sans sourciller. Et chacun
regarde mi-horrifié, mi-sidéré ce torrent visuel qui
peut-être nous livre un nouvel archétype contemporain : l’urbain
en état de guerre, en situation de catastrophe, un horizon de nos
regards ?
© Michel Lussault