19 - La lettre d’obsidienne
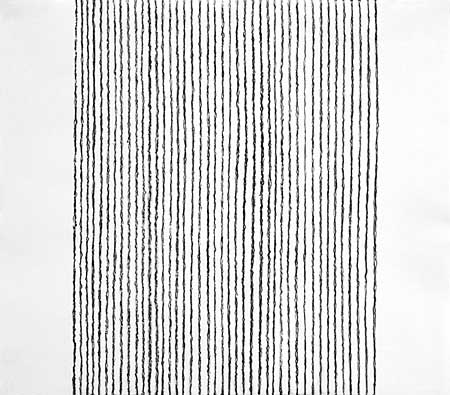
... le monde s’enfonce dans le sang comme un œuf d’obsidienne... alors que je souffre, allongé sur le flanc, serrant contre moi un grand livre d’images, alors que je pense à toi, je plonge dans ma haine. La douleur n’apprend rien ! Rien ! Rien ! La demeure qu’elle m’offrait vient de s’effondrer. La douleur rend plus pauvre : lorsque les cris cessent, et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme. Telle est mon âme, un déchet organique qui cherche à me fuir. La voici...
... contre ce que je pense, contre qui je suis, ces mots disent la rupture, traînent l’esprit comme une dépouille dans le désintérêt de l’autre... jusque dans l’oubli de la solitude même...
Je ne parviens plus à dire les mots que je pense. Draps mouillés, compter les taches, et ne trouver en moi plus rien dont je me sente solidaire... SAVOIR que je me détruis dans chacun de mes mots, non par idéal, mais par faiblesse, et que je n’ai d’autre moyen pour témoigner de ma bonne foi, de mon honnêteté, que de laisser mon corps en gage... je ne fais aucune différence entre lui, et ce que j’écris. Est-ce suffisant ?
Mais il n’est pas encore trop tard, même s’il y a quelque chose de scandaleux, d’insoutenable, d’enfantin, à résister à cette main...Ce qui fut perdu à la naissance, revient... Sous la paupière, le regard est comme la chair, opacité vivante... Attendre que s’assèchent le déni, la colère, la négociation, le désespoir et l’assentiment.
Le besoin d’amour s’impose soudain. Tant que le sang coule, la vie, en s’effaçant, efface le mourant. Alors quoi ? quelle suite à la chienne putain ? comment ne pas mourir ? j’écris autant contre ce qui m’anéantit, que pour détruire la voix qui résiste à cet anéantissement. Va te faire foutre, connard !
Je te donne cette lettre alors qu’on me prend tout. La nuit malsaine a crevé sa voûte. À quoi bon ? Qu’ai-je tiré de moi ? Rien, l’accompli fut offert. Ce qui m’a manqué, un autre l’a vécu, ce que j’ai tu, un autre l’a écrit. Bientôt, tu seras seul à porter ce qui m’encombre.
À l’approche du seul bien qui me reviendra en propre, mes poumons s’emplissent et se vident en silence. Les seuls mots qui comptent, ceux que personne ne peut écrire. La seule vie, celle dont personne ne veut. Mes draps sanglants témoignent de ce qui fut gagné sur le mensonge.
Attendre. L’ancienne raison d’être vivait là, près de l’eau... Attendre. Innocent du poème, de la compassion sans cause, monte et descend le soleil condamné... Je demande que me soient rendus la douleur et l’amour qui préparent à la mort.
Je veux dire les mots qui viennent me détruire. N’être plus que ce que j’écris, jusqu’à ce que soit réduite à rien la distance du corps au langage.
L’ascèse vraie exige de ne pas choisir entre les rares concessions du cœur qui rapprochent d’une mort HEUREUSE. Tout est bon, tout est bien.
Tout, y compris de croire que ma douleur porte en elle sa convalescence... la convalescence, qui court à la lumière et célèbre, dans le noir, le retour de la vie. Convalescence, reflux de celui qui porte devant lui l’image de sa mort sous forme de renoncement, et la réalité de sa vie sous forme de désir. Ma douleur est-elle encore capable d’un tel miracle ? elle, flux et départ de celui qui serre sur sa poitrine l’image de sa vie sous forme de renoncement, et la réalité de sa mort sous forme de nécessité.
Alors quoi ? porter dans l’invisible la douleur de la chair ? Te parler encore un peu de l’obsidienne... chacun éprouve l’évidence de sa mort dans le langage.
(image : Simone Stoll - série "Big Live Kinetic Profiles, 2001-04")