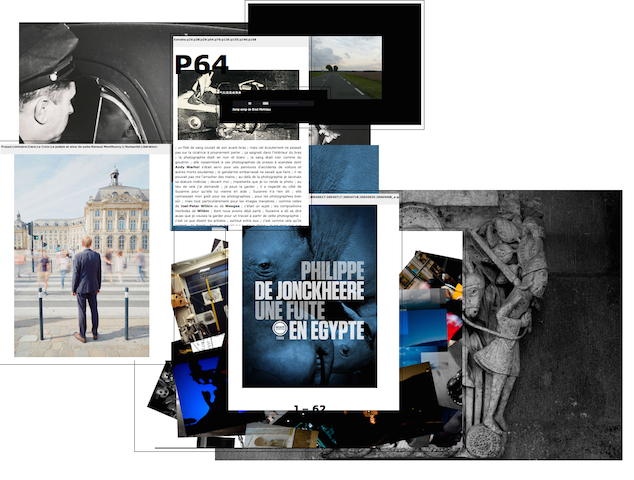La ponctuation intérieure Une fuite en Egypte de Philippe de Jonckheere

Philippe a deux enfants, Zoé et Emile. Leur mère semblait regagner le foyer après une nouvelle dispute. Impossible de savoir s’il s’agissait d’un retour ou d’une rupture car sa voiture est emboutie par un camion. Elle meurt sur le coup. Son nom reste dans l’ombre du récit qui nous parle de ceux qui restent, de ce qu’il reste quand le drame a eu lieu.
Une fuite en Egypte publié aux éditions Inculte est d’abord le roman d’un craquèlement intérieur. Après la mort de sa femme, le narrateur doit annoncer à ses jeunes enfants la disparition de leur mère. Il doit faire face au monde qui continue, aux gendarmes, aux collègues de travail, aux amis, au désir pour Suzanne, l’amie qui accompagne au moment du drame et à l’effilochement du réel qui suit une disparition. Le livre pourrait être un mélodrame mélancolique si nous n’étions pas emportés par la conscience friable du narrateur. Car Une fuite en Egypte est d’abord un monologue intérieur qui nous précipite au milieu d’une conscience mouvante et ébranlée. De Joyce à Woolf, en passant par Sarraute ou Enard, le monologue intérieur a aujourd’hui une longue vie d’écriture et d’expérimentation littéraire, Philippe de Jonckheere en donne de nouveaux aspects, de nouvelles aspérités.
La vie à l’intérieur
L’écriture de Philippe de Jonckheere impose immédiatement un univers, décrivant sans concession les soubresauts, les heurts d’une intimité meurtrie. Le livre est une implosion infinie, laissant le narrateur au milieu de ruines intérieures qu’il explore en aveugle, ou de constructions de mondes possibles qui surgissent violemment.
Tout démarre par un « JE VOUS ARRETE tout de suite ; je ne l’ai pas tuée ; elle est morte ; c’est vrai ; mais je ne l’ai pas tuée ; ce n’ai pas moi qui l’ai tuée ; d’ailleurs personne ne l’a tuée ; elle s’est tuée toute seule ; ce n’était pas un suicide ; elle ne s’est pas tuée exprès ; elle est morte dans un accident de voiture » (9). La situation est immédiatement posée et la vie intérieure du narrateur est le cœur d’un roman qui laisse jaillir des pensées traversant brutalement sa conscience. Elles sont comme des pulsations intérieures, violentes et parfois sauvages, témoignant du désastre intérieur, de la désorientation intime et des pensées insoumises à l’ordre du réel.
Ces mouvements brusques fonctionnement comme des digressions ou des projections fantasmatiques. Parfois elles sont signifiées par le narrateur : « mais était-ce le moment de nourrir de pareilles intrigues ; oui ; ici ; là ; on pourrait imaginer une digression ; un développement inopiné du récit ; dans lesquels la mécanique de triangulation amoureuse jouerait à plein ; je ne vous fais pas un dessin ; pimentée ; ladite mécanique ; par le mélange volatil de la passion sexuelle et de la mort dans un déluge de violence routière ; avec force description du carnage ; l’enchevêtrement des chairs et des carlingues ; des descriptions et des photographies post-mortem » (84… comme un hommage à Ballard). Parfois, les digressions sont plus trachées comme dans ce long récit du témoin de l’accident qu’écoute le narrateur en pensant au corps et au désir pour sa femme, à la musique ou à une nuée de souvenirs qui viennent interrompre et amplifier la violence du récit.
La voix narrative qui se souvient (car nous sommes dans un récit rétrospectif : « tout cela remonte à six mois maintenant » (p. 40)… induisant peut-être une duplicité narrative complexe et profonde) multiplie les niveaux de discours, les empile et forme une constellation à l’intérieur même d’un bloc narratif, permettant de mélanger le récit d’une action à la voix intérieur, et d’y superposer un commentaire rétrospectif : « Suzanne est venue tout de suite ; c’est en sa compagnie le lendemain matin que j’ai dû dire aux enfants que leur mère était morte ; Zoé a fondu en larmes tout de suite ; ce que j’ai trouvé bien ; oui ; on se dit toujours de telles âneries ; on est facilement péremptoire ; en fait on n’a ; évidemment ; aucune idée de ce qui est bien et de ce qui est mal ; mais on préfère penser que les choses vont bien ; qu’elles sont pour le mieux ; cela donne moins de travail ; si tout va bien ; ou pour le meilleur ; autant ne rien faire ; et c’est somme toute ce à quoi on est le plus apte ; ne rien faire ; bon à rien ; alors on dit ; c’est bien ; elle pleure ; me suis dit ; c’est brutal mais elle a compris » (31-32)
La logique générale du récit est celle de l’épanorthose, c’est-à-dire une forme d’écriture qui cherche à imiter les remous de la pensée, capable de se corriger dans le mouvement même de sa parole. Avec cette figure de style, le déroulement de la pensée, du discours, ou de la parole est immédiatement contrarié par un repentir, un retour correctif, l’apparition d’un flux contradictoire dans le même de la phrase ou du propos : « je n’ai plus été ennuyé ; on n’a jamais su trop comment elle était morte ; je veux dire quelles étaient les circonstances exactes de l’accident ; mais ce n’est pas cela qui est important ; je veux dire ; oui ; c’est important qu’elle soit morte ; entendez-moi ; non ; je veux dire ; ce qui était le plus important ; plus important que de connaître les conditions objectives de sa mort accidentelles ; c’est que nous nous étions disputées » (67). L’épanorthose est aussi là pour signifier la fragilité des significations : l’accident est au cœur du récit, mais traversé par les raisons du retour de cette femme : était-ce pour rompre ou regagner la vie familiale ? Devant cette béance, le roman choisit d’explorer l’indécidable.
Une fuite en Egypte est comme un océan, rempli de remous, traversé de courants contradictoires. L’écriture de Philippe de Jonckheere est un flux, le flux d’une conscience liquide, masse mouvante, infixée et en tension : le crête du réel peut sembler indolente et calme, alors que le fond obscur est traversé de courants contraires et violents.
Un point comme une virgule
Comment traduire ce flux et ces remous, ces courants qui traversent cette conscience et se heurtent à des flots contradictoires. Philippe de Jonckheere choisit le point-virgule. Il travaille sa phrase et sa langue par un épuisement, la multiplication des points-virgules venant infinir la phrase et rendre compte de la fragilité et du ressassement : « je crois que beaucoup de mes collègues m’avaient précédemment rangé dans la confrérie des ours retors et mal léchés et découvriraient dans mon chagrin ; que je parvenais si difficilement à rendre inaperçu ; une facette de ma personnalité qu’ils n’auraient pas soupçonnée ; la fragilité ; malgré cela ; je pense qu’ils étaient cependant encore loin de se douter de comment j’aggravais cette friabilité ; cette porosité à la tristesse ; en ne cessant de penser ; en ressassant » (114).
Le point-virgule est une ponctuation paradoxale, presque impossible : elle marque une pause qui n’est pas un arrêt, il relie tout en marquant une séparation, il met en relation, il fait tenir ensemble tout en maintenant une stase, une suspension. Le point-virgule est un signe typographique qui coupe et signifie en même temps une continuité. Il intensifie donc un paradoxe que Philippe de Jonckheere pousse jusqu’au paroxysme, le point-virgule contamine littéralement l’espace d’écriture. Une fuite en Egypte est une longue phrase traversée, sillonnée, structurée par ces points-virgules qui amplifient la tension et l’épuisement de la voix narrative, laquelle accomplit essentiellement son existence dans une vie conditionnelle (cf. par exemple pages 151 ou 189) ou dans les volutes des digressions qui peuvent aller de la recette des coquillettes au beurre (88) à l’évocation des Monty Python, prenant soudainement le pouvoir sur le récit au moment d’une incapacité à entre à la morgue (58), ou cette fiction au carré des amis qu’on appelle, Jérôme et Sylvie, leurs gestes et leurs paroles pour accompagner (83). Mais c’est Suzanne qui est appelée, pas Jérôme, ni Sylvie qui restent des projections alternatives et faibles dans l’océan du narrateur.
Jeu sur le réel / Je sur le réel
Philippe de Jonckheere approfondit encore plus cette tension par un jeu sur le réel en nommant le narrateur « Philippe de Jonckheere » (cf. page 66 ou 82). Le récit est un roman, celui d’un narrateur fictif portant le même nom que son auteur et relatant certains faits propres à l’auteur du livre Robert Franck, photographe : la place de la photographie dans la vie et dans l’œuvre de l’auteur, la question de l’informatique, par exemple : « je suis photographe ; mais je n’en vis pas ; de fait ; pour faire bouillir la marmite ; comme on dit ; je suis informaticien » (103)
Mais l’identification est une chausse-trappe. C’est plus exactement une duplicité qui cherche à intensifier la place du lecteur dans ce flux, dans ce récit comme un océan. L’adresse à soi initiale devient rapidement une adresse directe au lecteur, un jeu infini sur l’évocation du désir, sur la possibilité de l’aveu des pensées les plus sombres, mais aussi sur une constante mise en scène du dire, comme par exemple ces dièses qui bornent le long récit de quatorze pages narrant la rencontre avec le témoin de l’accident : « vous pouvez donc vous épargner la scène de poursuite de voiture en reportant directement au prochain # » (121). Mais là encore, la proposition est un piège, le lecteur se perd à cherche le dièse, tant il est éloigné par les mouvements et les impulsions narratives.
L’instance auctoriale invente une place pour le lecteur qui l’implique plus fortement dans le malaise du narrateur et joue sur les frontières entre témoignage et fiction. Or, le malaise possible n’est pas dans l’ordre du récit (le témoignage fictif) mais dans le désordre de la conscience. C’est justement l’instance du romanesque qui permet ces jeux de miroir et de passages de frontières. Tout devient indécidable car ce qui compte, ce que le livre nous invite à vivre et à saisir, c’est l’expérience d’une lecture aussi intense que puissante dans sa construction narrative et stylistique.
Le narrateur ne cesse de faire émerger des scénarios de peur, des récits catastrophes, remplis d’outrance et parfois glaçant comme cette folie (faussement) tueuse de la page 154 (et suivantes) qui saisissent le lecteur avant de comprendre qu’il ne s’agissait que d’un scénario. L’assertion « on ne peut pas tout dire » (154) est un jeu dans lequel il faut savoir ne pas entrer car le narrateur dit tout ce qu’on ne dit pas dans la réalité. En se débarrassant d’une certaine structure de ponctuation, le narrateur s’est débarrassé des restes de surmoi survivant dans le monologue intérieur.
Parfois, le désordre pulsionnel est plus violent et sauvage, troublant dans la mise en scène sexuelle, par exemple. Car le désir ou la pulsion sexuelle ne disparaît pas avec la mort de l’autre. Il y a bien sûr le désir contradictoire pour l’amie Suzanne, désir qui surgit au milieu du deuil, parce que la fidélité post-mortem « c’est compliqué » (25). Il y a également ses nombreux surgissement de désirs paradoxaux, entre eros et thanatos : « je revoyais ce bras s’allonger vers moi ; et sa main empoigner ma queue ; sa main était froide ; elle était morte ; ce n’était pas ma faute de le dire ; ma queue était comme dans un étau ; un étau d’acier dans un atelier en hiver ; le métal froid sur ma queue ; cette vision me faisait peur ; je n’allais pas encore dormir de la nuit ; et voilà que je bandais ; je me suis mis à pleurer ; je me suis branlé en pensant à elle, à ses fesses mais à ses fesses vivantes et comment elle aimait bien se faire prendre un peu brutalement par derrière » (193-194)
Corps du texte
Le choix du point-virgule est aussi une manière d’appliquer des coupes radicales à l’intérieure même de la phrase : très vite le lecteur comprend qu’au détour d’un point-virgule, on peut passer radicalement à un autre thème, à un autre univers mental, une autre idée, un autre souvenir, un autre aveu. Le point-virgule est l’espace de tension textuel qui fait tenir ensemble les distinctions et les oppositions. La marque de ponctuation devient, à elle seule, la métaphore du narrateur lui-même qui fait tenir ensemble toutes ces contradictions qui habitent son corps et son esprit. Le point-virgule est corps du texte et du narrateur. Mais on ne dira pas « un corps » mais « du corps ». Il s’agit donc de faire un écart à la norme grammaticale et, par cette expression « du corps » dire le corps comme idée de corps matériau d’écriture. Du corps pour dire quelque chose de générique et d’inachevé. C’est un prélèvement et un incomplet dans l’infinitude de l’acception grammaticale. L’article indéfini continu du n’est pas ici du côté du dénombrement, c’est une trace d’abstraction (le continu s’opposant au nombrable). La valeur partitive vient renverser une stricte singularité. Plus exactement, elle la dialectise. En effet, la morphologie de l’article partitif est composée d’une préposition et d’un article défini. Il y a bien une idée de prélèvement, l’indication d’une forme singulière renvoyant à un ensemble indéterminé. Du corps serait alors du singulier qui ne se singularise pas entièrement car il est devenu une extension prise dans un moment. Le point-virgule nous met face à ce tremblement du partitif. C’est la présence physique d’un indéterminé, l’actualisation incertaine d’une conscience branlante, et d’un corps perdu entre une vie intérieur et des images.
Le corps, le sexe et désir jouent un rôle particulier dans ce roman. Il y a le corps du désir et le cadavre qu’on ne peut pas voir. Il y a le désir pour Suzanne qui ne parvient pas à se substituer à la morte. Ce qui réussit à maintenir ces corps en tension dans le roman, c’est la photographie. Elle tient une place particulière, entre espace du désir (les photographies de la femme), témoignage de la disparue (la photographie de la mère choisie pour la chambre des enfants) et un espace de sens. La narrateur ne réussit pas à aller identifier sa femme à la morgue mais il veut récupérer une photographie de l’accident faite par les gendarmes. Il l’a vue par hasard, par accident. La description est aussi précise que technique (59-63). Elle devient le lieu des limites et le lien des mondes pour le narrateur. Parce que la photographie est son autre langage.
Jacques Derrida problématise cette question de la bordure en terme de limitrophie, c’est-à-dire « qu’il s’agira de ce qui pousse et croît à la limite, autour de la limite, en s’entretenant de la limite, mais de ce qui nourrit la limite, la génère, l’élève et la complique. Tout ce que je dirai, dit Derrida, ne consistera surtout pas à effacer la limite, mais à multiplier ses figures, à compliquer, épaissir, délinéariser, plier, diviser la ligne justement en la faisant croître et multiplier. » (Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Galilée, 2006, p. 51.) Cette remarque sur la limitrophie que Derrida creuse à propos de l’animal s’inscrit dans cette pensée de la bordure développée auparavant dans Parages (1986) à propos de Blanchot. Il s’agit bien ici d’un accomplissement dans l’impossibilité, dans la capacité négative d’œuvrer dans le désoeuvrement.
Le meilleur discours sur ce roman est sans doute à l’intérieur du roman. Le livre recèle sa propre métaphore dans un discours sur la peinture qui résonne comme la pensée même de ce texte : « à propos de cette fragilité constante de toute peinture en devenir et comment ; chaque nouveau geste vers cette toile menaçait toujours de faire s’effondrer sa composition ou ; c’était plus heureux ; de la retenir juste à temps d’un déséquilibre fatal ; Suzanne dans son texte donc ; insistait sur cette notion picturale du non-fini ; et comment chaque coup de pinceau courait en fait le risque d’emmener le tableau trop loin ; comme si la peinture se tenait sur les lèvres d’un gouffre ; l’acte de peindre ressemblait étonnamment au fait d’être acculé au bord d’un précipice et contraint d’avancer malgré tout » (30). Remplacez les termes de peinture par celui d’écriture et de roman, et vous aurez sans doute une idée de ce livre, car Roland Barthes le dernier nous a rappelé comment le texte était aussi une toile.
Un monde à construire
Le livre s’ouvre et se ferme quasiment avec des éboueurs. Entre le geste quotidien de la page 17 et leur quasi intrusion page 196 pour sauver le narrateur (qui n’avait rien), le livre cadre peut-être « le vacarme du déchargement » (17). Face au bruit, à sa violence, tout est à reconstruire, à réinventer. Deux objets peut-être le permettent.
Il y a d’abord cet opinel perdu. Il avait été offert au narrateur par sa femme. Il y tenait beaucoup. Il croyait l’avoir perdu. Il le retrouve caché au fond du désordre des affaires de sa femme (174). Discrètement, ce couteau devient le symbole du désordre temporel et du désordre sentimental du narrateur.
Au final, face au chaos du monde, le narrateur décide avec son fils Emile, au petit matin d’un nouveau jour, d’inventer quelque chose d’autres. Il prend une boîte de Kapla (197) et joue avec son fils de trois ans avec ces planchettes de bois, avant d’aller réveiller Zoé qui dort encore à l’étage.
Une fuite en Egypte publié aux éditions Inculte est d’abord le roman d’un craquèlement intérieur. Après la mort de sa femme, le narrateur doit annoncer à ses jeunes enfants la disparition de leur mère. Il doit faire face au monde qui continue, aux gendarmes, aux collègues de travail, aux amis, au désir pour Suzanne, l’amie qui accompagne au moment du drame et à l’effilochement du réel qui suit une disparition. Le livre pourrait être un mélodrame mélancolique si nous n’étions pas emportés par la conscience friable du narrateur. Car Une fuite en Egypte est d’abord un monologue intérieur qui nous précipite au milieu d’une conscience mouvante et ébranlée. De Joyce à Woolf, en passant par Sarraute ou Enard, le monologue intérieur a aujourd’hui une longue vie d’écriture et d’expérimentation littéraire, Philippe de Jonckheere en donne de nouveaux aspects, de nouvelles aspérités.
La vie à l’intérieur
L’écriture de Philippe de Jonckheere impose immédiatement un univers, décrivant sans concession les soubresauts, les heurts d’une intimité meurtrie. Le livre est une implosion infinie, laissant le narrateur au milieu de ruines intérieures qu’il explore en aveugle, ou de constructions de mondes possibles qui surgissent violemment.
Tout démarre par un « JE VOUS ARRETE tout de suite ; je ne l’ai pas tuée ; elle est morte ; c’est vrai ; mais je ne l’ai pas tuée ; ce n’ai pas moi qui l’ai tuée ; d’ailleurs personne ne l’a tuée ; elle s’est tuée toute seule ; ce n’était pas un suicide ; elle ne s’est pas tuée exprès ; elle est morte dans un accident de voiture » (9). La situation est immédiatement posée et la vie intérieure du narrateur est le cœur d’un roman qui laisse jaillir des pensées traversant brutalement sa conscience. Elles sont comme des pulsations intérieures, violentes et parfois sauvages, témoignant du désastre intérieur, de la désorientation intime et des pensées insoumises à l’ordre du réel.
Ces mouvements brusques fonctionnement comme des digressions ou des projections fantasmatiques. Parfois elles sont signifiées par le narrateur : « mais était-ce le moment de nourrir de pareilles intrigues ; oui ; ici ; là ; on pourrait imaginer une digression ; un développement inopiné du récit ; dans lesquels la mécanique de triangulation amoureuse jouerait à plein ; je ne vous fais pas un dessin ; pimentée ; ladite mécanique ; par le mélange volatil de la passion sexuelle et de la mort dans un déluge de violence routière ; avec force description du carnage ; l’enchevêtrement des chairs et des carlingues ; des descriptions et des photographies post-mortem » (84… comme un hommage à Ballard). Parfois, les digressions sont plus trachées comme dans ce long récit du témoin de l’accident qu’écoute le narrateur en pensant au corps et au désir pour sa femme, à la musique ou à une nuée de souvenirs qui viennent interrompre et amplifier la violence du récit.
La voix narrative qui se souvient (car nous sommes dans un récit rétrospectif : « tout cela remonte à six mois maintenant » (p. 40)… induisant peut-être une duplicité narrative complexe et profonde) multiplie les niveaux de discours, les empile et forme une constellation à l’intérieur même d’un bloc narratif, permettant de mélanger le récit d’une action à la voix intérieur, et d’y superposer un commentaire rétrospectif : « Suzanne est venue tout de suite ; c’est en sa compagnie le lendemain matin que j’ai dû dire aux enfants que leur mère était morte ; Zoé a fondu en larmes tout de suite ; ce que j’ai trouvé bien ; oui ; on se dit toujours de telles âneries ; on est facilement péremptoire ; en fait on n’a ; évidemment ; aucune idée de ce qui est bien et de ce qui est mal ; mais on préfère penser que les choses vont bien ; qu’elles sont pour le mieux ; cela donne moins de travail ; si tout va bien ; ou pour le meilleur ; autant ne rien faire ; et c’est somme toute ce à quoi on est le plus apte ; ne rien faire ; bon à rien ; alors on dit ; c’est bien ; elle pleure ; me suis dit ; c’est brutal mais elle a compris » (31-32)
La logique générale du récit est celle de l’épanorthose, c’est-à-dire une forme d’écriture qui cherche à imiter les remous de la pensée, capable de se corriger dans le mouvement même de sa parole. Avec cette figure de style, le déroulement de la pensée, du discours, ou de la parole est immédiatement contrarié par un repentir, un retour correctif, l’apparition d’un flux contradictoire dans le même de la phrase ou du propos : « je n’ai plus été ennuyé ; on n’a jamais su trop comment elle était morte ; je veux dire quelles étaient les circonstances exactes de l’accident ; mais ce n’est pas cela qui est important ; je veux dire ; oui ; c’est important qu’elle soit morte ; entendez-moi ; non ; je veux dire ; ce qui était le plus important ; plus important que de connaître les conditions objectives de sa mort accidentelles ; c’est que nous nous étions disputées » (67). L’épanorthose est aussi là pour signifier la fragilité des significations : l’accident est au cœur du récit, mais traversé par les raisons du retour de cette femme : était-ce pour rompre ou regagner la vie familiale ? Devant cette béance, le roman choisit d’explorer l’indécidable.
Une fuite en Egypte est comme un océan, rempli de remous, traversé de courants contradictoires. L’écriture de Philippe de Jonckheere est un flux, le flux d’une conscience liquide, masse mouvante, infixée et en tension : le crête du réel peut sembler indolente et calme, alors que le fond obscur est traversé de courants contraires et violents.
Un point comme une virgule
Comment traduire ce flux et ces remous, ces courants qui traversent cette conscience et se heurtent à des flots contradictoires. Philippe de Jonckheere choisit le point-virgule. Il travaille sa phrase et sa langue par un épuisement, la multiplication des points-virgules venant infinir la phrase et rendre compte de la fragilité et du ressassement : « je crois que beaucoup de mes collègues m’avaient précédemment rangé dans la confrérie des ours retors et mal léchés et découvriraient dans mon chagrin ; que je parvenais si difficilement à rendre inaperçu ; une facette de ma personnalité qu’ils n’auraient pas soupçonnée ; la fragilité ; malgré cela ; je pense qu’ils étaient cependant encore loin de se douter de comment j’aggravais cette friabilité ; cette porosité à la tristesse ; en ne cessant de penser ; en ressassant » (114).
Le point-virgule est une ponctuation paradoxale, presque impossible : elle marque une pause qui n’est pas un arrêt, il relie tout en marquant une séparation, il met en relation, il fait tenir ensemble tout en maintenant une stase, une suspension. Le point-virgule est un signe typographique qui coupe et signifie en même temps une continuité. Il intensifie donc un paradoxe que Philippe de Jonckheere pousse jusqu’au paroxysme, le point-virgule contamine littéralement l’espace d’écriture. Une fuite en Egypte est une longue phrase traversée, sillonnée, structurée par ces points-virgules qui amplifient la tension et l’épuisement de la voix narrative, laquelle accomplit essentiellement son existence dans une vie conditionnelle (cf. par exemple pages 151 ou 189) ou dans les volutes des digressions qui peuvent aller de la recette des coquillettes au beurre (88) à l’évocation des Monty Python, prenant soudainement le pouvoir sur le récit au moment d’une incapacité à entre à la morgue (58), ou cette fiction au carré des amis qu’on appelle, Jérôme et Sylvie, leurs gestes et leurs paroles pour accompagner (83). Mais c’est Suzanne qui est appelée, pas Jérôme, ni Sylvie qui restent des projections alternatives et faibles dans l’océan du narrateur.
Jeu sur le réel / Je sur le réel
Philippe de Jonckheere approfondit encore plus cette tension par un jeu sur le réel en nommant le narrateur « Philippe de Jonckheere » (cf. page 66 ou 82). Le récit est un roman, celui d’un narrateur fictif portant le même nom que son auteur et relatant certains faits propres à l’auteur du livre Robert Franck, photographe : la place de la photographie dans la vie et dans l’œuvre de l’auteur, la question de l’informatique, par exemple : « je suis photographe ; mais je n’en vis pas ; de fait ; pour faire bouillir la marmite ; comme on dit ; je suis informaticien » (103)
Mais l’identification est une chausse-trappe. C’est plus exactement une duplicité qui cherche à intensifier la place du lecteur dans ce flux, dans ce récit comme un océan. L’adresse à soi initiale devient rapidement une adresse directe au lecteur, un jeu infini sur l’évocation du désir, sur la possibilité de l’aveu des pensées les plus sombres, mais aussi sur une constante mise en scène du dire, comme par exemple ces dièses qui bornent le long récit de quatorze pages narrant la rencontre avec le témoin de l’accident : « vous pouvez donc vous épargner la scène de poursuite de voiture en reportant directement au prochain # » (121). Mais là encore, la proposition est un piège, le lecteur se perd à cherche le dièse, tant il est éloigné par les mouvements et les impulsions narratives.
L’instance auctoriale invente une place pour le lecteur qui l’implique plus fortement dans le malaise du narrateur et joue sur les frontières entre témoignage et fiction. Or, le malaise possible n’est pas dans l’ordre du récit (le témoignage fictif) mais dans le désordre de la conscience. C’est justement l’instance du romanesque qui permet ces jeux de miroir et de passages de frontières. Tout devient indécidable car ce qui compte, ce que le livre nous invite à vivre et à saisir, c’est l’expérience d’une lecture aussi intense que puissante dans sa construction narrative et stylistique.
Le narrateur ne cesse de faire émerger des scénarios de peur, des récits catastrophes, remplis d’outrance et parfois glaçant comme cette folie (faussement) tueuse de la page 154 (et suivantes) qui saisissent le lecteur avant de comprendre qu’il ne s’agissait que d’un scénario. L’assertion « on ne peut pas tout dire » (154) est un jeu dans lequel il faut savoir ne pas entrer car le narrateur dit tout ce qu’on ne dit pas dans la réalité. En se débarrassant d’une certaine structure de ponctuation, le narrateur s’est débarrassé des restes de surmoi survivant dans le monologue intérieur.
Parfois, le désordre pulsionnel est plus violent et sauvage, troublant dans la mise en scène sexuelle, par exemple. Car le désir ou la pulsion sexuelle ne disparaît pas avec la mort de l’autre. Il y a bien sûr le désir contradictoire pour l’amie Suzanne, désir qui surgit au milieu du deuil, parce que la fidélité post-mortem « c’est compliqué » (25). Il y a également ses nombreux surgissement de désirs paradoxaux, entre eros et thanatos : « je revoyais ce bras s’allonger vers moi ; et sa main empoigner ma queue ; sa main était froide ; elle était morte ; ce n’était pas ma faute de le dire ; ma queue était comme dans un étau ; un étau d’acier dans un atelier en hiver ; le métal froid sur ma queue ; cette vision me faisait peur ; je n’allais pas encore dormir de la nuit ; et voilà que je bandais ; je me suis mis à pleurer ; je me suis branlé en pensant à elle, à ses fesses mais à ses fesses vivantes et comment elle aimait bien se faire prendre un peu brutalement par derrière » (193-194)
Corps du texte
Le choix du point-virgule est aussi une manière d’appliquer des coupes radicales à l’intérieure même de la phrase : très vite le lecteur comprend qu’au détour d’un point-virgule, on peut passer radicalement à un autre thème, à un autre univers mental, une autre idée, un autre souvenir, un autre aveu. Le point-virgule est l’espace de tension textuel qui fait tenir ensemble les distinctions et les oppositions. La marque de ponctuation devient, à elle seule, la métaphore du narrateur lui-même qui fait tenir ensemble toutes ces contradictions qui habitent son corps et son esprit. Le point-virgule est corps du texte et du narrateur. Mais on ne dira pas « un corps » mais « du corps ». Il s’agit donc de faire un écart à la norme grammaticale et, par cette expression « du corps » dire le corps comme idée de corps matériau d’écriture. Du corps pour dire quelque chose de générique et d’inachevé. C’est un prélèvement et un incomplet dans l’infinitude de l’acception grammaticale. L’article indéfini continu du n’est pas ici du côté du dénombrement, c’est une trace d’abstraction (le continu s’opposant au nombrable). La valeur partitive vient renverser une stricte singularité. Plus exactement, elle la dialectise. En effet, la morphologie de l’article partitif est composée d’une préposition et d’un article défini. Il y a bien une idée de prélèvement, l’indication d’une forme singulière renvoyant à un ensemble indéterminé. Du corps serait alors du singulier qui ne se singularise pas entièrement car il est devenu une extension prise dans un moment. Le point-virgule nous met face à ce tremblement du partitif. C’est la présence physique d’un indéterminé, l’actualisation incertaine d’une conscience branlante, et d’un corps perdu entre une vie intérieur et des images.
Le corps, le sexe et désir jouent un rôle particulier dans ce roman. Il y a le corps du désir et le cadavre qu’on ne peut pas voir. Il y a le désir pour Suzanne qui ne parvient pas à se substituer à la morte. Ce qui réussit à maintenir ces corps en tension dans le roman, c’est la photographie. Elle tient une place particulière, entre espace du désir (les photographies de la femme), témoignage de la disparue (la photographie de la mère choisie pour la chambre des enfants) et un espace de sens. La narrateur ne réussit pas à aller identifier sa femme à la morgue mais il veut récupérer une photographie de l’accident faite par les gendarmes. Il l’a vue par hasard, par accident. La description est aussi précise que technique (59-63). Elle devient le lieu des limites et le lien des mondes pour le narrateur. Parce que la photographie est son autre langage.
Jacques Derrida problématise cette question de la bordure en terme de limitrophie, c’est-à-dire « qu’il s’agira de ce qui pousse et croît à la limite, autour de la limite, en s’entretenant de la limite, mais de ce qui nourrit la limite, la génère, l’élève et la complique. Tout ce que je dirai, dit Derrida, ne consistera surtout pas à effacer la limite, mais à multiplier ses figures, à compliquer, épaissir, délinéariser, plier, diviser la ligne justement en la faisant croître et multiplier. » (Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Galilée, 2006, p. 51.) Cette remarque sur la limitrophie que Derrida creuse à propos de l’animal s’inscrit dans cette pensée de la bordure développée auparavant dans Parages (1986) à propos de Blanchot. Il s’agit bien ici d’un accomplissement dans l’impossibilité, dans la capacité négative d’œuvrer dans le désoeuvrement.
Le meilleur discours sur ce roman est sans doute à l’intérieur du roman. Le livre recèle sa propre métaphore dans un discours sur la peinture qui résonne comme la pensée même de ce texte : « à propos de cette fragilité constante de toute peinture en devenir et comment ; chaque nouveau geste vers cette toile menaçait toujours de faire s’effondrer sa composition ou ; c’était plus heureux ; de la retenir juste à temps d’un déséquilibre fatal ; Suzanne dans son texte donc ; insistait sur cette notion picturale du non-fini ; et comment chaque coup de pinceau courait en fait le risque d’emmener le tableau trop loin ; comme si la peinture se tenait sur les lèvres d’un gouffre ; l’acte de peindre ressemblait étonnamment au fait d’être acculé au bord d’un précipice et contraint d’avancer malgré tout » (30). Remplacez les termes de peinture par celui d’écriture et de roman, et vous aurez sans doute une idée de ce livre, car Roland Barthes le dernier nous a rappelé comment le texte était aussi une toile.
Un monde à construire
Le livre s’ouvre et se ferme quasiment avec des éboueurs. Entre le geste quotidien de la page 17 et leur quasi intrusion page 196 pour sauver le narrateur (qui n’avait rien), le livre cadre peut-être « le vacarme du déchargement » (17). Face au bruit, à sa violence, tout est à reconstruire, à réinventer. Deux objets peut-être le permettent.
Il y a d’abord cet opinel perdu. Il avait été offert au narrateur par sa femme. Il y tenait beaucoup. Il croyait l’avoir perdu. Il le retrouve caché au fond du désordre des affaires de sa femme (174). Discrètement, ce couteau devient le symbole du désordre temporel et du désordre sentimental du narrateur.
Au final, face au chaos du monde, le narrateur décide avec son fils Emile, au petit matin d’un nouveau jour, d’inventer quelque chose d’autres. Il prend une boîte de Kapla (197) et joue avec son fils de trois ans avec ces planchettes de bois, avant d’aller réveiller Zoé qui dort encore à l’étage.
On peut prolonger la lecture en allant sur le site de l’auteur en lien avec le livre. Cliquez sur l’image.
14 juin 2017