« c’est la structure, la composition, qui font la “politique”’ du roman, et non le thème ou l’orientation narrative », Camille de Toledo
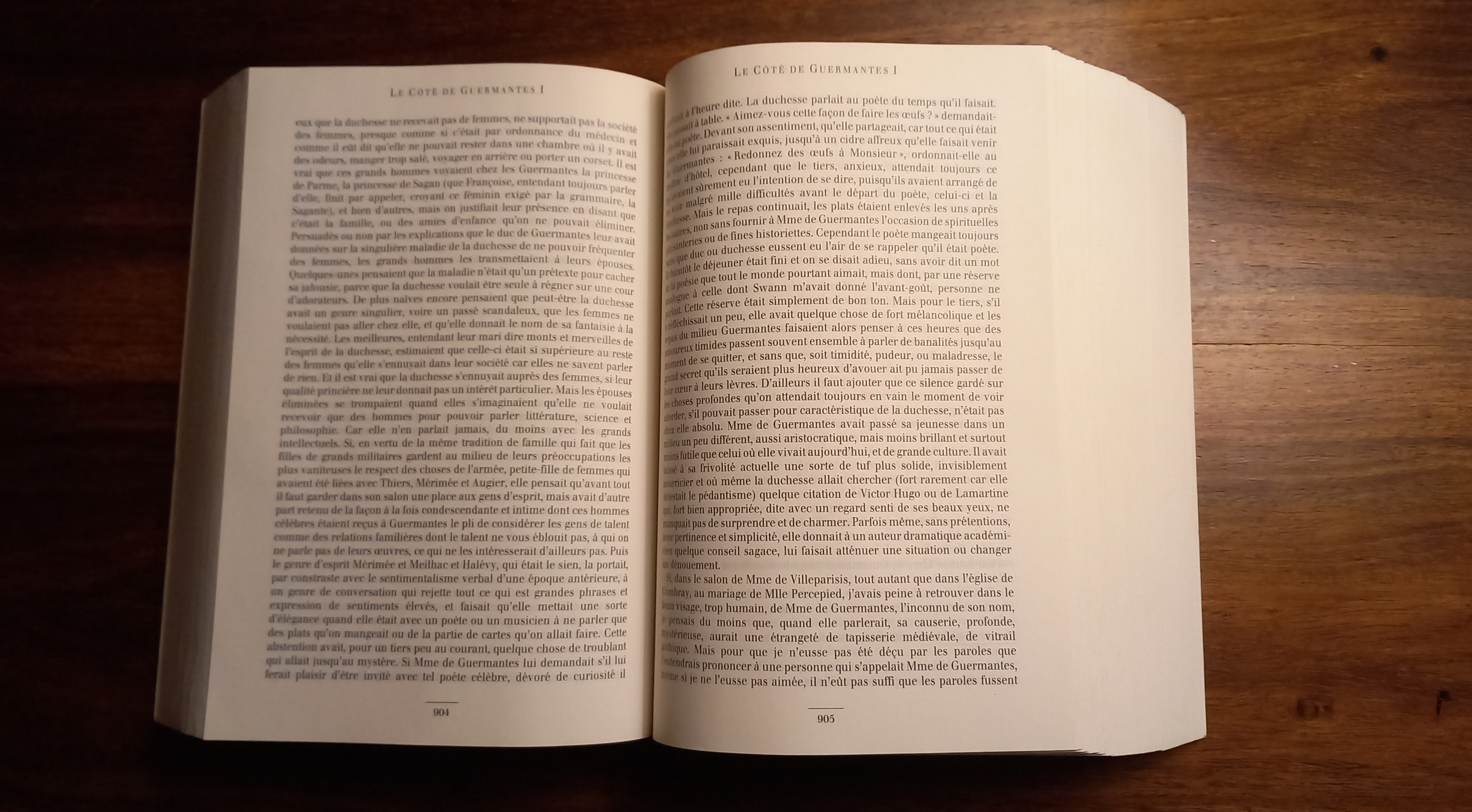
Dans l’entre des langues, le site de Camille de Toledo.
La chute de Fukuyuma, opéra vidéo, livret et vidéo de Camille de Toledo, musique de Grégoire Hetzel.
Camille de Toledo sur le site des éditions Verdier
sur remue.
Dernier livre paru : Oublier, trahir, puis disparaître (Le Seuil, janvier 2014).
 Écrire un roman : cette forme s’impose-t-elle à vous ou est-ce une décision prise pour tel livre ? ou une fois pour toutes ?
Écrire un roman : cette forme s’impose-t-elle à vous ou est-ce une décision prise pour tel livre ? ou une fois pour toutes ? C’est étrange. La question semble présupposer qu’il y aurait une forme établie du « roman ». Vous demandez en effet : « Cette forme s’impose-t-elle à vous ? » Comme si la forme-roman était déjà, en soi, un cadre, un agencement de l’écrit défini a priori, et qui « s’imposait », comme s’il ne s’agissait finalement que d’une forme disponible dans un répertoire de formes également prédéfinies, que l’écrivain piochait, en fonction de ses besoins : le récit, le roman, la poésie… Je dirais plutôt, dans mon cas, que c’est l’informe qui est premier. L’écriture est une matière première, à l’image du terme « rushs » pour un montage cinématographique. Je vois qu’il y a, au commencement, de l’informe, de la glaise, de la matière, des écritures qui s’accumulent, ou des images-histoires que je souhaite mettre en mouvement, et cela, indépendamment de la question de la forme. Et c’est bien dans le passage de cette informe de l’écriture à la forme de ce que l’on finit par désigner « livre » que l’apparence, la composition, la graphie finissent par s’imposer. Ce que j’accepte de placer sous le nom de « roman », dans mon cas, pourrait bien être comme le mot « sculpture ». Nous savons ce qu’est une sculpture. Nous savons que c’est une manière de désigner une forme qui se matérialise dans un espace. Nous savons que c’est un mot qui rassemble des infinités de formes résultant à la fois de la matière utilisée et de la singularité du corps et de l’esprit qui la manipulent. Le mot « sculpture » autorise cette infinité de formes singulières, qui s’inventent dans le geste même de la création. Je serais tenté de dire que le « roman » désigne ce qui finit par être sculpté dans un livre. Il est donc non une forme établie, mais un nom qui rassemble et autorise des infinités de formes, des expérimentations, des agencements de textes, dans un espace que l’on nomme livre et qui n’a pas renoncé, même dans sa dimension fragmentaire, à l’idée d’une totalité, de quelque chose qui commence et finit. Il y a un début et une fin dans un roman, voilà tout ce que je sais. Quand pour le poème, cette totalité est percée, marquée par un refus de la clôture ou du commencement, le roman porte en lui la nostalgie d’une unité ou l’aspiration à une complétude. En cela, les formes qu’il autorise – et elles sont innombrables – sont tenues dans cette limite. Elles peuvent vouloir la repousser, la conjurer ou l’éviter, mais elles sont d’emblée prises dans une lutte avec, contre ou en rupture, en dissidence, avec l’idée de l’Un. Quand on sait par ailleurs à quel point nos vies sont sans cesse plus diffractées, coupées, tiraillées entre plusieurs perspectives, plusieurs langues, plusieurs cultures, cette persistance de l’Un dans le roman produit une tension créatrice très forte. Car il s’agit, en permanence, de jouer avec la limite, de « casser » la totalité explicative, pour mettre des forces contraires, des voix multiples en mouvement, tout en faisant l’expérience de l’énergie avec laquelle le Un est chaque fois ravivé par les diffractions multiples des êtres, des mots qui peuplent le livre. En cela, on peut bien dire que c’est la structure, la composition, qui font la « politique » du roman, et non, le thème ou l’orientation narrative. Définissant un ensemble – un livre – reliant des éléments écrits dans un agencement contradictoire – le roman rejoue, sur un autre plan, ce qui est exigé de nos sociétés. Qu’elles entendent la pluralité des voix qui les habitent et les hantent…
C’est étrange. La question semble présupposer qu’il y aurait une forme établie du « roman ». Vous demandez en effet : « Cette forme s’impose-t-elle à vous ? » Comme si la forme-roman était déjà, en soi, un cadre, un agencement de l’écrit défini a priori, et qui « s’imposait », comme s’il ne s’agissait finalement que d’une forme disponible dans un répertoire de formes également prédéfinies, que l’écrivain piochait, en fonction de ses besoins : le récit, le roman, la poésie… Je dirais plutôt, dans mon cas, que c’est l’informe qui est premier. L’écriture est une matière première, à l’image du terme « rushs » pour un montage cinématographique. Je vois qu’il y a, au commencement, de l’informe, de la glaise, de la matière, des écritures qui s’accumulent, ou des images-histoires que je souhaite mettre en mouvement, et cela, indépendamment de la question de la forme. Et c’est bien dans le passage de cette informe de l’écriture à la forme de ce que l’on finit par désigner « livre » que l’apparence, la composition, la graphie finissent par s’imposer. Ce que j’accepte de placer sous le nom de « roman », dans mon cas, pourrait bien être comme le mot « sculpture ». Nous savons ce qu’est une sculpture. Nous savons que c’est une manière de désigner une forme qui se matérialise dans un espace. Nous savons que c’est un mot qui rassemble des infinités de formes résultant à la fois de la matière utilisée et de la singularité du corps et de l’esprit qui la manipulent. Le mot « sculpture » autorise cette infinité de formes singulières, qui s’inventent dans le geste même de la création. Je serais tenté de dire que le « roman » désigne ce qui finit par être sculpté dans un livre. Il est donc non une forme établie, mais un nom qui rassemble et autorise des infinités de formes, des expérimentations, des agencements de textes, dans un espace que l’on nomme livre et qui n’a pas renoncé, même dans sa dimension fragmentaire, à l’idée d’une totalité, de quelque chose qui commence et finit. Il y a un début et une fin dans un roman, voilà tout ce que je sais. Quand pour le poème, cette totalité est percée, marquée par un refus de la clôture ou du commencement, le roman porte en lui la nostalgie d’une unité ou l’aspiration à une complétude. En cela, les formes qu’il autorise – et elles sont innombrables – sont tenues dans cette limite. Elles peuvent vouloir la repousser, la conjurer ou l’éviter, mais elles sont d’emblée prises dans une lutte avec, contre ou en rupture, en dissidence, avec l’idée de l’Un. Quand on sait par ailleurs à quel point nos vies sont sans cesse plus diffractées, coupées, tiraillées entre plusieurs perspectives, plusieurs langues, plusieurs cultures, cette persistance de l’Un dans le roman produit une tension créatrice très forte. Car il s’agit, en permanence, de jouer avec la limite, de « casser » la totalité explicative, pour mettre des forces contraires, des voix multiples en mouvement, tout en faisant l’expérience de l’énergie avec laquelle le Un est chaque fois ravivé par les diffractions multiples des êtres, des mots qui peuplent le livre. En cela, on peut bien dire que c’est la structure, la composition, qui font la « politique » du roman, et non, le thème ou l’orientation narrative. Définissant un ensemble – un livre – reliant des éléments écrits dans un agencement contradictoire – le roman rejoue, sur un autre plan, ce qui est exigé de nos sociétés. Qu’elles entendent la pluralité des voix qui les habitent et les hantent… Que demandez-vous à un roman en tant que lecteur ? En tant qu’auteur ? Sont-ce les mêmes choses ?
Que demandez-vous à un roman en tant que lecteur ? En tant qu’auteur ? Sont-ce les mêmes choses ?
 J’ai une attente qui s’est dessinée très jeune, quand je me suis mis à lire. Je n’ai pas connu l’âge de la lecture « par plaisir ». Cet âge où l’on lit Dumas, Les Trois Mousquetaires ou les livres de Jules Verne. Ce premier âge de la lecture, je ne l’ai pas vraiment connu. Ma mère essayait désespérément de me donner le goût des histoires, mais j’étais bien trop occupé à courir, à jouer. Je n’aimais pas lire. Elle était obligée de m’accompagner le soir à voix haute. Et c’est comme ça que j’ai entendu Le Lion de Kessel dans la voix de ma mère, ou l’histoire de « Thésée et le minotaure ». Mais comme ma mère était une femme très occupée, je n’ai pas beaucoup entendu sa voix, le soir. Je suis venu à la lecture à l’âge d’après, celui où l’on cherche des amis, des compagnons, dans l’ennui des soirées en famille. C’est un autre âge, car nous ne sommes plus dès lors à la recherche d’une « histoire » où nous projeter. Nous entrons dans la pensée, et la lecture s’apparente à un chemin d’accès à cette pensée. C’est l’âge où l’on découvre ce qu’est la réflexivité : sur soi, sur les autres. D’emblée, j’ai donc lu des livres « difficiles », pour comprendre ma condition et ma place dans le monde. J’avais quinze ou seize ans quand je me suis mis à lire Dostoïevski. Mon histoire de la lecture fut immédiatement reliée à une quête de savoir. Non pas un savoir « positif », lié au thème du livre. Non, ce savoir-là se trouve dans n’importe quel livre, n’importe quel dictionnaire. Ce qui m’intéressait, c’était le savoir que seule la littérature parvient à porter : un savoir émotionnel, le contraire d’un savoir livresque. Je crois que je pourrais opposer le « savoir chaud » de la littérature, qui fait entrer dans l’expérience, au « savoir froid » de la connaissance. J’ai lu pour voir au-delà du visible, au-delà des convenances, au-delà des principes qui fondent notre monde. J’ai lu, d’une certaine façon, en découvrant l’épaisseur du réel, les strates nombreuses de sens, de non-sens, d’absurde, de pitié, d’égoïsme, de folie, d’ardeur et d’impuissance qui composent le monde. Le roman m’a donné accès à des champs de savoir que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Et ce deuxième âge de la lecture a laissé des traces indélébiles sur ce que je recherche : écrire des livres qui font persister ce savoir de la littérature. Écrire des livres qui explorent et éclairent notre place dans le monde, écrire des livres qui rendent plus voyants. Je ne sais pas si j’y parviens, mais il y a toujours cette « responsabilité » qui est à l’œuvre, en moi : ne pas trahir cette responsabilité, ne pas ajouter une histoire à ce présent déjà saturé d’histoires. Au contraire : que chaque livre, chaque roman soit comme un trou percé dans les yeux.
J’ai une attente qui s’est dessinée très jeune, quand je me suis mis à lire. Je n’ai pas connu l’âge de la lecture « par plaisir ». Cet âge où l’on lit Dumas, Les Trois Mousquetaires ou les livres de Jules Verne. Ce premier âge de la lecture, je ne l’ai pas vraiment connu. Ma mère essayait désespérément de me donner le goût des histoires, mais j’étais bien trop occupé à courir, à jouer. Je n’aimais pas lire. Elle était obligée de m’accompagner le soir à voix haute. Et c’est comme ça que j’ai entendu Le Lion de Kessel dans la voix de ma mère, ou l’histoire de « Thésée et le minotaure ». Mais comme ma mère était une femme très occupée, je n’ai pas beaucoup entendu sa voix, le soir. Je suis venu à la lecture à l’âge d’après, celui où l’on cherche des amis, des compagnons, dans l’ennui des soirées en famille. C’est un autre âge, car nous ne sommes plus dès lors à la recherche d’une « histoire » où nous projeter. Nous entrons dans la pensée, et la lecture s’apparente à un chemin d’accès à cette pensée. C’est l’âge où l’on découvre ce qu’est la réflexivité : sur soi, sur les autres. D’emblée, j’ai donc lu des livres « difficiles », pour comprendre ma condition et ma place dans le monde. J’avais quinze ou seize ans quand je me suis mis à lire Dostoïevski. Mon histoire de la lecture fut immédiatement reliée à une quête de savoir. Non pas un savoir « positif », lié au thème du livre. Non, ce savoir-là se trouve dans n’importe quel livre, n’importe quel dictionnaire. Ce qui m’intéressait, c’était le savoir que seule la littérature parvient à porter : un savoir émotionnel, le contraire d’un savoir livresque. Je crois que je pourrais opposer le « savoir chaud » de la littérature, qui fait entrer dans l’expérience, au « savoir froid » de la connaissance. J’ai lu pour voir au-delà du visible, au-delà des convenances, au-delà des principes qui fondent notre monde. J’ai lu, d’une certaine façon, en découvrant l’épaisseur du réel, les strates nombreuses de sens, de non-sens, d’absurde, de pitié, d’égoïsme, de folie, d’ardeur et d’impuissance qui composent le monde. Le roman m’a donné accès à des champs de savoir que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Et ce deuxième âge de la lecture a laissé des traces indélébiles sur ce que je recherche : écrire des livres qui font persister ce savoir de la littérature. Écrire des livres qui explorent et éclairent notre place dans le monde, écrire des livres qui rendent plus voyants. Je ne sais pas si j’y parviens, mais il y a toujours cette « responsabilité » qui est à l’œuvre, en moi : ne pas trahir cette responsabilité, ne pas ajouter une histoire à ce présent déjà saturé d’histoires. Au contraire : que chaque livre, chaque roman soit comme un trou percé dans les yeux.
 Avez-vous fait des incursions dans d’autres formes littéraires et si tel est le cas, cette expérience a-t-elle servi d’une façon ou d’une autre dans l’écriture du ou des romans suivants ?
Avez-vous fait des incursions dans d’autres formes littéraires et si tel est le cas, cette expérience a-t-elle servi d’une façon ou d’une autre dans l’écriture du ou des romans suivants ?
 Je crois pouvoir dire que le « genre » de mes livres a toujours été décidé par les autres. C’est un peu comme pour les noms. On accepte d’être nommé. Et celui qui vous nomme « juif » ou « français » ou « européen » ou « jeune » ou « vieux » ou « noir » ou « blanc », rien ne sert de lui opposer son « genre ». Nous devons être humbles devant ces autres qui nomment. C’est le premier moment de notre insertion dans les choses et les voix qui nous entourent. Accepter d’être nommé tout en sachant, également, que toute redésignation de soi, de l’œuvre, toute invention de soi, ne peut se faire que dans le temps long. On a qualifié certains de mes livres d’ « essais », d’autres de « récits », d’autres fois on m’a dit que j’avais écrit un « chant », ou bien encore un « roman ». Parfois, on a pu dire que j’avais écrit un « pamphlet ». Selon le destinataire, selon la personne qui édite, selon la logique de la collection, selon la réception, tout est sujet au flottement, au trouble sur le genre. Mon nom même prête à confusion. Il me désigne comme femme, « Camille », comme espagnol, « de Toledo ». Je dirais donc qu’il en est des livres comme de soi. Nous devons nous soumettre, provisoirement, à la désignation, et nous pouvons nous insurger, secrètement, dans l’œuvre, dans la durée, contre à cette assignation, contre cet ordre du genre. Mais je sens bien que je ne réponds pas tout à fait à votre question. C’est qu’elle présuppose, une fois encore, qu’il y a des genres préétablis que l’on choisit pour tel ou tel projet. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Un ami me disait : « On sent dans tes livres une montée vers le poème, une montée dans la voix. » C’est sans doute cela, oui, ce trajet de livre en livre, où quelque chose s’écrit, malgré nous, que nous percevons de plus en plus clairement, mais qui échappe, au moment même où nous nous remettons à écrire, pour finalement trouver une forme provisoire. Et tandis que je relis votre question, je me rends compte que ce n’est pas, chez moi, un genre d’écriture, - entendu au sens de poésie ou roman ou récit ou essai… - qui nourrit un autre genre, mais un genre de langage – au sens de langage photographique, cinématographique, artistique – qui permet d’interroger, de transformer, de repenser l’écriture et de trouver une forme. Dans ce cas, oui, si l’on entend ce passage, comme celui qui me conduit d’une pratique à l’autre, d’un langage artistique à l’autre, alors, sans doute. Je travaille d’ailleurs ces temps-ci à ce que je nomme le « Catalogue des œuvres inachevées » qui se tient justement à cet endroit-là : dans l’entre-genres, où j’explore comment une installation ou une vidéo nourrissent un travail romanesque, et comment la réflexion sur le livre, entre autres, fait naître une forme dans l’espace, une forme plastique ou une image…
Je crois pouvoir dire que le « genre » de mes livres a toujours été décidé par les autres. C’est un peu comme pour les noms. On accepte d’être nommé. Et celui qui vous nomme « juif » ou « français » ou « européen » ou « jeune » ou « vieux » ou « noir » ou « blanc », rien ne sert de lui opposer son « genre ». Nous devons être humbles devant ces autres qui nomment. C’est le premier moment de notre insertion dans les choses et les voix qui nous entourent. Accepter d’être nommé tout en sachant, également, que toute redésignation de soi, de l’œuvre, toute invention de soi, ne peut se faire que dans le temps long. On a qualifié certains de mes livres d’ « essais », d’autres de « récits », d’autres fois on m’a dit que j’avais écrit un « chant », ou bien encore un « roman ». Parfois, on a pu dire que j’avais écrit un « pamphlet ». Selon le destinataire, selon la personne qui édite, selon la logique de la collection, selon la réception, tout est sujet au flottement, au trouble sur le genre. Mon nom même prête à confusion. Il me désigne comme femme, « Camille », comme espagnol, « de Toledo ». Je dirais donc qu’il en est des livres comme de soi. Nous devons nous soumettre, provisoirement, à la désignation, et nous pouvons nous insurger, secrètement, dans l’œuvre, dans la durée, contre à cette assignation, contre cet ordre du genre. Mais je sens bien que je ne réponds pas tout à fait à votre question. C’est qu’elle présuppose, une fois encore, qu’il y a des genres préétablis que l’on choisit pour tel ou tel projet. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Un ami me disait : « On sent dans tes livres une montée vers le poème, une montée dans la voix. » C’est sans doute cela, oui, ce trajet de livre en livre, où quelque chose s’écrit, malgré nous, que nous percevons de plus en plus clairement, mais qui échappe, au moment même où nous nous remettons à écrire, pour finalement trouver une forme provisoire. Et tandis que je relis votre question, je me rends compte que ce n’est pas, chez moi, un genre d’écriture, - entendu au sens de poésie ou roman ou récit ou essai… - qui nourrit un autre genre, mais un genre de langage – au sens de langage photographique, cinématographique, artistique – qui permet d’interroger, de transformer, de repenser l’écriture et de trouver une forme. Dans ce cas, oui, si l’on entend ce passage, comme celui qui me conduit d’une pratique à l’autre, d’un langage artistique à l’autre, alors, sans doute. Je travaille d’ailleurs ces temps-ci à ce que je nomme le « Catalogue des œuvres inachevées » qui se tient justement à cet endroit-là : dans l’entre-genres, où j’explore comment une installation ou une vidéo nourrissent un travail romanesque, et comment la réflexion sur le livre, entre autres, fait naître une forme dans l’espace, une forme plastique ou une image…
 Écrire un roman au XXIe siècle vous semble-t-il difficile ou évident ? En d’autres termes, la forme du roman vous paraît-elle dépassée ainsi qu’on l’entend souvent ?
Écrire un roman au XXIe siècle vous semble-t-il difficile ou évident ? En d’autres termes, la forme du roman vous paraît-elle dépassée ainsi qu’on l’entend souvent ?
 Comme je vous le disais : ignorant ce qu’est la forme-roman a priori, il m’est impossible de savoir si elle est dépassée ou à venir. Peut-on dire de la « sculpture » qu’elle est dépassée ? Nous façonnons des matières textuelles. Le temps présent se pense, est pensé, réfléchit, traduit, à travers les formes qui naissent de ce façonnement. Et nous nommons cette multiplicité de formes « roman ». Dans ce cas, le XXIe siècle est tout autant dans la reconfiguration d’espaces archaïques ou de langages anciens, que dans l’émergence d’espaces nouveaux et de langages inédits. J’ai écrit un « opéra » qui est un travail sur le siècle, le présent. Ce que mon éditeur nomme « roman » dans mon travail est aussi une des formes que prend une réflexion sur le XXIe siècle. Il n’y a, pour ma part, aucune obsolescence des langages classiques. Ce qui vieillit, ce qui se fige, ce sont les conceptions et les pratiques que l’on peut avoir de ces langages. Et si nous avons aujourd’hui une perception d’obsolescence, c’est sans doute que ce que l’on nomme l’industrie a une conception très conservatrice, je dirais même réactionnaire de bien des formes de l’art. Mais je n’ai sur ce point aucune inquiétude. Les créateurs, les écrivains sont déjà en train d’inventer les formes de déplacement qui feront le roman du XXIe siècle.
Comme je vous le disais : ignorant ce qu’est la forme-roman a priori, il m’est impossible de savoir si elle est dépassée ou à venir. Peut-on dire de la « sculpture » qu’elle est dépassée ? Nous façonnons des matières textuelles. Le temps présent se pense, est pensé, réfléchit, traduit, à travers les formes qui naissent de ce façonnement. Et nous nommons cette multiplicité de formes « roman ». Dans ce cas, le XXIe siècle est tout autant dans la reconfiguration d’espaces archaïques ou de langages anciens, que dans l’émergence d’espaces nouveaux et de langages inédits. J’ai écrit un « opéra » qui est un travail sur le siècle, le présent. Ce que mon éditeur nomme « roman » dans mon travail est aussi une des formes que prend une réflexion sur le XXIe siècle. Il n’y a, pour ma part, aucune obsolescence des langages classiques. Ce qui vieillit, ce qui se fige, ce sont les conceptions et les pratiques que l’on peut avoir de ces langages. Et si nous avons aujourd’hui une perception d’obsolescence, c’est sans doute que ce que l’on nomme l’industrie a une conception très conservatrice, je dirais même réactionnaire de bien des formes de l’art. Mais je n’ai sur ce point aucune inquiétude. Les créateurs, les écrivains sont déjà en train d’inventer les formes de déplacement qui feront le roman du XXIe siècle.
 Dans vos lectures, y a-t-il surtout des romans ou trouvez-vous votre « nourriture » plutôt ou autant dans d’autres genres de livres – et si tel est le cas, lesquels ?
Dans vos lectures, y a-t-il surtout des romans ou trouvez-vous votre « nourriture » plutôt ou autant dans d’autres genres de livres – et si tel est le cas, lesquels ?
 J’entends ce mot « lecture » dans un sens très large. Cela se confond presque avec l’activité première de l’œil. Voir, lire sont pour moi deux activités inséparables. Je lis ce qui arrive jusqu’à moi et j’essaie d’en comprendre le sens. Les « romans », ou du moins ce qui m’arrive sous le nom « roman », font partie de tous les autres objets, choses, moments, êtres et comportements que je ne cesse de lire, de relire… Cela dit, il y a bien sûr des lieux de recherche, des terrains d’expérience qui s’affirment avec les années, de livre en livre : dans mon cas, c’est ce que je nomme « l’entre-des-langues », qui puise dans un certain terrain du judaïsme européen, de la Mitteleuropa, et qui est une façon de me raccorder à une pensée et une écriture de la traduction, de faire persister la vie juive européenne au XXe siècle, et la nécessité politique de créoliser l’Europe au XXIe siècle. Je lis donc de la philosophie, de la théorie de la traduction. Je me remets à lire dans les langues que je comprends et maîtrise, en anglais, en italien. Je lis bien sûr les romans de certains complices, amis, compagnons de route de notre temps littéraire et m’amuse à y trouver des thèmes partagés, des différences de voix. Je lis des œuvres d’art, des films, je lis des séries américaines…
J’entends ce mot « lecture » dans un sens très large. Cela se confond presque avec l’activité première de l’œil. Voir, lire sont pour moi deux activités inséparables. Je lis ce qui arrive jusqu’à moi et j’essaie d’en comprendre le sens. Les « romans », ou du moins ce qui m’arrive sous le nom « roman », font partie de tous les autres objets, choses, moments, êtres et comportements que je ne cesse de lire, de relire… Cela dit, il y a bien sûr des lieux de recherche, des terrains d’expérience qui s’affirment avec les années, de livre en livre : dans mon cas, c’est ce que je nomme « l’entre-des-langues », qui puise dans un certain terrain du judaïsme européen, de la Mitteleuropa, et qui est une façon de me raccorder à une pensée et une écriture de la traduction, de faire persister la vie juive européenne au XXe siècle, et la nécessité politique de créoliser l’Europe au XXIe siècle. Je lis donc de la philosophie, de la théorie de la traduction. Je me remets à lire dans les langues que je comprends et maîtrise, en anglais, en italien. Je lis bien sûr les romans de certains complices, amis, compagnons de route de notre temps littéraire et m’amuse à y trouver des thèmes partagés, des différences de voix. Je lis des œuvres d’art, des films, je lis des séries américaines…
 Que privilégiez-vous dans l’écriture d’un roman ? Une action, des personnages, une forme, un point de vue ?
Que privilégiez-vous dans l’écriture d’un roman ? Une action, des personnages, une forme, un point de vue ?
 Tout se ramène, pour moi, à l’affirmation d’une forme : une forme qui ne peut jamais être pensée a priori. Car elle doit naître de la matière du texte, de l’écriture, de la vie…
Tout se ramène, pour moi, à l’affirmation d’une forme : une forme qui ne peut jamais être pensée a priori. Car elle doit naître de la matière du texte, de l’écriture, de la vie…