La prophétie de la bécasse : sur "Les Oiseaux" de Tarjei Vesaas
Dans un de ses poèmes, Tarjei Vesaas écrit ceci :

À qui parlons-nous
quand nous nous taisons
Nous en avons besoin
pour notre voyage inconnu.
Nous en avons besoin
de manière à le sentir à nos côtés
dans l’obscur
comme lorsqu’un bon ami y respire,
respire profond dans les nuits. […]
Toi qui nais
dans la toute bruissante jeunesse.
Un jeune homme derrière sa clôture
pourrait mourir pour toi
et le fait aussi en secret.
C’est pourquoi ton voile fin
peut être là comme les primevères
de la prairie un matin d’été.
Sans un bruit tu disparais dans l’origine,
ta secrète puissance.
(Dans Être dans ce qui s’en va, trad. Eva Sauvegrain, Pierre Grouix )
J’associe mentalement ces vers au personnage de Mattis, le “héros” des Oiseaux, sans aucun doute l’un des plus beaux livres au monde. Je pourrais même paraphraser ce que Camus disait des Îles de son maître Jean Grenier, dire que j’envie "le [lecteur] inconnu qui, aujourd’hui, aborde ces [Oiseaux] pour la première fois”.
Tarjei Vesaas est né le 20 août 1897 à Vinje, une petite commune du Telemark, au sud de la Norvège. Aîné des trois enfants d’un couple de fermiers cultivés, il est prédestiné à reprendre la ferme familiale. Mais après avoir hésité, et non sans ressentir la culpabilité de ce refus, il préfère se consacrer à l’écriture plutôt que de suivre les pas de son père. Ses premiers textes sont refusés, et il en brûle les manuscrits. Il remporte néanmoins un concours de poésie et voit enfin un premier roman publié qu’il envoie aux écrivains qu’il admire, Rudyard Kipling, Selma Lagerlöf et Knut Hamsun. Grâce à des bourses d’État qu’il doit à ses livres, il voyage en Europe. Puis, cet homme solitaire qui n’aimait rien tant que trouver refuge et réconfort dans la nature, se marie avec Halldis Moren, la fille d’un poète et fermier, Sven Moren, dont il aura deux enfants. Le couple s’installe à Midtbø, non loin de Vinje, dans la ferme construite par le grand-père de l’écrivain. Auteur prolifique – une vingtaine de romans, quatre recueils de nouvelles, six recueils de poèmes et six pièces de théâtre –, son œuvre est couronnée par de nombreux prix, dont les plus prestigieux de Scandinavie, comme le Doblougprisen que lui décerne l’Académie suédoise en 1957 ou le Nordisk råds litteraturpris (le grand prix de littérature du Conseil nordique), deux ans après sa création. Plusieurs fois proposé pour le Nobel, il est élu vice-président de l’Association norvégienne des écrivains et voit même s’instituer un prix “Tarjei Vesaas” pour venir en aide aux jeunes écrivains. Il meurt à Oslo le 15 mars 1970.
La particularité de Vesaas est qu’il écrit en nynorsk, mot qui signifie littéralement “néo-norvégien”. Jusqu’en 1930, on l’appelait landsmål, autrement dit la langue des campagnes, par opposition au bokmål, la “langue du livre” parlée par 85 à 90% de Norvégiens et directement issue du danois. Depuis 1980, ces deux nynorsk et bokmål sont considérées comme langues officielles de la Norvège. Ce qui est intéressant à savoir, c’est que le nynorsk a été construit et harmonisé en s’appuyant sur les travaux du linguiste Ivar Aasen, qui a sillonné la Norvège pendant quatre ans pour recueillir tous les dialectes locaux, avant de publier une Grammaire de la langue norvégienne populaire en 1848 et un Dictionnaire de la langue norvégienne populaire deux ans plus tard. Cette langue à la fois rurale mais présentée comme un néo-norvégien relève également d’une affirmation politique qui entend, par le choix du nynorsk, s’affranchir de la suprématie culturelle danoise, entretenue par le bokmål. Dans son essai sur le bilinguisme norvégien, Emmanuelle Vigneaux explique que le nynorsk “n’est pas la langue d’une région, mais des régions, les régions périphériques, et qu’il trouve son origine dans un conflit plus large entre le centre et la périphérie”. En ce sens, ajoute-t-elle, il “est l’expression d’un nationalisme, mais ce nationalisme est régional”.
Vesaas est quasiment de la première génération d’auteurs norvégiens écrivant en nynorsk. Paru en 1957, Les Oiseaux (Fuglane en nynorsk) appartient à ce qu’il est coutume d’appeler la dernière “période” de Vesaas, où l’on retrouve son autre chef-d’œuvre qu’est Palais de glace.
Dans Les Oiseaux, on est plongé dans l’histoire de Mattis, un “simple d’esprit” de 37 ans surnommé “la Houpette”, vivant seul avec sa sœur aînée de trois ans, Hege, dans une petite maison située “dans un petit repli de terrain marécageux” au bord d’un lac, entourée d’une forêt de conifères “mêlée de bouleaux et de trembles”, avec un petit ruisseau dévalant la pente. Tout le récit tourne autour du monde intérieur confus de Mattis qui vient gonfler les rangs de ceux que l’on devrait plutôt qualifier de naïfs de la littérature, aux côtés du Candide de Voltaire, du prince Mychkine dans L’idiot de Dostoïevski, du Lennie de Des souris et des hommes de Steinbeck et de Benjy Compson dans Le bruit et la fureur de William Faulkner. Car plutôt que d’une intelligence déficiente, dans le cas de la plupart de ces personnages, peut-être faudrait-il parler d’intelligence autre. Une intelligence qui voit plus loin, mais qui ne sait pas communiquer ce qu’elle a vu.
C’est particulièrement vrai chez le Mattis des Oiseaux de Tarjei Vesaas. Cet homme, incarnant une forme de pureté et d’innocence, vit littéralement aux crochets de sa sœur, qui, pour subvenir à leurs besoins, tricote des roses à huit pétales que l’on coudra ensuite sur les chandails portés par les habitants du Telemark. Mattis essaie bien de travailler, mais ses bonnes intentions ne durent jamais. Quand un fermier voisin l’emploie à la journée pour démarier les raves, il finit par s’embrouiller dans ses gestes comme dans ses pensées : “Ça commençait par des nœuds de pensées qui descendaient jusque dans les doigts, les faisaient agir à l’inverse de ce qu’il voulait”. C’est pour cela qu’il rechigne à travailler, non qu’il soit paresseux, mais il n’arrive jamais à se concentrer bien longtemps sur ce qu’il fait, et il sait bien ce que les gens pensent alors de lui… Sans parvenir à mettre des mots dessus, il sent bien qu’il est un poids pour sa sœur : “C’est là que le bât blesse chez Hege. À longueur d’année elle m’entretient. Ça fait quarante ans que ça dure… M’entretient. M’entretient. Le mot était amer, comme quand on mâche de l’écorce de tremble”. S’il en éprouve une confuse culpabilité, elle se dissipe dans sa capacité à s’émerveiller : “Certes il aurait voulu en dire davantage et d’une autre façon, mais c’était envolé, comme d’habitude, ça s’entortillait dans des choses hors de propos”.
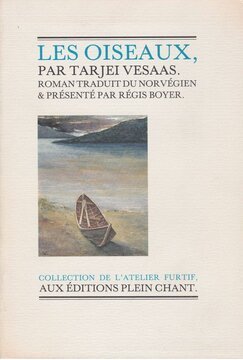
Les Oiseaux est un récit qui déployant le monde intérieur de Mattis, sur le mode du flux de conscience, un long monologue où il retranscrit tout son imaginaire dans une langue volontairement simple. On y suit la cartographie de ses rêves et de ses peurs. Sa hantise est de perdre Hege, dont le sacrifice, puisqu’il lui a incombé de s’occuper de son frère à la mort de leurs parents, fait sourdre une violence sourde tout au long du roman. De leurs échanges, jamais très longs car Mattis a le don d’agacer Hege, ils ont banni certains mots comme celui de “penser”, qui fait ressentir de façon cuisante à Mattis sa “différence” d’avec ceux qu’il appelle les gens “futés”. Ainsi, quand il tente de s’acquitter d’une tâche qu’on lui a confiée, son esprit ne tarde pas à s’égarer, mais cet égarement ouvre un monde intérieur d’une incroyable richesse dans sa perception du monde. Comme s’il accédait à un univers qui serait interdit aux autres, en raison même de ce qu’ils sont “futés”, autrement dit de leur incapacité à prendre leurs distances d’avec le langage et la raison. Pour Mattis, en revanche, tout est signe dans la nature. Et Vesaas n’établit aucune hiérarchie entre les éléments humains et le reste, lui qui, dans un entretien, avait confié que, de tous ses personnages, c’est à celui de Mattis qu’il s’identifiait le plus.
Le moindre événement prend pour lui une importance qu’il ne revêt pas pour les autres. Tout ce qu’il ressent au contact de la nature et des êtres, tout ce qui le fait ainsi vivre, aimer et souffrir, personne n’y prête attention quand il essaie d’en parler. Ainsi, cette femme qui s’assied à côté de lui et lui caresse la joue. Et surtout, la passée d’une bécasse, le plus intelligent des oiseaux à ses yeux – ce qui ne manque pas d’une certaine ironie, (existe-t-elle en nynorsk ?), puisqu’on use de ce terme pour désigner une personne idiote – survient comme une grâce qui chamboule tout en lui :
C’est à ce moment-là qu’arriva l’inattendu [écrit Vesaas].
“De ce côté-ci du vent tout est tranquille”, venait-il de penser tout en regardant au loin les deux cimes des trembles et le ciel nocturne. C’était quelque chose qui passait parmi les cimes, il s’imagina qu’il pouvait le voir, tant il faisait clair. Pas de vent, seulement quelque chose qui passait – et le temps était si tranquille par ici que pas une feuille ne bougeait sur les trembles verts.
Et puis il y eut un petit bruit. Un cri soudain, étrange. Et en même temps, il perçut quelques brefs coups d’ailes rapides, là-haut, en l’air. Puis quelques appels étouffés dans un langage d’oiseau désemparé.
Cela passa au-dessus de la maison.
Mais cela passa aussi juste à travers Mattis.
Pour lui, qui sait interpréter les signes selon sa propre sagesse, ses propres rites et croyances, la présence d’une bécasse au-dessus de leur maison est annonciatrice d’un changement : “C’était une bécasse qui venait de passer au-dessus d’ici. Et cela, les bécasses ne le faisaient pas à cette heure-là par hasard… Ça va être autrement désormais, pensa-t-il avant de s’endormir, recroquevillé dans sa banquette comme un enfant. Pour moi ?” se demande Mattis. Tout son univers tourne désormais autour de cet oiseau :
Le lendemain matin, il pensa, le cœur plein à déborder : Aujourd’hui, c’est moi et la bécasse. Comment, il ne pouvait l’expliquer. Il n’avait pas besoin d’une explication non plus. Il y avait bien des raies au-dessus de la maison – des traces de la bécasse qui était passée par ici pendant qu’il dormait cette nuit, et toutes les nuits maintenant. C’était presque un péché que de dormir. Plus Mattis pensait à la bécasse, plus il était certain qu’il arriverait de bonnes choses. Quelque chose qui serait autrement. C’était pour cela que la bécasse passait au-dessus d’ici matin et soir, mais toujours pendant que les gens étaient cachés dans leurs maisons. Cela signifiait quelque chose de bon, lui semblait-il. Évidemment, il pouvait sortir et veiller, suivre le passage de l’oiseau dans l’air aussi souvent qu’il voudrait. C’était la bécasse et lui. Aujourd’hui, c’était un jour nouveau avec elle. La bécasse comblait les pensées de Mattis.

C’est que la nature a, dans toutes ses manifestations, qu’il s’agisse d’empreintes d’oiseaux dans le sol ou de la présence de champignons vénéneux, compensé pour lui son incapacité à établir un lien avec ses semblables.
Confiant dans le présage qu’il a cru lire dans le passage de la bécasse, Mattis décide de se faire passeur sur le lac. Il répare et calfate sa barque et attend sur la rive que quelqu’un fasse appel à ses services. Il sait qu’il a enfin trouver le métier qui lui fallait, celui où ses pensées buissonnières ne seront plus une entrave. Et il attend. Il attend. Un seul client finira par se présenter, Jörgen, un bûcheron. Il n’en aura pas d’autre. Hege et Jörgen tombent amoureux, et Mattis se sent exclus du monde, de son monde. Celui qui tournait autour de son lien avec sa sœur, et celui de l’amour, car les “filles” aussi occupent ses pensées, et quand deux jeunes filles en vacances s’étaient baignées avec lui, ignorantes de qui était Mattis et du surnom qu’on lui donnait, il avait eu l’impression d’être un homme nouveau.
Incapable de chasser Jörgen du cœur de sa sœur, ni de l’empoisonner avec un champignon vénéneux, Mattis monte dans sa barque, s’enfonce sur le lac jusqu’à ce que la rive disparaisse, sent les eaux monter et crie son prénom et celui de sa sœur, et “cela fit comme un cri d’oiseau étrange sur le lac désert”. En prenant Jörgen à son bord, Mattis avait, sans le savoir, précipité l’effondrement de son monde, quotidien et intérieur. Peut-être était-ce là le véritable présage de la présence de la bécasse, qu’il n’avait pas su correctement interpréter.
Les Oiseaux de Tarjei Vesaas, traduit et présenté par Régis Boyer, éditions Plain Chant, 2012 (il en existe une nouvelle traduction par Marina Heide, parue aux éditions Cambourakis en 2022).