« une faille qui provoquera l’égarement ou l’éblouissement », Laurence Werner David
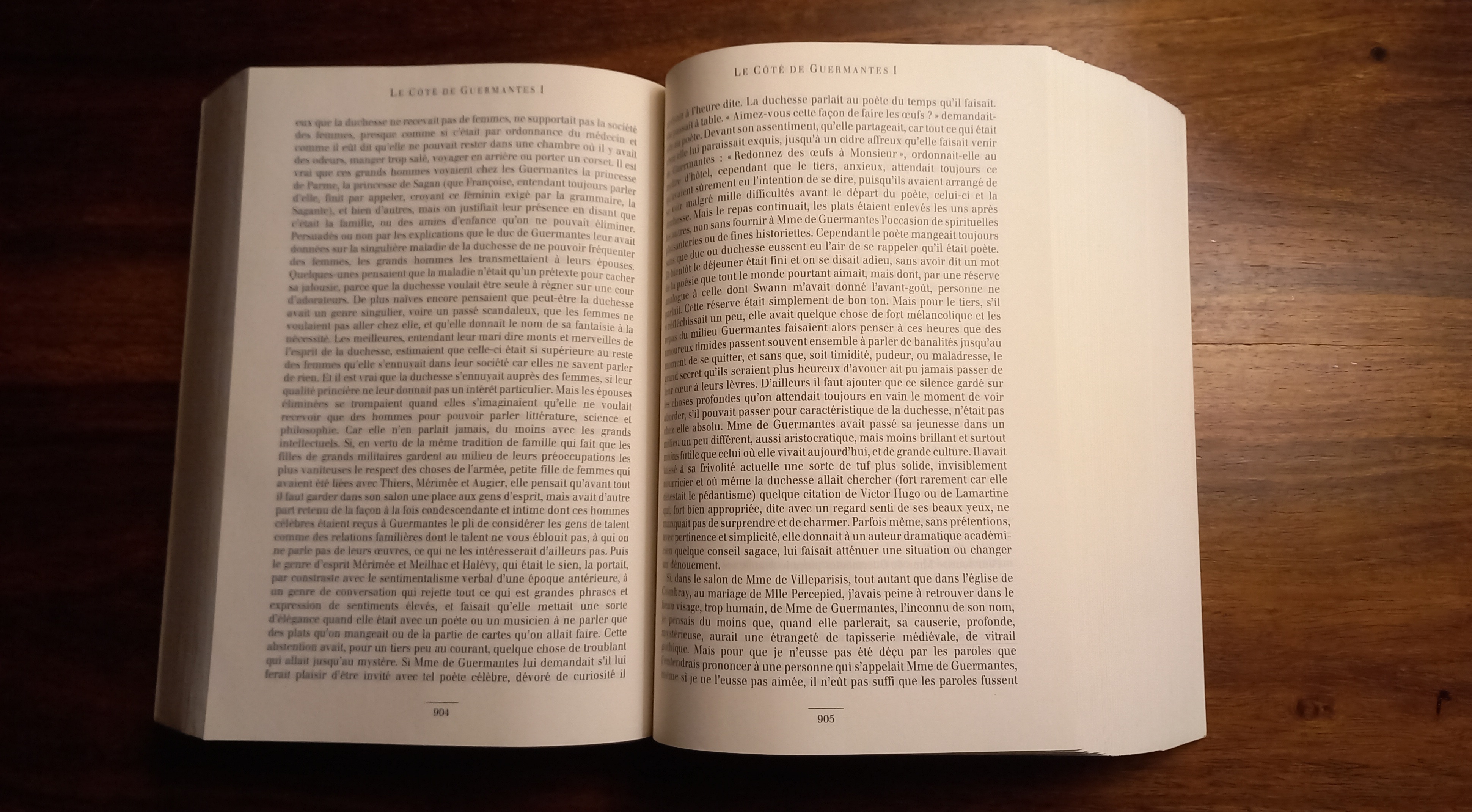
Dernier livre paru : à la surface de l’été (éditions Buchet-Chastel).
Laurence Werner David sur remue.
 1. Écrire un roman : cette forme s’impose-t-elle à vous ou est-ce une décision prise pour tel livre ? Ou une fois pour toutes ?
1. Écrire un roman : cette forme s’impose-t-elle à vous ou est-ce une décision prise pour tel livre ? Ou une fois pour toutes ? Souvent, au départ, avant de penser à la forme même d’un texte, une scène capitale s’impose à moi. Cette scène, où est concentrée mon émotion, est à l’origine du désir de relier d’autres scènes, et d’extraire toute la part matérielle, sensorielle et réflexive de chacune d’elles. Les scènes s’interpénètrent alors, s’influencent, se solidarisent à la scène centrale qui devient une chambre d’échos atmosphériques.
Souvent, au départ, avant de penser à la forme même d’un texte, une scène capitale s’impose à moi. Cette scène, où est concentrée mon émotion, est à l’origine du désir de relier d’autres scènes, et d’extraire toute la part matérielle, sensorielle et réflexive de chacune d’elles. Les scènes s’interpénètrent alors, s’influencent, se solidarisent à la scène centrale qui devient une chambre d’échos atmosphériques.  La plupart du temps, cette scène prend ancrage dans ma vie intime. C’est par ce que je suis incapable d’en saisir pendant des mois, voire des années que, par la transposition de tableaux, je quête un sens qui manque, une direction perdue : le malentendu cruel entre les deux amies d’adolescence dans Contrefort ; l’attente déçue de Martin vis-à-vis d’Antoine dans Derrière la montagne ; le sens provoqué par la vie d’un amour qui nous échappe définitivement dans Un autre Dieu pour Violette — sont, par exemple, des tentatives de cerner au plus près l’origine de l’intensité ressentie au moment où moi-même je vivais cette scène capitale.
La plupart du temps, cette scène prend ancrage dans ma vie intime. C’est par ce que je suis incapable d’en saisir pendant des mois, voire des années que, par la transposition de tableaux, je quête un sens qui manque, une direction perdue : le malentendu cruel entre les deux amies d’adolescence dans Contrefort ; l’attente déçue de Martin vis-à-vis d’Antoine dans Derrière la montagne ; le sens provoqué par la vie d’un amour qui nous échappe définitivement dans Un autre Dieu pour Violette — sont, par exemple, des tentatives de cerner au plus près l’origine de l’intensité ressentie au moment où moi-même je vivais cette scène capitale.  La scène en elle-même peut avoir été dévastatrice, ou pas, m’avoir marquée en douceur ou en profondeur — elle est toujours, en revanche, un point de butée à partir de quoi je pressens qu’assez de matière pourra venir s’aimanter dans la durée.
La scène en elle-même peut avoir été dévastatrice, ou pas, m’avoir marquée en douceur ou en profondeur — elle est toujours, en revanche, un point de butée à partir de quoi je pressens qu’assez de matière pourra venir s’aimanter dans la durée.  L’intensité trouble, difficile à capter au moment même où elle a été vécue (trouble à cause de cette intensité qui n’a pu être reconnue dans l’instant avec des mots) créant l’effet retard, est un des premiers éléments auquel je pense quand je commence à imaginer une structure pour mon livre, qui avant d’être pensé roman, est plutôt un texte qui va devenir soit fiction soit journal, soit parfois même long poème.
L’intensité trouble, difficile à capter au moment même où elle a été vécue (trouble à cause de cette intensité qui n’a pu être reconnue dans l’instant avec des mots) créant l’effet retard, est un des premiers éléments auquel je pense quand je commence à imaginer une structure pour mon livre, qui avant d’être pensé roman, est plutôt un texte qui va devenir soit fiction soit journal, soit parfois même long poème.  Je pense toujours mes scènes avant d’imaginer et de créer mes personnages.
Je pense toujours mes scènes avant d’imaginer et de créer mes personnages.  Peut-être existe-t-il aussi une blessure – ou une incompréhension alliée à une blessure - au cœur du désir d’entreprendre un texte au point de vouloir que des personnages romanesques prennent en charge cette faille — avec un jeu de points de vue plus grand que ne saurait promettre le journal intime par exemple qui, à moins d’être un journal d’autofiction, ne nous écarte par principe que peu de soi, où nous sommes toujours seul, toujours un, évoluant peu ou prou dans la même direction. Journal qui, cependant, reste un complément essentiel jusqu’à l’intégrer parfois par fragments, ou de façon exceptionnelle tout un chapitre, dans le corps du projet romanesque.
Peut-être existe-t-il aussi une blessure – ou une incompréhension alliée à une blessure - au cœur du désir d’entreprendre un texte au point de vouloir que des personnages romanesques prennent en charge cette faille — avec un jeu de points de vue plus grand que ne saurait promettre le journal intime par exemple qui, à moins d’être un journal d’autofiction, ne nous écarte par principe que peu de soi, où nous sommes toujours seul, toujours un, évoluant peu ou prou dans la même direction. Journal qui, cependant, reste un complément essentiel jusqu’à l’intégrer parfois par fragments, ou de façon exceptionnelle tout un chapitre, dans le corps du projet romanesque.  2. Que privilégiez-vous dans l’écriture d’un roman ? Une action, des personnages, une forme, un point de vue ?
2. Que privilégiez-vous dans l’écriture d’un roman ? Une action, des personnages, une forme, un point de vue ?  Faire résonner entre elles des voix est la matière qui me semble propre au romanesque, inventoriant une dimension temporelle insoupçonnée. Souvent, dans l’après-coup de l’écriture d’un roman je suis surprise de voir combien la forme romanesque donne une profondeur de champ et de temps que je n’avais pas soupçonnée au moment de l’écriture.
Faire résonner entre elles des voix est la matière qui me semble propre au romanesque, inventoriant une dimension temporelle insoupçonnée. Souvent, dans l’après-coup de l’écriture d’un roman je suis surprise de voir combien la forme romanesque donne une profondeur de champ et de temps que je n’avais pas soupçonnée au moment de l’écriture.  Ces voix démultipliées par plusieurs points de vue, s’éprouvant souvent en deçà du réel le plus instantané et le plus familier, m’émeuvent peut-être parce que j’en conserve une trace mnésique toujours plus forte que ce qui est verbalisé. Mon attrait pour ce qui est écrit - parfois très écrit - tient aussi dans le fait que plus la langue sinue et se singularise, s’éloigne du discours spontané, efficace et quotidien, plus de mondes différents se construisent autour de et devant moi.
Ces voix démultipliées par plusieurs points de vue, s’éprouvant souvent en deçà du réel le plus instantané et le plus familier, m’émeuvent peut-être parce que j’en conserve une trace mnésique toujours plus forte que ce qui est verbalisé. Mon attrait pour ce qui est écrit - parfois très écrit - tient aussi dans le fait que plus la langue sinue et se singularise, s’éloigne du discours spontané, efficace et quotidien, plus de mondes différents se construisent autour de et devant moi.  La densité de ces différences m’éloigne avec joie de toutes sortes de compulsion à la répétition, et me libère.
La densité de ces différences m’éloigne avec joie de toutes sortes de compulsion à la répétition, et me libère.  Dans l’extrême maîtrise je sais qu’il y a toujours une faille qui provoquera l’égarement ou l’éblouissement. J’aime sentir ça, cette exigence, cette précision condensée de sensations, que je reçois littéralement comme un nouveau monde. Un autre monde fragile et plein que je vais traverser.
Dans l’extrême maîtrise je sais qu’il y a toujours une faille qui provoquera l’égarement ou l’éblouissement. J’aime sentir ça, cette exigence, cette précision condensée de sensations, que je reçois littéralement comme un nouveau monde. Un autre monde fragile et plein que je vais traverser.  3. L’emprise d’un fait divers réel au cœur de la fiction romanesque.
3. L’emprise d’un fait divers réel au cœur de la fiction romanesque. A la suite de mon précédent roman, Le Roman de Thomas Lilienstein, où un seul point de vue dédoublé par deux temps de narrations différentes agissait, j’ai eu pour projet d’écrire le portrait d’un jeune homme, Tom Kemp, dont la fuite puis la disparition viendraient violemment troubler et dérégler la vie de chacun de ses proches. Chacun son tour, des individus clairement identifiés diraient ce qu’ils avaient vu, entendu de Tom Kemp et vécu avec lui. Ainsi se succéderaient et relaieraient les voix de la belle-mère et de la petite amie de Tom, puis celle de Victor, le père de Tom, et plus tard celle d’un homme qui se dirait être son frère. Occasionnellement, ces voix dialogueraient entre elles. À d’autres reprises chacun aurait recours à des carnets intimes, à des enregistrements. Une autre voix, plus spécialisée – qu’on pouvait imaginer être celle d’un avocat, ou d’un éducateur -, extérieure au noyau familial et amical, finirait par émerger dans quelques chapitres clés du roman.
A la suite de mon précédent roman, Le Roman de Thomas Lilienstein, où un seul point de vue dédoublé par deux temps de narrations différentes agissait, j’ai eu pour projet d’écrire le portrait d’un jeune homme, Tom Kemp, dont la fuite puis la disparition viendraient violemment troubler et dérégler la vie de chacun de ses proches. Chacun son tour, des individus clairement identifiés diraient ce qu’ils avaient vu, entendu de Tom Kemp et vécu avec lui. Ainsi se succéderaient et relaieraient les voix de la belle-mère et de la petite amie de Tom, puis celle de Victor, le père de Tom, et plus tard celle d’un homme qui se dirait être son frère. Occasionnellement, ces voix dialogueraient entre elles. À d’autres reprises chacun aurait recours à des carnets intimes, à des enregistrements. Une autre voix, plus spécialisée – qu’on pouvait imaginer être celle d’un avocat, ou d’un éducateur -, extérieure au noyau familial et amical, finirait par émerger dans quelques chapitres clés du roman.  Dans les quarante premières pages écrites, le père de Tom, Victor, était alors, à ce stade de l’écriture, la voix narratrice essentielle du texte. Outre la disparition de son fils, Victor relatait l’enfermement progressif dans lequel il se tenait, s’épuisant à repousser et à chasser toutes informations venues de l’extérieur. Il rompait avec ses amis, se débarrassait de son portable, changeait d’hôtel, ne se présentait plus à de nouveaux entretiens d’embauche.
Dans les quarante premières pages écrites, le père de Tom, Victor, était alors, à ce stade de l’écriture, la voix narratrice essentielle du texte. Outre la disparition de son fils, Victor relatait l’enfermement progressif dans lequel il se tenait, s’épuisant à repousser et à chasser toutes informations venues de l’extérieur. Il rompait avec ses amis, se débarrassait de son portable, changeait d’hôtel, ne se présentait plus à de nouveaux entretiens d’embauche.  Quelques jours plus tard, Victor n’avait plus qu’une seule source de communication avec l’extérieur : les journaux TV et quelques magazines que le gardien de l’hôtel lui conservait.
Quelques jours plus tard, Victor n’avait plus qu’une seule source de communication avec l’extérieur : les journaux TV et quelques magazines que le gardien de l’hôtel lui conservait.  J’avais écrit une dizaine de chapitres de Tom Kemp quand un fait divers réel – le meurtre de l’adolescente Agnès M. par un camarade de lycée en novembre 2011 au Chambon-sur-Lignon – a eu sur moi un impact brutal. Pendant une semaine les médias ne parlèrent que du viol, du meurtre et de la calcination du corps de la jeune fille de treize ans, une camarade du même lycée que l’assassin. Ils évoquaient la personnalité froide, sans émotion, de Matthieu M. L’extrême violence de son acte sans doute prémédité.
J’avais écrit une dizaine de chapitres de Tom Kemp quand un fait divers réel – le meurtre de l’adolescente Agnès M. par un camarade de lycée en novembre 2011 au Chambon-sur-Lignon – a eu sur moi un impact brutal. Pendant une semaine les médias ne parlèrent que du viol, du meurtre et de la calcination du corps de la jeune fille de treize ans, une camarade du même lycée que l’assassin. Ils évoquaient la personnalité froide, sans émotion, de Matthieu M. L’extrême violence de son acte sans doute prémédité.  On apprit qu’un an auparavant, en 2010, le jeune homme, après le viol commis sur une de ses amies d’enfance, avait été jugé non dangereux par un pédopsychiatre. Après quatre mois de détention provisoire, il avait pu intégrer comme interne l’établissement privé et mixte où était scolarisée Agnès. La PJJ ne s’était déplacée qu’une fois pour évaluer le comportement de Matthieu M.
On apprit qu’un an auparavant, en 2010, le jeune homme, après le viol commis sur une de ses amies d’enfance, avait été jugé non dangereux par un pédopsychiatre. Après quatre mois de détention provisoire, il avait pu intégrer comme interne l’établissement privé et mixte où était scolarisée Agnès. La PJJ ne s’était déplacée qu’une fois pour évaluer le comportement de Matthieu M.  Après le crime d’Agnès, les médias questionnèrent le suivi judiciaire des délinquants sexuels et la prévention de la récidive en France.
Après le crime d’Agnès, les médias questionnèrent le suivi judiciaire des délinquants sexuels et la prévention de la récidive en France.  Par contamination cet événement a infléchi le cours de l’écriture de mon texte et la vie de chacun des personnages du roman. Il a modifié jusqu’à leur personnalité et les liens qui les unissaient. Le personnage de Victor, surtout, en a été foncièrement métamorphosé.
Par contamination cet événement a infléchi le cours de l’écriture de mon texte et la vie de chacun des personnages du roman. Il a modifié jusqu’à leur personnalité et les liens qui les unissaient. Le personnage de Victor, surtout, en a été foncièrement métamorphosé.  J’ai défait le plan que j’avais imaginé pour la suite de mon texte Tom Kemp.
J’ai défait le plan que j’avais imaginé pour la suite de mon texte Tom Kemp.  Davantage que le passage à l’acte, que la monstruosité des faits ou qu’un questionnement sur les enjeux dans la fiction à vouloir se mettre dans la peau d’un criminel réel, c’est la porosité des faits divers dans notre sphère privée qui m’a d’abord paru captivante. C’est sa diffusion ravageuse au cœur des liens humains les plus étroits (d’un couple particulièrement ici, mais aussi d’une famille entière), qui décrite, détaillée — qu’il m’a semblé, à travers la forme romanesque, intéressant de questionner.
Davantage que le passage à l’acte, que la monstruosité des faits ou qu’un questionnement sur les enjeux dans la fiction à vouloir se mettre dans la peau d’un criminel réel, c’est la porosité des faits divers dans notre sphère privée qui m’a d’abord paru captivante. C’est sa diffusion ravageuse au cœur des liens humains les plus étroits (d’un couple particulièrement ici, mais aussi d’une famille entière), qui décrite, détaillée — qu’il m’a semblé, à travers la forme romanesque, intéressant de questionner.  Dans Le Roman de Thomas Lilienstein, j’avais cherché à saisir comment, à travers un créateur, le désir d’être quitte envers une dette maternelle pouvait anesthésier les liens les plus intimes.
Dans Le Roman de Thomas Lilienstein, j’avais cherché à saisir comment, à travers un créateur, le désir d’être quitte envers une dette maternelle pouvait anesthésier les liens les plus intimes.  Ici, dans Tom Kemp [1], j’ai surtout voulu cerner le rapport entre sphère publique et sphère privée : les forces destructrices qui, dans cet affrontement, sont en jeu et ce qu’elles révèlent en chacun, amis ou proches. Tom Kemp est chauffeur de taxi. Autant Thomas Lilienstein intriguait par sa tentative désespérée de créer ce que sa mère n’avait pu accomplir par elle-même, autant ici c’est un homme sans œuvre, sans médium, sans traces mémorielles objectives, qui séduit, tourmente, et façonne ceux qui l’ont connu et qui ont tous un rapport avec l’art.
Ici, dans Tom Kemp [1], j’ai surtout voulu cerner le rapport entre sphère publique et sphère privée : les forces destructrices qui, dans cet affrontement, sont en jeu et ce qu’elles révèlent en chacun, amis ou proches. Tom Kemp est chauffeur de taxi. Autant Thomas Lilienstein intriguait par sa tentative désespérée de créer ce que sa mère n’avait pu accomplir par elle-même, autant ici c’est un homme sans œuvre, sans médium, sans traces mémorielles objectives, qui séduit, tourmente, et façonne ceux qui l’ont connu et qui ont tous un rapport avec l’art.  À l’origine du projet Tom Kemp, il ne s’agit plus d’un narrateur unique et permanent pour parler d’un personnage central. C’est l’impact d’une absence, fantasmée pour certains, réelle et subie pour d’autres, que décrivent cinq protagonistes. Chacun avec des supports d’expression et des procédés mémoriels différents, à des dates sans commune mesure : parfois quinze ans séparent deux points de vue sur Tom ; parfois seulement dix minutes.
À l’origine du projet Tom Kemp, il ne s’agit plus d’un narrateur unique et permanent pour parler d’un personnage central. C’est l’impact d’une absence, fantasmée pour certains, réelle et subie pour d’autres, que décrivent cinq protagonistes. Chacun avec des supports d’expression et des procédés mémoriels différents, à des dates sans commune mesure : parfois quinze ans séparent deux points de vue sur Tom ; parfois seulement dix minutes.  4. L’écrivain, le roman, et le fait divers.
4. L’écrivain, le roman, et le fait divers.  Si j’avais donc envisagé d’enfermer un homme dans une chambre d’hôtel et de le confronter à la seule source d’informations qu’il tolérait après la disparition de son fils, c’est-à-dire une source exclusivement venue des médias, je n’avais jamais projeté de devoir affronter un fait divers au sein de la fiction, et encore moins un fait divers de nature criminelle. En tant que lectrice, je me suis aperçue que, ces cinq ou six dernières années, mes goûts ne m’avaient que rarement conduit vers ce genre de littérature contemporaine, dont je craignais sans doute les aspects les plus sordides ; livres dont je redoutais aussi qu’ils soient des prétextes embryonnaires à des questionnements sociétaux ou psychologiques, impudemment interprétatifs.
Si j’avais donc envisagé d’enfermer un homme dans une chambre d’hôtel et de le confronter à la seule source d’informations qu’il tolérait après la disparition de son fils, c’est-à-dire une source exclusivement venue des médias, je n’avais jamais projeté de devoir affronter un fait divers au sein de la fiction, et encore moins un fait divers de nature criminelle. En tant que lectrice, je me suis aperçue que, ces cinq ou six dernières années, mes goûts ne m’avaient que rarement conduit vers ce genre de littérature contemporaine, dont je craignais sans doute les aspects les plus sordides ; livres dont je redoutais aussi qu’ils soient des prétextes embryonnaires à des questionnements sociétaux ou psychologiques, impudemment interprétatifs.  C’est presque par hasard, au hasard de livres offerts, que j’ai lu Sévère de Régis Jauffret (inspirée par l’Affaire Stern), Dans la Foule de Laurent Mauvignier (Affaire du Heysel) et L’Appât de Morgan Sportès (inspirée par l’Affaire Valérie Subra), et les livres d’Emmanuel Carrère, L’Adversaire et Un Roman russe. À chaque fois, au bout du compte, je les ai abordés avec une curiosité certaine, ne serait-ce que pour le vertige qu’ils parvenaient à créer, plongeant le lecteur au cœur de l’opacité de l’être humain.
C’est presque par hasard, au hasard de livres offerts, que j’ai lu Sévère de Régis Jauffret (inspirée par l’Affaire Stern), Dans la Foule de Laurent Mauvignier (Affaire du Heysel) et L’Appât de Morgan Sportès (inspirée par l’Affaire Valérie Subra), et les livres d’Emmanuel Carrère, L’Adversaire et Un Roman russe. À chaque fois, au bout du compte, je les ai abordés avec une curiosité certaine, ne serait-ce que pour le vertige qu’ils parvenaient à créer, plongeant le lecteur au cœur de l’opacité de l’être humain.  Si j’excepte les récits à résonance autobiographique de Carrère, les autres textes ont été identifiés par leurs auteurs comme des romans.
Si j’excepte les récits à résonance autobiographique de Carrère, les autres textes ont été identifiés par leurs auteurs comme des romans.  Bien avant le choc du crime du Chambon-sur-Lignon (et avant même que se forme bien sûr le projet Tom Kemp), je me souviens de mon malaise à chaque fois que je lus un de ses romans. Un malaise non pas exactement lié au crime lui-même, mais plutôt à la place de l’auteur tel qu’il se situait face à ces drames médiatisés, parfois ultra-médiatisés et qui appartiendraient bientôt à la mémoire collective et aux annales du crime.
Bien avant le choc du crime du Chambon-sur-Lignon (et avant même que se forme bien sûr le projet Tom Kemp), je me souviens de mon malaise à chaque fois que je lus un de ses romans. Un malaise non pas exactement lié au crime lui-même, mais plutôt à la place de l’auteur tel qu’il se situait face à ces drames médiatisés, parfois ultra-médiatisés et qui appartiendraient bientôt à la mémoire collective et aux annales du crime.  Quelle position adoptait l’auteur ? Qu’en disait-il, ou qu’en taisait-il ?
Quelle position adoptait l’auteur ? Qu’en disait-il, ou qu’en taisait-il ?  Donner une ou des interprétations des faits en question, ou encore « se mettre dans la peau de » pour éventuellement traquer la part monstrueuse en soi, n’était pas ce qui aiguisait mon attention ni même attisait un désir de mettre en scène, d’être dans une langue, ma langue, pour ce corps-là.
Donner une ou des interprétations des faits en question, ou encore « se mettre dans la peau de » pour éventuellement traquer la part monstrueuse en soi, n’était pas ce qui aiguisait mon attention ni même attisait un désir de mettre en scène, d’être dans une langue, ma langue, pour ce corps-là.  Chroniquer, observer et décrire un fait divers, peut toujours être « un échangeur entre le familier et le remarquable » comme disait Michel Foucault dans un commentaire à propos de « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ».
Chroniquer, observer et décrire un fait divers, peut toujours être « un échangeur entre le familier et le remarquable » comme disait Michel Foucault dans un commentaire à propos de « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ».  Mais romancer un fait divers ?
Mais romancer un fait divers ? *
 La réalité du procès à l’ouverture duquel j’ai assisté au Puy-en-Velay le 18 juin 2013, a renforcé l’idée présente à l’origine de ma fiction : un événement extérieur, un fait divers criminel, rencontre, heurte et hante la sensibilité d’un homme, puis provoque par contagion une réaction violente au sein de son cercle familial, et amical.
La réalité du procès à l’ouverture duquel j’ai assisté au Puy-en-Velay le 18 juin 2013, a renforcé l’idée présente à l’origine de ma fiction : un événement extérieur, un fait divers criminel, rencontre, heurte et hante la sensibilité d’un homme, puis provoque par contagion une réaction violente au sein de son cercle familial, et amical.  Si une énigme policière avait dû surgir au cœur de la fiction, sa source aurait dû précéder dans le temps, et de loin, l’Affaire Agnès M., plutôt qu’avoir été élaborée à partir du crime. Dans ce cadre, et même si la question est revenue m’obséder à plusieurs reprises, l’idée de romancer le fait divers, à chaque fois, m’a paru vaine. Elle venait même s’opposer à ma démarche puisque le point central n’était pas un questionnement sur les ressorts de l’Affaire et la personnalité de ses protagonistes, mais son retentissement sur chacun des cinq personnages de ma fiction : la manière dont ce fait divers démasquait leur type de relation à l’Autre, découvrait leur culpabilité enfouie, renforçait leurs propres obsessions, réassignant une place différente aux souvenirs, aux gens, à tout ce qu’ils voyaient. Pour l’un d’entre eux, ce retentissement interrogeait l’origine du mal : s’il y en avait une et s’il était nécessaire de la circonscrire pour mieux la combattre.
Si une énigme policière avait dû surgir au cœur de la fiction, sa source aurait dû précéder dans le temps, et de loin, l’Affaire Agnès M., plutôt qu’avoir été élaborée à partir du crime. Dans ce cadre, et même si la question est revenue m’obséder à plusieurs reprises, l’idée de romancer le fait divers, à chaque fois, m’a paru vaine. Elle venait même s’opposer à ma démarche puisque le point central n’était pas un questionnement sur les ressorts de l’Affaire et la personnalité de ses protagonistes, mais son retentissement sur chacun des cinq personnages de ma fiction : la manière dont ce fait divers démasquait leur type de relation à l’Autre, découvrait leur culpabilité enfouie, renforçait leurs propres obsessions, réassignant une place différente aux souvenirs, aux gens, à tout ce qu’ils voyaient. Pour l’un d’entre eux, ce retentissement interrogeait l’origine du mal : s’il y en avait une et s’il était nécessaire de la circonscrire pour mieux la combattre.  Dans ma fiction, le crime est donc resté attaché aux faits décrits et relatés par les articles des journaux ayant couvert l’Affaire ou aux propos entendus au journal de 20 heures, rapportant des descriptions très concrètes.
Dans ma fiction, le crime est donc resté attaché aux faits décrits et relatés par les articles des journaux ayant couvert l’Affaire ou aux propos entendus au journal de 20 heures, rapportant des descriptions très concrètes.  La réalité des faits a probablement apporté une crédibilité plus identifiable au trouble et aux inquiétudes des personnages de ma fiction et surtout au mal-être de Victor, père de Tom et personnage-narrateur devenu personnage clé du roman. À la lecture des faits atroces du crime, parce que l’on sait ces faits avoir été commis en réalité, les réactions apparemment démesurées de Victor prennent un autre sens, un autre poids, et apparaissent davantage justifiées. C’est cependant le degré de l’intensité que Victor a ressenti vis-à-vis de ce fait divers-là qui reste, en partie, un mystère.
La réalité des faits a probablement apporté une crédibilité plus identifiable au trouble et aux inquiétudes des personnages de ma fiction et surtout au mal-être de Victor, père de Tom et personnage-narrateur devenu personnage clé du roman. À la lecture des faits atroces du crime, parce que l’on sait ces faits avoir été commis en réalité, les réactions apparemment démesurées de Victor prennent un autre sens, un autre poids, et apparaissent davantage justifiées. C’est cependant le degré de l’intensité que Victor a ressenti vis-à-vis de ce fait divers-là qui reste, en partie, un mystère.  L’écriture romanesque s’est concentrée à reconnaître et à décrire la charge de cette intensité.
L’écriture romanesque s’est concentrée à reconnaître et à décrire la charge de cette intensité.  Forcément, quelques jours après l’annonce du drame du Chambon-sur-Lignon et les semaines qui ont suivi l’événement, il a fallu que je m’interroge sur ce qui, dans cette histoire-là, avait provoqué un tel effroi chez moi. Le fait que l’assassin ait détruit deux jeunes adolescentes qu’il avait côtoyées - une amie d’enfance et une camarade du même lycée que lui - enfreignait un tabou très puissant : l’anéantissement de l’Autre familier. C’est sûrement un des points de compréhension sur lequel j’ai achoppé et ne cesserai d’achopper pendant l’écriture de Tom Kemp. Mais tant d’autres encore. Je ne vais pas les énumérer ici. Souvent quand je découvrais un élément du pourquoi cette histoire m’avait-elle si fortement frappée, je le notais dans un carnet à part et parfois, quand la dynamique le permettait, je l’intégrais au texte. À mesure que j’écrivais, il m’a fallu aussi affronter des zones plus troubles et plus complexes à saisir tout autant qu’à dire sur lesquels les médias étaient si souvent revenus : la calcination du corps par exemple, pourquoi m’était-elle plus horrible, irreprésentable, que le viol ou le meurtre de la jeune fille ? J’ai compris, au détour d’un cauchemar, à quelle angoisse, à quel traumatisme chez moi cette pratique de destruction totale se référait. Sans doute étais-je, par ailleurs, encore sous l’emprise des nombreux romans et documents que j’avais dû lire sur le génocide juif pour un colloque à la Maison de la culture yiddish quelques mois plus tôt.
Forcément, quelques jours après l’annonce du drame du Chambon-sur-Lignon et les semaines qui ont suivi l’événement, il a fallu que je m’interroge sur ce qui, dans cette histoire-là, avait provoqué un tel effroi chez moi. Le fait que l’assassin ait détruit deux jeunes adolescentes qu’il avait côtoyées - une amie d’enfance et une camarade du même lycée que lui - enfreignait un tabou très puissant : l’anéantissement de l’Autre familier. C’est sûrement un des points de compréhension sur lequel j’ai achoppé et ne cesserai d’achopper pendant l’écriture de Tom Kemp. Mais tant d’autres encore. Je ne vais pas les énumérer ici. Souvent quand je découvrais un élément du pourquoi cette histoire m’avait-elle si fortement frappée, je le notais dans un carnet à part et parfois, quand la dynamique le permettait, je l’intégrais au texte. À mesure que j’écrivais, il m’a fallu aussi affronter des zones plus troubles et plus complexes à saisir tout autant qu’à dire sur lesquels les médias étaient si souvent revenus : la calcination du corps par exemple, pourquoi m’était-elle plus horrible, irreprésentable, que le viol ou le meurtre de la jeune fille ? J’ai compris, au détour d’un cauchemar, à quelle angoisse, à quel traumatisme chez moi cette pratique de destruction totale se référait. Sans doute étais-je, par ailleurs, encore sous l’emprise des nombreux romans et documents que j’avais dû lire sur le génocide juif pour un colloque à la Maison de la culture yiddish quelques mois plus tôt.  Ainsi, en tout cas, une dizaine de chapitres de Tom Kemp se sont construits à partir de ce que je comprenais ou découvrais à travers ma propre histoire, angoisses ou fantasmes, reconstruisant une scène à partir de ce qui m’avait été révélé de mon rapport à l’Affaire Agnès M., au détour d’une conversation avec un ami, d’un cauchemar ou d’un état méditatif, ou d’une séance psychanalytique. Victor, ou bien l’un des cinq autres voix-personnages de la fiction, endossèrent parfois l’énigme et la découverte.
Ainsi, en tout cas, une dizaine de chapitres de Tom Kemp se sont construits à partir de ce que je comprenais ou découvrais à travers ma propre histoire, angoisses ou fantasmes, reconstruisant une scène à partir de ce qui m’avait été révélé de mon rapport à l’Affaire Agnès M., au détour d’une conversation avec un ami, d’un cauchemar ou d’un état méditatif, ou d’une séance psychanalytique. Victor, ou bien l’un des cinq autres voix-personnages de la fiction, endossèrent parfois l’énigme et la découverte.  Quand on y parvient, ce qui est bien avec le montage de telles scènes (un symptôme ou une idée = une scène) c’est qu’elles rendent plus inutiles les explications.
Quand on y parvient, ce qui est bien avec le montage de telles scènes (un symptôme ou une idée = une scène) c’est qu’elles rendent plus inutiles les explications.  5. Réel et fiction : d’un espace à l’autre, des tensions dramatiques sans commune mesure.
5. Réel et fiction : d’un espace à l’autre, des tensions dramatiques sans commune mesure.  Durant les trois semaines qui ont suivi le procès de Matthieu M., l’assassin d’Agnès M., je n’ai pas pu revenir à ma fiction.
Durant les trois semaines qui ont suivi le procès de Matthieu M., l’assassin d’Agnès M., je n’ai pas pu revenir à ma fiction.  Ma fiction s’est comme fondue dans un autre temps, sans commune mesure avec le présent des actes décrits : trop de visages rompus d’angoisse, ceux des parents et grands-parents de la jeune fille assassinée ; trop de regards intenses entre des êtres réels que les liens de filiation, sous mes yeux, ont rapprochés et étreints, sans un retour possible à l’apaisement. Trop d’échanges sur des faits éprouvants qui avaient déjà impliqué, pour la famille des victimes, une violence biographique inouïe.
Ma fiction s’est comme fondue dans un autre temps, sans commune mesure avec le présent des actes décrits : trop de visages rompus d’angoisse, ceux des parents et grands-parents de la jeune fille assassinée ; trop de regards intenses entre des êtres réels que les liens de filiation, sous mes yeux, ont rapprochés et étreints, sans un retour possible à l’apaisement. Trop d’échanges sur des faits éprouvants qui avaient déjà impliqué, pour la famille des victimes, une violence biographique inouïe.  L’espace du réel (ici le procès) ne coïncidait plus avec la mise en tension dramatique de ma fiction initiale.
L’espace du réel (ici le procès) ne coïncidait plus avec la mise en tension dramatique de ma fiction initiale.  Tétanisée, je l’étais, peut-être par la personnalité de l’assassin derrière la vitre blindée qu’on avait créée pour ce procès : un garçon apparemment indifférent aux tortures qu’il a infligées à ses victimes. Tétanisée par autre chose que je n’ai pas su tout de suite saisir et qui, je le pressens seulement aujourd’hui, a sans doute à voir avec le fait que dans la salle d’audience composée pour l’essentiel de journalistes, je suis la seule à penser à l’écriture d’une histoire à partir de cette Affaire, et non d’abord et ponctuellement à relater le procès pour un organe de presse.
Tétanisée, je l’étais, peut-être par la personnalité de l’assassin derrière la vitre blindée qu’on avait créée pour ce procès : un garçon apparemment indifférent aux tortures qu’il a infligées à ses victimes. Tétanisée par autre chose que je n’ai pas su tout de suite saisir et qui, je le pressens seulement aujourd’hui, a sans doute à voir avec le fait que dans la salle d’audience composée pour l’essentiel de journalistes, je suis la seule à penser à l’écriture d’une histoire à partir de cette Affaire, et non d’abord et ponctuellement à relater le procès pour un organe de presse.  Bien plus que la personnalité d’un criminel lambda, ce qui continuait à me mobiliser dans ce projet, différent des autres par le croisement de ses sources (fiction/ événement intime/ fait réel), était la propension à se répercuter d’un fait criminel, officialisé par les médias, dans notre sphère domestique la plus intime.
Bien plus que la personnalité d’un criminel lambda, ce qui continuait à me mobiliser dans ce projet, différent des autres par le croisement de ses sources (fiction/ événement intime/ fait réel), était la propension à se répercuter d’un fait criminel, officialisé par les médias, dans notre sphère domestique la plus intime.  L’énigme essentielle de mon texte restait, dans sa dynamique, entièrement attachée aux cinq personnages de la fiction, à leurs cinq voix, et à l’absent : Tom Kemp.
L’énigme essentielle de mon texte restait, dans sa dynamique, entièrement attachée aux cinq personnages de la fiction, à leurs cinq voix, et à l’absent : Tom Kemp.  À ce moment de l’écriture, juste avant l’été 2013, Tom Kemp est sans doute autant une série de récits autobiographiques pensés de manière romanesque qu’un roman construit de manière autobiographique.
À ce moment de l’écriture, juste avant l’été 2013, Tom Kemp est sans doute autant une série de récits autobiographiques pensés de manière romanesque qu’un roman construit de manière autobiographique.  6. Absorption et arasement du réel par la fiction :
6. Absorption et arasement du réel par la fiction :  Pendant l’été 2013, la tentation fut forte de quitter définitivement la fiction, de mettre dans un tiroir la centaine de pages déjà écrites, et de m’attacher uniquement à la scène du jugement.
Pendant l’été 2013, la tentation fut forte de quitter définitivement la fiction, de mettre dans un tiroir la centaine de pages déjà écrites, et de m’attacher uniquement à la scène du jugement.  Cet intérêt à décrire dans le détail les rouages et attitudes des protagonistes de l’Affaire Agnès M., et au fond de réécrire un texte à partir de l’Affaire elle-même s’est cependant estompé. Pas effacé, estompé seulement. À la mi-juillet 2013, soit quinze jours après le verdict, je me suis trouvée dans une impasse : refus du témoignage, rejet de ma fiction. Pendant quelques semaines, je n’ai plus écrit. Je suis partie en vacances. De cette période sans écriture, je ne garde de ma fiction et des individus présents au procès, que des souvenirs synesthésiques. S’y sont associés, pendant ce temps de vacances, et s’y associent encore dans ma mémoire aujourd’hui, des mouvements climatiques sur les plages de la Manche. Eux-mêmes se mêlent avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins d’acuité, à l’atmosphère que j’avais ressentie le jour de l’annonce du drame du Chambon-sur-Lignon.
Cet intérêt à décrire dans le détail les rouages et attitudes des protagonistes de l’Affaire Agnès M., et au fond de réécrire un texte à partir de l’Affaire elle-même s’est cependant estompé. Pas effacé, estompé seulement. À la mi-juillet 2013, soit quinze jours après le verdict, je me suis trouvée dans une impasse : refus du témoignage, rejet de ma fiction. Pendant quelques semaines, je n’ai plus écrit. Je suis partie en vacances. De cette période sans écriture, je ne garde de ma fiction et des individus présents au procès, que des souvenirs synesthésiques. S’y sont associés, pendant ce temps de vacances, et s’y associent encore dans ma mémoire aujourd’hui, des mouvements climatiques sur les plages de la Manche. Eux-mêmes se mêlent avec plus ou moins de conscience, avec plus ou moins d’acuité, à l’atmosphère que j’avais ressentie le jour de l’annonce du drame du Chambon-sur-Lignon.  Dans ce grand écart estival et géographique, éloignée de la pièce dans laquelle j’ai pris l’habitude d’écrire depuis des mois jusqu’au procès, ce n’est plus le réel de l’histoire du Chambon qui m’emporte mais à nouveau les voix de Tom Kemp. Quelque chose s’est unifié entre le réel de l’Affaire et ma fiction en suspens. Il me semble, aujourd’hui, que cette unification découle d’un arasement du réel, davantage que d’une volonté de combler ma fiction par le souvenir que j’ai du procès.
Dans ce grand écart estival et géographique, éloignée de la pièce dans laquelle j’ai pris l’habitude d’écrire depuis des mois jusqu’au procès, ce n’est plus le réel de l’histoire du Chambon qui m’emporte mais à nouveau les voix de Tom Kemp. Quelque chose s’est unifié entre le réel de l’Affaire et ma fiction en suspens. Il me semble, aujourd’hui, que cette unification découle d’un arasement du réel, davantage que d’une volonté de combler ma fiction par le souvenir que j’ai du procès.  J’ai abandonné l’idée du procès comme point culminant de ma fiction. Le procès comme une butée essentielle deviendra sans doute l’ultime ponctuation du roman plutôt que son point de bascule.
J’ai abandonné l’idée du procès comme point culminant de ma fiction. Le procès comme une butée essentielle deviendra sans doute l’ultime ponctuation du roman plutôt que son point de bascule.  La scène du procès a gardé bien sûr des saillies : visage de l’assassin ; corps des parents de l’assassin et des parents des victimes. La représentation que j’avais de l’accusé, elle, a perdu pour ainsi dire une part de sa consistance. Victor, le personnage central de ma fiction, s’est chargé de forces sensorielles neuves. C’est lui — et elle, l’écriture qui lui avait été attachée dès le début -, sa personne, sa vie, sa réaction hors du commun à l’Affaire, qui reprenait ; Victor rendu plus énigmatique que l’assassin peut-être parce que pour ce dernier : dossiers, expertises psychiatriques, verdict de perpétuité, semblaient avoir finalisé quelque chose. Une narration, en tout cas : une histoire.
La scène du procès a gardé bien sûr des saillies : visage de l’assassin ; corps des parents de l’assassin et des parents des victimes. La représentation que j’avais de l’accusé, elle, a perdu pour ainsi dire une part de sa consistance. Victor, le personnage central de ma fiction, s’est chargé de forces sensorielles neuves. C’est lui — et elle, l’écriture qui lui avait été attachée dès le début -, sa personne, sa vie, sa réaction hors du commun à l’Affaire, qui reprenait ; Victor rendu plus énigmatique que l’assassin peut-être parce que pour ce dernier : dossiers, expertises psychiatriques, verdict de perpétuité, semblaient avoir finalisé quelque chose. Une narration, en tout cas : une histoire.  Durant l’écriture de ce nouveau texte, je me suis retrouvée confrontée au « comme si c’était vrai » de manière aussi problématique que dans un roman où le noyau essentiel du projet aurait été pure fiction. Mais, outre le fait que démontrer l’influence de la sphère publique sur notre sphère privée aurait été sans doute moins crédible en inventant un fait divers criminel de toutes pièces, la chronique intime ne m’aurait pas permis non plus, par réserve ou pudeur pour les familles concernées par l’Affaire, d’atteindre et de faire se répercuter des histoires propre aux dérèglements de chacun de mes personnages. D’une voix à l’autre, d’un point de vue narratif confronté à d’autres, de part en part du travail sur la langue et des interrogations sur l’origine du mal, ce qui aura toujours dirigé l’action de cette fiction c’est ce que je pourrais appeler « le précipité des sensorialités atmosphériques » : cette matière perceptible par nos sens que reçoit et perçoit dans toute sa singularité un être en proie à un événement subi et la façon dont cette perception se distille par la suite depuis son intimité jusqu’à ses liens avec autrui.
Durant l’écriture de ce nouveau texte, je me suis retrouvée confrontée au « comme si c’était vrai » de manière aussi problématique que dans un roman où le noyau essentiel du projet aurait été pure fiction. Mais, outre le fait que démontrer l’influence de la sphère publique sur notre sphère privée aurait été sans doute moins crédible en inventant un fait divers criminel de toutes pièces, la chronique intime ne m’aurait pas permis non plus, par réserve ou pudeur pour les familles concernées par l’Affaire, d’atteindre et de faire se répercuter des histoires propre aux dérèglements de chacun de mes personnages. D’une voix à l’autre, d’un point de vue narratif confronté à d’autres, de part en part du travail sur la langue et des interrogations sur l’origine du mal, ce qui aura toujours dirigé l’action de cette fiction c’est ce que je pourrais appeler « le précipité des sensorialités atmosphériques » : cette matière perceptible par nos sens que reçoit et perçoit dans toute sa singularité un être en proie à un événement subi et la façon dont cette perception se distille par la suite depuis son intimité jusqu’à ses liens avec autrui.L.W.D.
12 mars 2014
[1] À l’époque de la rédaction de ces feuillets pour remue.net, Tom Kemp est un roman en cours de réalisation.