60- Dans le cadre de l’exposition Thierry Bouchard de Carcassonne, une communication sur Joë Bousquet.

Elle est ouverte du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél 04.68.72.50.83.
Cette exposition est magnifique : celui que beaucoup d’éditeurs typographes considèrent comme le plus grand artisan de sa génération (Thierry Bouchard a travaillé de 1978 - il avait vingt et un ans - jusqu’à sa mort en 2008) a été, non seulement un typographe hors pair, mais encore un lecteur admirable : en témoignent la richesse de son catalogue de plus de trois cents ouvrages, et le génie qu’il eut de faire se rencontrer les poètes, les peintres et les graveurs prestigieux de son époque.
De là ces livres merveilleux de lumière et de justesse, qui allient à l’invention de la couleur et des formes la perfection d’une ligne et d’une mise en page dont la discrétion et la finesse donnent le sentiment de l’évidence et de la nécessité.
C’est ce que l’exposition de Carcassonne met en évidence dans la grande salle du premier étage, aussi bien que sur les murs du couloir qui conduit vers la chambre de Joë Bousquet.
Sur son site, aussi bien que dans la chronique qu’il donne à Poezibao, Alain Paire rend compte de cette exposition mieux que je ne saurais le faire, parce qu’il est un grand connaisseur de l’histoire des éditions Th. B., dont il défend la cause et le génie propre avec une grande générosité, en même temps qu’il retrace les grands moments de la vie de Thierry Bouchard, son engagement, le choix qu’il fit d’un travail à l’écart de la vie littéraire parisienne, dans une solitude dont la raison était la défense du poème. On n’oubliera pas aussi que Thierry Bouchard, sous le nom de Jean-Baptiste Lysland, fut lui-même poète [1].
Dans le cadre de l’exposition Thierry Bouchard, et après une journée d’inauguration et de lectures, le lendemain la matinée était consacrée à de nombreux témoignages des auteurs des éditions Th. B., après quoi une rencontre était organisée sur la question de l’écriture poétique autour de Joë Bousquet, René Nelli, Jean Malrieu, Gaston Puel [2]
Je donne ci-après le texte de ma communication sur Bousquet.
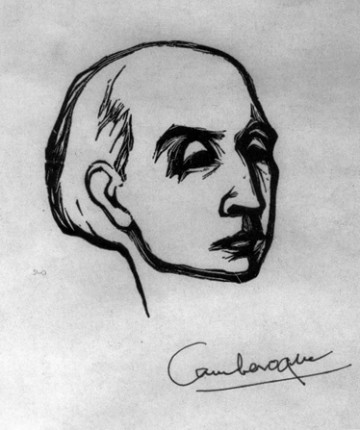
Je vous propose le commentaire d’une note de Bousquet [3], parue dans Les Cahiers du Sud en janvier 1939, et qui présente un livre de Lucien Becker, Passager de la terre.
La lecture que fait Bousquet de ce livre expose de façon très explicite les grands principes qui gouvernent sa conception de la poésie, de la poésie moderne, conception dont cette chronique d’une page est comme le modèle opératoire, conception dont la rigueur et l’intransigeance exemplaires ont bien des choses à dire, soixante-dix ans après, à la poésie actuelle.
Faute de temps je ne dirai pas à quel point sont contenus dans cette page les prémices des développements ultérieurs de la pensée de Bousquet, ceux dont la crise morale et physique qui l’affecte huit mois après, en 1939/1940, précipitera l’émergence, au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, au moment où la blessure de 1918 se réactive.
Tous événements dont Alain Freixe [4] a montré le caractère décisif à partir de quoi Bousquet acepte sa blessure comme origine même de sa vie, comme expérience désirable, à aimer, à vouloir.
Voici comment commence cette note de Bousquet :
Les poètes qui ont dénoncé l’éloquence n’avaient envie que de la sauver ; une élocution poétique qui est subordonnée à l’expérience d’un homme ne peut avoir de fin que l’éloquence. L’erreur a duré jusqu’à nous (…) La poésie restait analytique, ergoteuse avec grâce, soumise implacablement à la logique du discours. (…)
La parole des meilleurs leur ouvrait un monde où le sens de leurs paroles les empêchait d’entrer.
On voit bien ce que recouvre cette critique de « l’éloquence ».
L’éloquence, comme toute forme de rhétorique, suppose un monde en ordre, la soumission « à la logique du discours », dit Bousquet, la soumission aussi à une exigence de sens, dont il affirme ici qu’elle est un handicap :« La parole des meilleurs leur ouvrait un monde où le sens de leurs paroles les empêchait d’entrer ».
Ces meilleurs demeurent encore piégés par ce monde en ordre, ce monde cartésien, qui fonde les valeurs, les canons esthétiques et éthiques d’une littérature, et qui privilégie du même coup ce que Bousquet appelle « l’attitude critique » [5], celle qui « proclame les droits de celui qui ne veut pas sortir du sens commun ». C’est elle aussi, cette attitude critique, qui, par voie de conséquence, décide de la figure de l’écrivain qu’il faut être.
Or c’est précisément cet ordre-là que Bousquet, et un certain nombre de poètes refusent, tout en affirmant inaugurer une époque nouvelle de la poésie : « L’erreur a duré jusqu’à nous », dit-il, Ce « nous » recouvrant le groupe des amis qui l’entourent aux Cahiers du Sud, et, parmi les surréalistes, Eluard surtout, Char, les peintres, Max Ernst avant tout.
Or quelle est la première exigence de ce grand refus sinon précisément le refus de la littérature, que Bousquet ne cesse de revendiquer, dans des formules-chocs comme celles-ci : « L’art d’écrire m’a déshabitué de tout souci littéraire » [6], ou : « On n’est pas un poète tant qu’on n’a pas accepté d’être au-dessous de l’écrivain » [7] ; quelques mois plus tard (1941) Traduit du silence sera l’effectuation remarquable de cette protestation.
Tout le long débat entre Ballard, Bousquet et Albert Béguin autour du Romantisme allemand (un an avant la note sur Becker : février et avril 1938) est aussi l’écho magnifique des positions de Bousquet, lequel considère que « sortir de l’attitude critique » héritée de Descartes est la première des conditions pour l’invention d’une poésie nouvelle.
Que suppose sortir d’une attitude critique, sinon modifier l’orientation du regard, ce mauvais filtre.
Mais comment ? « Une lumière flotte sur le monde (…) invisible (…) elle nous est cachée par notre regard qui a pris dans notre conscience le nom et la place de chaque objet. » [8]
Quelle méthode qui ne soit pas un nouveau Discours de la méthode, mais qui inaugure une reconversion, un retournement, et en conséquence une réévaluation de notre rapport au monde. Cette méthode, la note sur Becker la décrit, et montre quelle clairvoyance peut l’animer.
Bousquet, d’abord, évoque la venue de ces : « poètes plus clairvoyants [qui] ont compris que, pour changer l’expression, il fallait créer des façons nouvelles de sentir. Se réclamer d’une nouvelle attitude morale : favoriser l’insurrection du réel et qu’elle brisât les sceaux du temps, de la causalité. Quant à la pensée, elle avait assez à faire à s’empêcher de penser. »
Briser les sceaux du temps, de la causalité, s’empêcher de penser sont des expressions fortes qui dénoncent à nouveau les impasses poétiques où mènent les positions idéalistes que j’ai rappelées plus haut.
Ce mouvement d’effraction, qui est une sorte de trahison, suppose des renoncements, et provoque des souffrances.
Quand on sait les liens très forts qui unissent Bousquet à Rilke – deux ans avant cette note, il écrit à Poisson d’or [9] : « Il a fallu que je le lise pour savoir que j’avais une patrie » - on comprend la portée de l’incidente suivante dont j’ai fait abstraction précédemment, et que voici : « L’erreur a duré jusqu’à nous », disait Bousquet, et il ajoute : « à nous qui n’avouons qu’avec un déchirement que Rilke c’est déjà le passé »…
Et donc, quelle attitude, quels chemins nouveaux rendent possible la révélation attendue, celle qui donnera la primauté au réel sur la pensée, comme si le réel s’insurgeait contre toutes les représentations qui falsifient son visage, ce que résume la formule « insurrection du réel » ?
Interrogeons à nouveau la note sur Becker :
Ce poète est, écrit Bousquet, le premier qui ait connu que notre foi dans la vie venait d’elle, non de nous. Il a saisi le réel dans son frémissement qui est le souffle même et l’aperçu de sa profondeur. Ce qu’il perçoit du réel, il l’appréhende avec sa foi, non avec ses sens, comme si sa vision l’avait introduit dans un paradis perdu dont elle ne touchait elle-même que les débris calcinés.
Le mot fort ici est « foi » : notre foi dans la vie venait d’elle ; ce qu’il perçoit du réel, il l’appréhende avec sa foi ; un peu plus loin, il parle de la perception comme d’un « acte de foi » ; il ne parle plus de regard, mais de « vision » ; il évoque enfin les traces d’un paradis perdu.
Or que peut-on opposer à l’approche du réel par la raison discursive, sinon le mouvement d’une intuition dont la puissance est souvent associée par Bousquet à l’expérience d’un « vertige » (« La vérité doit être notre vertige avant de se poser comme vérité » [10]. ), d’une « éclaircie » [ou ailleurs d’une “aventure”] cosmique(s) [11], d’une « expérience mystique », dit-il à propos de Becker, mais aussi d’une sorte de tension ou de libération aorgiques dont il reconnaît les traces dans le romantisme allemand, et dont, à l’évidence, lui parle aussi toute la tradition occitanienne et cathare.
Il faudrait dire aussi un mot sur les rapports entre cette intuition et l’esprit d’enfance, dont Bousquet parle fréquemment, comme ici, à Poisson d’or : « la poésie c’est … de prêter une voix enfantine et pure comme l’eau à ces clartés mystiques », ou encore : « C’est à force d’être un enfant qu’on devient un homme » [12] ; mais il faut bien préciser que l’image de l’enfance n’est jamais l’occasion d’une plainte nostalgique : elle correspond au contraire, pour employer un concept deleuzien, à un « devenir enfant », à ces « blocs d’enfance » dont parlent Deleuze et Guattari, projetés dans l’avenir avec toute leur puissance de « déterritorialisation ».
La référence à l’enfance est explicite aussi dans une autre formule de la Lettre à Ballard de mai 1942, qui dit « du poète moderne », lequel jouit d’une liberté neuve, d’une liberté libre, dirais-je pour évoquer Rimbaud, qu’« il n’est que le berceau de celui qu’il est » ; « sa vie est pour toujours en enfance ».
Or une telle liberté, fille d’une nouvelle naissance, d’une ouverture à l’intuition d’une éternité, comprenons bien qu’elle est conquise aussi sur tous les faux-semblants, les postures sociales et psychologiques, les errances psychiques auxquels le « moi » avait recours pour pallier la douleur du temps qui passe et les blessures de la vie. En vérité, c’est bien une « immolation du moi » qui conditionne « l’accès de l’être total à la poésie » [13], de sorte que « Narcisse ne voit plus rien et ne se voit même plus », qu’il « ne réclame plus sa part d’encens », comme Bousquet l’écrit à Denise Bellon en 46.
Cette ascèse est celle que déjà Bousquet reconnaît chez Becker en 1939, notant que ce poète « renoue la contemplation intérieure dont le cours du temps avait tranché le fil », admirant comment il réussit à donner langue à une subjectivité qui supprime le moi, créant « une poésie ardente à se forger des illusions qui nous enlèvent l’illusion dont on meurt », libérant enfin la vie et l’expérience de leur misérable tas de secrets, comme le dit la formule connue, de ces secrets dont la psyché n’était que le résidu, libérant la vie dans un poème enfin, une œuvre remarquable, dit Bousquet de Becker, où le mot « je » n’est pas une fois prononcé.
« Il y a un langage, dit Le Livre heureux [14], qui ne parle pas au nom d’un moi, mais au nom d’une vie. »
Qu’est-ce alors qu’écrire selon le vœu de Bousquet qui est aussi celui d’une poésie objective et non plus subjective, pour parler comme Rimbaud, qu’est-ce alors qu’écrire, sinon assumer dans la patience la tâche poétique qui consiste à libérer la langue elle-même, à la faire advenir dans une nouvelle innocence, « laissant les mots opérer leur renaissance », acceptant à l’avance, autre formule de Bousquet, « tous les accidents d’une marche dans le noir. »
Que ce vœu, que ce travail du poète soient accomplis, c’est-à-dire : que l’innocence du geste artistique et poétique laisse la forme « créer de l’être », comme le dit Bousquet du travail de Max Ernst, au rebours de ce qu’affirme la tradition idéaliste pour laquelle c’est l’être qui commande la forme, de même que pour elle l’essence précède l’existence, que ce vœu de libération, donc, soit accompli, et alors viendra au jour cette poésie dont Bousquet célèbre l’avènement dans la conclusion de sa note sur le Passager de la terre de Lucien Becker : « La lumière qui éclaire ces pages n’a touché à rien. Elle est pure comme le vent. »
On connaît cette définition de « Papillon de neige » : « La poésie est le salut de ce qu’il y a de plus perdu dans le monde. »
Elle dit bien ce qu’est le poème : à la fois un avènement, puisqu’il y est question d’un salut, et un évènement, au sens de ce qui surgit, qui était jusque là encore imprévisible, et qui pourtant transforme la vie.
Mais : « ce qui est perdu », comment l’entendre ?
Perdu, me semble-t-il, d’abord comme l’entendrait le sens commun, à savoir : par exemple ma blessure, qui m’isole du monde de mes semblables, et qui est à leurs yeux ma perte ; ou alors ce qui est en moi, par mon refus, perdu pour la société, pour ses valeurs éthiques, esthétiques, politiques…
Eh bien nous savons, selon la formule d’Albert Béguin, quelle est « la grande réponse vitale » de Bousquet à toute menace de perte, et en premier lieu à cette menace qu’est sa blessure elle-même.
C’est cette réponse qui lui permet d’écrire à Denise Bellon : « Je n’ai été que l’ombre d’un fait à revêtir de sa perfection. »
Tel est bien le sens d’une vie en poésie : opérer cette reconversion, ce retournement dont la vie en poésie est le chemin.
Je vois Bousquet comme l’un de ces « grands vivants à la santé fragile », dont Deleuze parle, Deleuze, qui met par ailleurs l’exemplarité stoïcienne de Bousquet au cœur de son chapitre sur l’événement dans Logique du sens : « ou bien la morale n’a aucun sens, ou bien c’est cela qu’elle veut dire, elle n’a rien d’autre à dire : ne pas être indignes de ce qui nous arrive. » Bousquet dit : « ne soyons pas indignes de ce que nous incarnons. »
La poésie invente la langue qui effectue cette volonté d’être celui que ma vie me dit que je suis.
Je voudrais terminer sur une seconde remarque.
Bousquet écrit ceci : « J’ai voulu forger un langage à moi, mais que tout le monde comprenne, et d’une parole confidentielle faire la voix de toutes les peines. »
Cette phrase est très belle.
Belle en ce qu’elle soulève la question la plus aiguë que puisse poser au poète l’observation de sa propre écriture, dès lors qu’il réussit à se faire, comme le dit aussi Bousquet, « son propre auditoire », à savoir : y a-t-il une légitimité à rendre publique une confidence (voix confidentielle, dit Bousquet) quels qu’aient été par ailleurs les efforts et le travail pour échapper à toute complaisance à soi, pour se libérer du moi.
Mais surtout, question plus générale encore : par quelle alchimie le plus intime peut-il concerner l’autre, et l’atteindre, « comment la singularité d’une écriture peut-elle être encore la clé ou la voie de son universalité » ? [15]
Comment, dit encore Bousquet, « purifier la parole et lui ajouter ce que la voix est seule à faire entendre » tout en évitant l’écueil de la subjectivité « fadasse » que déjà Rimbaud dénonçait ?
Cette question n’est pas la mienne seulement. Elle est aussi celle de Bousquet.
Albert Béguin en avait senti, chez Bousquet, la brûlure, puisqu’il relève ce « paradoxe qui consiste à vouloir tirer au grand jour cela même qui n’est fécond que grâce à la protection de sa nuit. »
Ce chemin-là est obscur.
En lui réside cependant tout l’enjeu du poème, toute la petite, ou la grande dramaturgie de l’écriture.
Tout dépend de qui l’on parle…
[1] La photo de Thierry Bouchard date des années 70.
[2] Toujours dans le cadre de cette exposition, deux rencontres sont organisées les 25 et 26 novembre sur le thème de « La poésie des troubadours. »
[3] Le portrait de Bousquet est l’œuvre de Jean Cambéroque
[4] Voir, in Joë Bousquet et le génie de la vie publié par les Cahiers Joë Bousquet et son temps 2. (2000), l’article d’Alain Freixe : « Tournant, tourne et retour chez Joë Bousquet ».
[5] Voir le débat sur le romantisme allemand publié dans Les Cahiers du Sud en avril 1938
[6] Le Livre heureux, I. Revue Fontaine, « De la poésie comme exercice spirituel », réédition 1978, Le Cherche midi éditeur, p. 133.
[7] Lettre à Jean Ballard, mai 1942, p. 8. Archives de la ville de Marseille.
[8] Ibidem, p. 4.
[9] Lettre du 6/09/37.
[10] Les Cahiers du Sud, février 1938 : « En marge du numéro sur le romantisme allemand »
[11] « Je connais les aspects successifs de mon moi comme les prolongements d’une aventure cosmique dont il est troublant de constituer à la fois la conscience et l’avatar ». » Ibidem, p. 291.
[12] Le Livre heureux, op. cit., p. 189.
[13] Sur le romantisme allemand, op. cit., p. 135.
[14] op. cit ;, p. 197.
[15] Voir Marc Crépon, « Partages de la singularité : Derrida lecteur de Celan », in Derrida et la question de l’art, éditions Cécile Defaut, mars 2011.