La jubilation et la tristesse : « la blessure de l’esclavage est quelquepart-là. »

Chantal Anglade : lorsque je vous lis, j’ai deux sentiments, on va dire contraires, mais on va dire aussi que la contradiction ne me dérange pas du tout : il y a d’une part une jubilation énorme, vos personnages sont d’une vitalité qui fait du bien : d’autre part, il y a une ... je ne dirais pas une « mélancolie » car ce serait se rapprocher de Hugo, mais une tristesse insondable, à l’image du personnage de Lysiane dans Brin d’amour ou peut-être plus intimement de vous-même lorsque par exemple dans Ravines du devant-jour, vous racontez qu’en début d’adolescence, tout à coup, vous ne pouvez plus saluer votre père comme vous le saluiez auparavant, vous hochez la tête. Lysiane dit « je cherche la porte de sortie de ce monde étriqué et laid ». Contradiction entre une forme de jubilation et ce qui est de l’ordre de la désespérance...
Raphaël Confiant : Oui, derrière l’exagération jubilatoire de mes personnages, il y a une profonde tristesse ; tous mes personnages sont tristes, même ceux qui sont des rigolards des quartiers populaires ; d’ailleurs le personnage que j’aime le plus, c’est Philomène, la prostituée, « la négresse féérique », qui vit dans des phantasmes permanents, des rêves, des chimères, et n’arrive pas à les réaliser, mais qui tient le coup devant la vie. C’est le rire qui a sauvé le Nègre, qui l’a sauvé du naufrage total. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la réaction post-esclavagistes ne soit pas violente. Si on compare avec les Arabes par exemple, on s’aperçoit que lorsque les Arabes sont opprimés, leur réaction est immédiatement violente : ils se révoltent. Mais quand on prend les Noirs - voyez Mandela ! - il n’y a pas cette réaction. Même au plus profond de la détresse, il y a cette capacité de jouissance, il faut le dire ; on maintient le contact avec le côté le plus salvateur de l’existence, et cela rend incapable de fanatisme. Après l’esclavage, on n’a pas vu les Noirs massacrer les Blancs, même en Haïti...
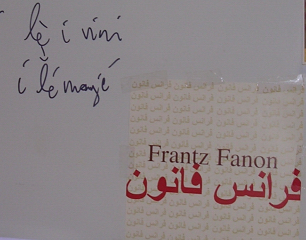
Ch.A. : En Guadeloupe ...
R.C. : Non, en Guadeloupe, ce ne sont pas les Noirs qui ont massacré les Blancs, ce sont les Révolutionnaires français envoyés par la Constituante qui sont venus avec la guillotine. Ils ont dit « où sont les nobles ? », et ils leur ont coupé la tête !
Il y a une tristesse profonde parce que c’est un monde à deux faces : une face jubilante qui masque la face triste et qui permet de survivre ; on a besoin de survivre ! on peut survivre par la violence, par la révolte, mais on peut aussi survivre par la jubilation dans un monde où on est dominé ; c’est cette manière de survivre là que j’essaie d’exprimer à travers mes livres. Il y a une résistance ; ce n’est pas vrai que le peuple martiniquais se laisse dominer ; tout ce qu’il a créé, la musique créole, la cuisine créole, toutes ces créations culturelles sont la manifestation d’une résistance, mais ce n’est pas une résistance violente avec des fusils, des bombes, c’est une résistance faite par le jubilation, l’amour de la vie, le rire, mais le tout sur un support d’amertume, de souffrance, parce que la blessure de l’esclavage est quelquepart-là. Plus les générations avancent, plus la blessure s’estompe. Pour un jeune de dix-huit ans d’aujourd’hui, l’esclavage c’est comme Clovis pour un petit Français-Gaulois d’aujourd’hui, ça veut rien dire ! Il a une vision théorique de l’esclavage. Mais ma mère, qui a quatre-vingt-quatre ans, a pu connaître quelqu’un qui était esclave, parce que l’esclavage a été aboli en 1848, et ma mère naît en 1918, elle a pu connaître des gens nés avant 1848 ! ce n’est jamais que cinquante ans, hein ! Quand je lui pose la question, elle me dit « non, ce n’est pas possible », et je lui dis « je te démontre mathématiquement que c’est possible », et elle répond « c’est vrai ! autour de moi, quand j’étais enfant, il y avait des gens qui ont connu l’esclavage ! et comment cela se fait qu’ils n’ont jamais parlé de cela ? c’est curieux ! ». Donc, ce n’est pas si loin, l’esclavage, jusqu’à ma génération ! Mais pour la nouvelle génération, je pense que c’est réglé.
Ch.A. : Et pourtant, je trouve qu’on en parle de mieux en mieux...
R. C. : Mais c’est sur un plan intellectuel ! les jeunes qui en parlent, ils en parlent comme une atitude comme on dit en Anglais, une revendication qu’on jette au visage de l’autre ; ce n’est pas une douleur vécue réellement ...
Ch. A. : Vous croyez ?
R. C. : Non ! je ne crois plus parce que je suis au contact de tous ces jeunes, et pour eux c’est loin. Et pourquoi c’est loin ? C’est parce que le monde dans lequel a évolué l’esclavage, c’est celui de l’Habitation. Or, l’Habitation s’effondre dans les années 60. C’est pourquoi Chamoiseau et moi nous avons coutume de dire que nous sommes devenus vieux à l’âge de quinze ans parce que le monde dans lequel nous avons été élevés s’est effondré quand nous avons eu quinze ans. Normalement le monde de quelqu’un s’effondre quand quelqu’un a soixante-dix ans. C’est l’Habitation qui est porteuse du souvenir de l’esclavage. Les trois quarts des Martiniquais vivent à Fort-de-France-Lamentin-Schoelcher, ils ne vivent pas dans la campagne. Les jeunes qui sont dans un univers de ...banlieue française, où le centre de la culture où on traîne le samedi-dimanche, c’est les bandes, le cannabis qui circule ; ce monde est à mille lieues de la plantation de canne à sucre, et mon fils me dit « mais tes romans, pour moi, c’est des trucs de vieux, j’essaie de lire ça, c’est un autre monde ! de toute façon, moi, je suis un citoyen du monde ... »
Ch. A. : C’est vrai que vous n’écrivez pas exactement sur le monde d’aujourd’hui ...
R. C. : Oui, parce que je ne peux pas l’écrire parce que mon imaginaire est lié à la plantation. Je ne peux pas écrire sauf dans de manière dérisoire, je l’ai fait dans des petits bouquins à dix francs, pour me moquer du monde moderne et montrer que cet univers-là n’est pas le mien. Je n’ai pas l’imaginaire d’une voiture, d’une télévision, d’un ordinateur, ...
Ch. A. : Le paysage est daté. Est-ce que les personnages existent encore ?
R. C. : Oui, ils existent mais de manière marginale. Ils existent encore dans certains quartiers, mais ils sont remplacés ; par exemple le major de quartier était respecté unanimement parce qu’il avait une force physique considérable, mais aussi il faisait respecter l’ordre, il était le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Mais aujourd’hui, le major de quartier c’est le dealer de drogue, il ne respecte même pas sa propre mère. Certes, on a le même phénomène du fier-à-bras de quartier, mais les valeurs ont été totalement inversées : c’est un prédateur ! parce que le major , lui, il défendait les faibles, il essayait d’établir une sorte d’équilibre. C’est fini ! On a les mêmes figures, mais on n’a plus le même sens derrière ces figures.
Ch. A. : Le Combat-damier n’existe plus ?
R. C. : Si, mais c’est une danse folklorique interprétée par des groupes de sauvegarde du patrimoine. Ce n’est plus fait de manière spontanée. Moi, je ne suis pas très musique. Quand j’ai écrit Le meurtre du samedi-gloria dans lequel le héros est un combattant de damier, c’est plus l’aspect combat que musique qui me plaisait. Et tous les gens du damier étaient très contents, ils sont venus me voir, et l’un m’a dit « mais tu t’es réconcilié avec la musique ! ton personnage se couche par terre, il écoute les vibrations du sol ! moi aussi, quand je combats, j’écoute les vibrations ! où tu as appris ça ? » ; je lui ai répondu « ah ! tu sais, c’est juste une image », il était profondément déçu ! C’est plus l’aspect sociologique du combattant du damier que la musique ! la musique, c’est un univers qui m’est très étranger.
On assiste à une sorte de déstructuration du monde créole traditionnel où on a l’illusion d’une continuité, mais c’est juste une façade, et même quelquefois cela tourne à la caricature ! Quand on prend une mairie aujourd’hui en Martinique, c’est la reproduction crachée de l’Habitation : le maire, c’est le Béké ; le secrétaire de mairie, c’est le commandeur de plantations ; et il y a les petits chefs ; et enfin, il y a les employés de mairie qui sont traités comme des coupeurs de canne, et le droit de cuissage fonctionne comme sur l’Habitation ! mais la grosse différence, c’est que l’Habitation était productive au moins ! Elle fabriquait du rhum et du sucre, tandis que la mairie ne produit que de la paperasse. Le maire est comme le béké d’antan, il licencie un tel, il déplace un tel, il bourre les urnes...Il y a une comportement habitationnaire qui continue mais dans un monde qui n’est plus habitionnaire, donc ça tourne à la perversité.
Ch. A. : Mais les élections, les dernières élections, elles n’étaient pas si mal, en Martinique ! Alfred Marie-Jeanne ...
R. C. : Là, c’est pour des élections locales. On vote pour les Indépendantistes ici, non pas parce qu’on est indépendantiste mais parce que les Indépendantistes sont des gens intègres.
Ch. A. : Oui, c’est ce que je vous dis ! on a ces votes qui sont beaux !
R. C. : On vote pour l’intégrité. Ces intègres aimeraient qu’on vote pour eux pour d’autres raisons que pour l’intégrité.
Ch. A. : Les Indépendantistes ont tout de même des mairies.
R. C. : Oui, mais quand on voit le taux d’abstention, on s’aperçoit que la moitié de la population ne vote pas. C’est totalement ambigu comme victoire...
Les autres volets de l’entretien à lire :
— Premier volet : Le prochain roman de Raphaël Confiant, confidences : Adèle et la pacotilleuse.
— Deuxième volet : Créolité dans la langue romanesque - « Moi j’ai l’ambition de replonger dans les strates profondes du Français et je retrouve en quelque part ce qui a donné naissance au Créole ».
— Quatrième volet : Chabin-chabine - Lady Diana est une chabine !
— Cinquième volet : La panse du chacal et le pardon demandé aux Indiens
— Sixième volet : Beauté de la canne à sucre et pauvreté de la banane