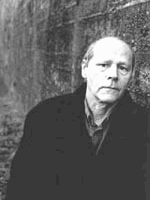| Yaël Pachet: Pierre Michon,
vous êtes reconnu par vos pairs comme un écrivain qui offre
déjà la possibilité d’interroger son oeuvre:
plus qu’une curiosité à votre égard, les commentaires,
les thèses universitaires ou les entretiens, les discussions ou
colloques manifestent une quasi-fascination pour la figure d’écrivain
et le sens profond de cette figure que vous avez construite avec Vies
minuscules, d’une part et d’autre part une interrogation vive
à propos de l’effet de mystère créé par
une densité tout à fait particulière à votre
narration, et une langue tendue vers un climax . Comment ressentez-vous
cet endroit d’interrogations où vous êtes et que vous
êtes?
Pierre Michon: Cette histoire de reconnaissance ne veut sans doute
pas dire grand chose. Je pense souvent à la façon dont Apollinaire
et Jarry se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés parce
que tous les deux aimaient passionnément Moréas, le poète
Jean Moréas. Je me souviens que l’introducteur de l’Apollinaire
en plèiade dit très joliment : en 1905 tout le monde admirait
Moréas - et on pensait sans doute que sa place était centrale,
même des gens comme Apollinaire ou Jarry le pensaient de tout leur
coeur. Pour ce qui est des instances de reconnaissance en France et sans
doute ailleurs c’est très différent de ce que c’était
il y a cinquante ans. Il y a cinquante ans c’était l’Université
et le staff NRF. Maintenant l’Université n’a plus de
pouvoir, elle s’est laissé doubler sans combat. Le pouvoir
est passé du côté des média, c’est à
dire du côté des journalistes de la presse écrite
ou télévisuelle. Ce pouvoir de légitimation ne recoupe
pas celui de l’Université et la plupart du temps y est même
opposé ( j’ai l’impression que tout doucement, c’est
l’Université qui est passée du côté de
l’anticonformisme). Quoi qu’il en soit les media décident,
et c’est plus compliqué que ça: à l’intérieur
de ces média tous n’ont pas les mêmes choix d’objets
de reconnaissance. En ce qui me concerne, il y a ce groupe qu’on
peut appeler Le Monde-Libé, pour lequel j’existe , et puis
le groupe qu’on peut dire Le Figaro- Bouillon qui ne me connaît
pas, si bien que ce que vous me dites là de ma reconnaissance,
n’importe quel écrivain qui a une bribe de notoriété
aujourd’hui pourrait l’entendre. Quelqu’un qui fait la
une du Figaro peut penser qu’il est l’écrivain le plus
représentatif de son temps. Question de coteries. La démocratie
fait que nous sommes tous des écrivains majeurs.
Y. P. Je précise ma question. Il me semble tout de même
que dans les interrogations portées sur votre oeuvre, il y a non
seulement de la reconnaissance, mais une curiosité pour un écrivain
contemporain et la façon dont son travail fait trembler à
nouveau la littérature, particulièrement le récit,
plus précisément encore les vies (Plutarque, John Aubrey),
genre ancien, sinon mort, qui trouve chez vous une nouvelle énergie.
En avez-vous conscience et dans quelle mesure le débat littéraire
qui vous entoure vous intéresse-t-il?
P. M :Il s’agit bien en effet d’un débat contemporain
plus ou moins tu ou affiché dont le coeur serait cette question
inavouée que tout le monde se pose: le roman n’est-il pas
un genre exténué, un peu comme l’était la tragédie
classique au temps de Voltaire? Et, dans la mesure où je ne baisse
pas tout à fait les bras, c’est à dire dans la mesure
où je fais des petits textes qui ressemblent tout de même
à des romans, brefs, mais des romans (je ne suis pas le seul) je
me sens proche de beaucoup d’autres contemporains immédiats
qui essaient aussi de sortir du roman sans effets de manche, sans prétendre
tout démolir, sans ostentation. Mais fermement et absolument.
Parmi ceux-là beaucoup s’intéressent à la forme
brève, reprennent la forme brève, mais des formes brèves
qui ne seraient pas ce que le siècle dernier a appelé la
nouvelle, et qui n’est qu’un morceau de roman. Et nous avons
à notre disposition la forme très ancienne des vies qui
n’a jamais cessé d’être - on me prête, à
moi et à d’autres, le fait d’avoir réinstauré
ce genre qu’on a toujours fait, mais c’est une tarte à
la crème, il n’y a là ni invention ni retour. Cette
forme , que j’appelle vie par commodité, me parait être
le roman débarrassé de son grand fourbi, ou fourre-tout.
Je vais m’expliquer par une métaphore pharmaceutique. Vous
savez, dans la notice des médicaments, on lit par exemple: pénicilline:
0,5% -et excipient: 99,5%. Et bien, le roman tel qu’il se pratique
aujourd’hui de plus en plus me paraît être un gigantesque
excipient dans lequel la pénicilline est perdue. Ce genre que j’appelle
une vie , ça n’est après tout que le roman débarrassé
de ses copules, de son tirage à la ligne, de sa " pensée
" et de son remplissage. Il est vrai que les romans de Flaubert par
exemple étaient des vies sans copule: Vie d’Emma Bovary ou
Vie de Felicité qui ont reçu par la suite d’autres
titres.
Y. P. Ce changement de format entre le roman du dix-neuvième
et les " vies " du vingtième tient-il alors moins à
un changement de genre, qu’à un changement de souffle ou d’énergie?
P. M. :A mon sens, le roman long, romanesque, sans excipient, puissant
sans bavardage, a été mené à son terme au
vingtième siècle dans des expériences comme celles
de Joyce ou Faulkner, qui ne sont plus faisables. Ils ont mené
le genre à sa dernière perfection. Nous vivons un temps
d’épigones de ces gens-là, bien sages, bien pensants,
bien obéissants, bien révolutionnaires, qui sont tellement
en dessous de leurs modèles. Pour reprendre la métaphore
de la tragédie classique, après Corneille et Racine c’était
fini: il y a eu des épigones encore pendant deux siècles,
jusqu’à Ponsard, qui était contemporain d’Hugo.
Mais la chose était morte. Des spectres.
Mais je généralise trop. Je ne peux répondre en fait
à cette question qu’en mon nom propre. Il se trouve en effet
que mon énergie, ou ma jouissance d’écrire, ne se déploie
que dans le bref. Le geste artistique qui me parait le plus admirable
au monde est celui de ces vieux peintres orientaux légendaires
qui pendant dix ans ne font rien, vont se promener au bord de l’eau,
et qui tout à coup en deux minutes et trois coups de pinceau font
un admirable canard. On est loin du travail de forçat auquel notre
temps voudrait astreindre nos romanciers: un, voire deux livres par an
, beaucoup de souffrances et de labeur perdus à chercher des copules.
Faire du bref, c’est aussi, idéologiquement, échapper
au piège de la production, de la libre entreprise, du marché.
Y. P.:Vous ne ferez pas croire à vos lecteurs,
Pierre Michon, que vos productions littéraires vous tombent du
ciel?
P. M :Bien sûr que non, et bien sûr que je travaille
de façon extraordinairement intense, mais qui dure peu. Ce que
je me demande et peut-être ce que je demande à la littérature
est que la rédaction d’un texte soit une fabuleuse dépense
d’énergie, aveugle mais très consciente, pleurante
et riante, limitée dans le temps, comme la copulation.
Y. P . Ce que vous dites sur la forme est dans le
fond de vos récits, mais il me semble qu’on y trouve aussi,
avec les fulgurations, paradoxalement, de la durée, des sentiments,
ce qui s’étale dans le temps et n’apparaît que
dans la très longue durée d’une vie- ou même
de l’Histoire.
P. M. Je dirais bien d’abord que la forme la plus bouleversante
de la durée c’est celle qu’on lit sur une pierre tombale.
Un tel, dix mars 1912, deux juilllet 1988. On peut considérer que
c’est une ellipse, mais cette ellipse est en même temps une
hyperbole. Et bien mes récits sont souvent construits autour d’une
ellipse hyperbolique. Je vais prendre un exemple archi-connu de cet oxymoron,
l ’ellipse hyperbolique: on peut transformer la durée en fulgurance
: qu’y a t-il d’autre dans ce vers si connu de Rimbaud et pourquoi
nous plait-il tant : ô saisons, ô châteaux? La lenteur
des saisons, la pérennité des châteaux y sont dits
dans la fulgurance de l’instant, d’un vers de six pieds. La
durée est un éclair.
Y.P. Il y a tout de même un paradoxe dans cette
séduction exercée sur vous par la forme elliptique d’une
part et votre érudition d’autre part, qui témoigne
bien d’un attrait puissant pour les connaissances, le savoir encyclopédique,
les livres de pure érudition dont le format est forcément
large.
P. M. Ce n’est pas du tout un paradoxe. Je demande à
la littérature que j’écris d’être brève,
mais je tiens à ce que cette brièveté soit informée
de tout ce qu’il y a eu lieu et a été pensé
et dit depuis qu’il y a des hommes. Et sans aller chercher si loin,
pour que le bref soit fulgurant, il faut que sa formulation, sa mise en
mot, soit totalement exacte. Par exemple, si dans un texte j’ai à
parler de fauconnerie, il vaut mieux que je sache qu’on dit de tel
faucon non pas qu’il a un vol lent, mais qu’il " bat large
". Lire des gros livres, c’est enrichir sans cesse son lexique;
c’est-à-dire avoir à sa disposition pour un même
sens une dizaine de mots de longueur différente; et cela est essentiel
au rythme. Et le rythme est premier.
Y. P. Le rythme propre à vos récits
n’est évidemment pas celui de ces gros livres, mais n’est-ce
pas tout de même ces gros livres plus que vos lectures de textes
brefs d’autres écrivains qui vous ont donné non seulement
la possibilité mais peut-être l’autorisation de la brièveté?
P. M. Ces gros livres ont l’avantage d’être écrits
chacun dans une langue spécifique (il est évident que la
langue d’un géologue n’est pas celle d’un astrophysicien,
et que celle de Buffon n’est pas tout à fait celle de Leroi-Gourhan).
Le texte littéraire doit connaître toutes ces langues, en
jouer, les déplacer, les recombiner à l’infini. Et
même pour ce qui est du rythme, il est capital d’avoir à
sa disposition le stock conceptuel le plus étendu possible: car
le ryhtme, c’est un mélange indissociable d’émotion
forte et d’un choix lexical presque infini.
Y. P. Quittons un instant l’horizon conceptuel
et revenons si vous le voulez bien à certaines récurrences
dans vos récits. Je voudrais évoquer par exemple la représentation
du corps, son apparition crue et signifiante, d’autant plus crue
peut-être qu’elle est formulée dans une langue châtiée
à l’extrème. Il me semble que la forme brève
fait comme la peinture, elle rapetisse et encadre le corps, pour faire
davantage saillir son apparence.
P. M. : Il est vrai qu’il m’est essentiel de faire textuellement
apparaître des corps, comme par exemple nous le faisons tous dans
le fantasme. Je ne peux voir les corps que sous deux espèces: celle
de la pornographie et celle de la Résurrection des Corps. C’est-à-dire
le corps le plus vil et le plus glorieux, au même instant dans la
même personne.
Il va de soi que tout cela doit être dit dans une langue mi-théologique
mi-érotique, donc comme vous dites châtiée, volontiers
ancienne et dix-septiémiste, ou aussi bien argotique et franglaise,
mais non pas ordurière. L’ordure n’est que pornographie
sans la théologie. Je pense à l’instant à l’oeuvre
de Pierre Klossovski qui a beaucoup usé de ce mélange -mais
je lui reproche un peu d’être plus théologique que pornographique
c’est à dire trop abstrait. On peut de même reprocher
à Sade d’être plus pornographique que théologique.
Finalement je vais encore revenir à Flaubert: rien n’est plus
charnel que la chaînette d’or qui retient les pas de Salammbô.
La langue est une contrainte. Elle corsète la chair. La chair est
la proie de la langue.
Pour en rester au corps et pour répondre à votre question
sur les relations entre la peinture et les formes littéraires brèves:
il me semble que le roman, et la musique sans doute, parlent du désir,
du plaisir, et des ratés du plaisir. La peinture et la forme brève
ne saisissent que l’instant de la jouissance.
Y. P. : Pour finir, justement, dans toutes les formes
littéraires, le poème, le roman, la question de la chute
se pose. C’est une question de forme et de fond qui, bien que ne
concernant que le dernier vers ou le dernier chapitre, rétrospectivement
détermine l’unité du poème ou du roman. La peinture
ou la forme brève ont-elles aussi en elles ce chemin à parcourir
vers une chute ou sont-elles carrément des chutes en soi?
P.M. :Le roman ne sait pas qu’il va au petit bonheur, comme
dans la vie. Le roman est le singe de la vie . Il est de la durée,
de la durée qui aime la durée. Sa chute vient comme la mort
dans la vie, mais ça nous connaissons, on s’en fout. ( Borgès
dit, "le roman est une superstition de notre époque ",
mais Borgès est très poli ) . La forme brève, qui
ne singe que l’art, poème ou récit, n’a que son
incipit et sa chute. Comme la flèche de l’archer n’est
déterminée que par la décision de l’archer et
la cible. La trajectoire de la flèche est un parfait petit vol
plané entre les deux: c’est le texte , ou ce qui veut passer
pour tel. Pour ce qui est de la peinture, comment ne pas l’envier,
elle qui dans le même moment et la même main tient son incipit
et sa chute? |