56 - Il ne suffit pas de bégayer –
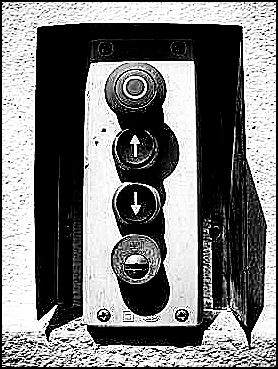
Il y a tant de poèmes, de grands textes. C’est magnifique. Cela permet de ne plus se poser la question d’écrire ; ou plutôt, cela ne laisse pas d’autre choix que de mal écrire.
La littérature ravive la plaie, fait briller la ligne qui me court devant le museau, cette fuite éperdue qui cherche le "mal écrire", cette fuite qui voudrait se défaire du plaisir sous toutes ses formes. Non par masochisme, ou par jeu stérile, mais parce que la masse de ce qui existe n’entretient aucun rapport avec cette tenue de langue. Cette masse, elle est là, dans sa médiocrité, empoisonnée par son jus.
De la nécessité d’écrire des choses qui donnent le sentiment du ratage. Du non-littéraire. Du pompeux, du véritablement nul, de tout ce qu’on voudra de cet ordre, sans jamais se récupérer à un moment ou à un autre. Sans jamais faire comprendre au lecteur qu’un écrivain, un vrai, se cache dans la coulisse. Qui prendrait un tel risque ? Qui risquerait de se fondre dans la masse du trivial avec sa langue, avec son talent, corps et âme, cul nu ?
De cette nécessité de vouloir faire entrer dans le livre ce qui ne devrait pas s’y trouver : Le style journalistique à deux balles, pire encore, les ragots du coin de rue, pire encore, le mode d’emploi crasseux qu’un mec utilise pour faire dieu sait quoi, mais tout sauf quelque chose qui pourrait avoir un certain style....
Je crois que parler des choses simples et des gens humbles dans un style élevé, ou irréprochable ou romain, ou simplement personnel, reconnaissable entre mille, affirmé quoi, eh bien, cela n’est pas juste. C’est un peu mettre l’aborigène empaillé au Musée de l’Homme. Je me tapais gentiment la tête contre les murs cette nuit. J’ai relu les « Vies minuscules » et je me disais, ce que c’est beau, quel château ! Mais il faudrait une cabane, une bâche, une vareuse mouillée, je ne sais pas, moi, une serpillère, un papier gras.
Ils sont tous à vouloir faire le Panthéon, cela me désespère... cela me tombe dessus avec la violence des corneilles. Ils sont tous là à dire "ouhlala je suis à la marge, t’as vu ça gamin", et d’espérer qu’on les mette sur le trône, bien au centre, pour grand génie avéré. Que voulez-vous ? Et moi, qu’est-ce que je veux ? L’intelligence fondue à cracher des pleurs. On crache en gueulant, ce sont des battements de ver. On connaît tous ça. Ceux qui écrivent, comme ceux qui n’écrivent pas. Ce sont ces moments où on croit entendre grincer l’humanité. Cela ne dure pas. Cela vient par crises. Et puis s’en va en laissant des plis.
Les vrais artistes, évidemment... ils donnent force... oui. Mais ils éveillent cette plainte terrible qui n’a ni beauté, ni valeur, cette plainte qui dit : "je suis ce qui ne sait pas écrire, je suis ce qui n’a pas voix au chapitre ! Pourquoi parles-tu à ma place, pourquoi me fais-tu parler comme un livre ?"
On ne dit rien des choses humbles, des gens disgraciés, en cimentant des monuments. Plus le poème est beau, plus il tue ce qui existe sans talent. Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour s’approcher de ceux-là... peut-être sacrifier le peu de talent dont on dispose soi-même. Écrire mal. Descendre d’échelon en échelon jusqu’au minable. Jusqu’à ce que les autres disent "il a sacrément baissé, il avait un ou deux textes dans le placard, pas plus, dommage, etc, etc...". Il faudrait peut-être avoir le courage insensé d’ouvrir sa propre écriture à ce misérable, et de lui ménager ainsi un espace. Au détriment de toutes les œuvres qu’on pourrait accomplir. Laisser venir ce qui n’a pas droit au chapitre. Ce qui ne sait que faire de la tribune qu’on lui offre. Cette immense masse d’êtres et de choses. La majorité. Le réel.
Je ne connais pas un écrivain qui se soit risqué dans cette aventure. Tu penses ! Écrire comme un pied ne fait bicher personne. Mais où laissera-t-on venir le merdique, si ce n’est en littérature ? Faire asseoir un pouilleux à sa table amène des poux à toute la famille et empuantit la maison. C’est la loi. On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre. Mais alors ce misérable, ce juste vivant et c’est tout, aurait aussi sa vitrine. La seule en ce monde de mépris pour ce qui est sans valeur esthétique, morale ou marchande. Puisqu’il n’est misérable que d’être délaissé.
Il faudrait oser la langue moche, je veux dire le truc minable, pour dire le banal de manière banale... finalement, il ne s’agit pas d’humilité. Ni beau, ni laid, ni fait, ni à faire, gris souris, voilà de quoi il s’agit... Il faudrait laisser vraiment le style pendu au clou et écrire comme on voit dans les feuilles de choux, sans rien qui viendrait prétendre sauver quoi que ce soit - juste le style déplorable de ce réel déplorable, mis à plat, comme ça. Dignité, légitimité de l’existant. C’est tout.
Cette obsession n’en finit pas de me relancer - donner voix au raté, au pesant, au disgracieux ... ce serait un peu comme de la poésie pure alors, un peu comme si la langue descendait vraiment parmi le trois fois rien et le bric-à-brac de cageots, sans qu’on puisse la différencier d’eux. Ce serait l’Arche de Noé pour tous les canards boiteux, sans se soucier de rien d’autre et surtout pas de soi. Faire un livre à cette masse, c’est aussi faire du livre une masse.
La question qui se pose : comment distinguer un tel texte, raté, de tous les autres textes nuls ? Et là, aucune réponse. Tabler sur l’intention de celui qui écrit ?
Je ne connais personne qui s’y soit risqué. Peut-être à raison. La mystique n’est pas faite pour être prise au pied de la lettre. Et la littérature, son boulot, c’est de faire semblant. Mais je n’aime pas ce job.
Il ne suffit pas de bégayer à l’écrit ou à l’oral, de se rouler par terre, d’amasser des miettes ou de lancer ses excréments. Cela n’est rien. Cela, c’est encore Ronsard. Cela a encore de la tenue. Puisqu’on trouve encore des gens pour aimer ça.
On provoquerait la fin des temps en écrivant un texte qui ne plairait à personne. Après deux lignes, chacun dirait « mais quelle merde, c’est nul à chier, ça me tombe des mains, sans intérêt. » Il n’y aurait vraiment personne pour s’y arrêter. On aurait alors réussi à sauver quelque chose. À ramasser le dégoût avec les lèvres. Amen.