L’art du continu
Un entretien de Jean-Paul Goux avec Annie Clément-Perrier, Europe n° 854-855, juin-juillet 2000.
et repris sous une forme légèrement modifiée dans La Voix sans repos (éds du Rocher), chapitre intitulé Par expérience.
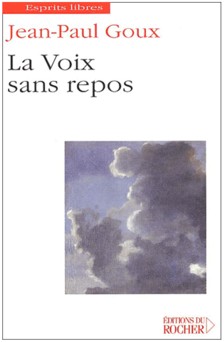
Depuis son premier livre, Le Montreur d’ombres paru en 1977, Jean-Paul Goux interroge dans une oeuvre romanesque envoûtante et complexe la mémoire de la langue, celle des paysages, des villes et des jardins, des maisons et des bibliothèques qui composent les « champs de fouilles » de ses romans et l’infini palimpseste d’un héritage symbolique dans lequel il se sent profondément pris. Un héritage que l’écrivain aime à imaginer comme « ces sites sumériens où les couches ne sont pas simplement accumulées et superposées » mais où il arrive que « les plus anciennes remontent au jour, (...) comme si, au fond, les temps s’étaient entremêlés » . « Que l’œuvre soit comme le Temps, un mouvement d’épaisseur infinie », lisait-on dans Lamentations des Ténèbres. C’est cette matière invisible du Temps dont rend compte sa matière romanesque, tant dans les rêveries temporelles et spatiales qui s’y déploient que dans l’ampleur ondoyante et ramifiée d’une syntaxe aux longues cadences, désireuse de « tirer à elle toute l’attention fascinée qu’on portait dans le roman traditionnel aux combinaisons de l’intrigue » . C’est cette réflexion sur le Temps, impérieuse et vitale, que montre déjà de façon concrète l’écriture fine, dense et serrée saturant d’un bord à l’autre les pages manuscrites des romans ; une écriture que Jean-Paul Goux imagine comme « une pâte prise dans les durées qu’elle mêle en en rendant sensibles les profondeurs » ou « une masse de mercure en mouvement », une écriture qui « cherche à durer, à repousser le plus tard possible le moment où elle s’achèvera » (Les Leçons d’Argol), et qui « occupe le temps pour se le soumettre et le rendre réversible » (La Fabrique du continu). C’est encore la réflexion sur le temps qui donne le branle aux rêveries sur la langue et ses usages assez vieux « pour vous mettre en une seconde dans des mondes infiniment éloignés de tout ce que vous êtes » (La Maison forte). Ou aux rêveries archéologiques qui mettent en mouvement des forces qui savent creuser le fond des choses ou aident à sentir le poids de l’héritage, celui des filiations et des généalogies. Il n’y a aucune nostalgie dans cette fascination pour les mille dépôts du temps, mais bien le souci de chercher dans les traces du passé le sens de cette grande puissance inconnue qui nous mène, d’y puiser une force dynamique en faisant l’inventaire des merveilles de la langue et du monde. Dans les notes préparatoires des Jardins de Morgante, on lit ceci : « L’exigence de continuité : que tout procède de ce qui précède. » Des gisements du passé jaillit l’élan vers l’avant, à sentir dans « le frémissement des alertes » sur la page blanches, les appels d’air, les ouvertures sur le large qui parlent de ciels, de vents, de houle marine. Cet écrivain, sensible au temps qui passe, l’est aussi profondément au temps qu’il fait ; son oeuvre est vibrante d’une sensualité à lire dans les bruissements, les odeurs, les saveurs du monde, dans les événements et les couleurs des saisons, qu’il nous donne à humer, respirer, écouter. Sitôt entrés dans l’univers de Jean-Paul Goux, dans le champ mystérieux et « si riche de signes » (Les Jardins de Morgante) de ses espaces clos, de ses jardins, de ses maisons, de ses constructions imaginaires, nous voici sous l’emprise de cette écriture, emportés par « la coulée continue » de cette prose aux phrases denses qui savent accueillir dans leur nasse les réminiscences, les images, les émotions venues grossir le flux en mouvement, captivés par la sonorité particulière que lui donnent les voix, voix incantatoires des narrateurs ou des personnages des romans, qui soutiennent la tension et l’élan du récit. Une prose d’une beauté impressionnante dont nous ne pouvons nous déprendre, parce qu’elle touche à des domaines familiers ou inquiétants, parce qu’elle nous immerge dans une atmosphère d’étrangeté qui rompt avec tout ce que nous avions pu lire jusque-là, parce qu’elle est toute vive des forces et des exigences amoureuses qui portent sa quête romanesque.
ACP. Dans votre dernier roman et à propos de son ami Chaunes, Wilhem le philosophe se demande : « Comment faire œuvre et vivre quand même ? comment vivre et faire œuvre quand même ? » De cette interaction de l’oeuvre et de la vie, l’une nourrissant l’autre, pouvez-vous nous parler ? Qu’est-ce qui fut déterminant pour vous lorsque vous avez commencé à écrire ? et quel regard portez-vous sur vos livres, qui en marquerait le mouvement, si l’on considère que votre huitième roman, La Maison forte, clôt une trilogie, que vos trois premiers romans formaient une sorte de triptyque (ou de grand roman de formation, comme il s’en écrivait au temps du romantisme allemand), dans leur conception, dans la façon dont l’écriture semble être en quelque sorte le sujet du roman qui se construit autour et à partir d’elle ? Quelle place faites-vous à Lamentations de Ténèbres, ou à La Jeune fille en bleu par rapport à ces deux ensembles, ou encore au travail d’ethnologue que vous avez mené dans Mémoires de l’Enclave, ces récits de la mémoire ouvrière ?
JPG. Comment peut-on écrire si l’on ne partage pas la conviction de Breton que « la littérature n’est pas faite pour agrémenter si peu que ce soit les loisirs d’autrui » ? Chacun de mes livres est une expérience en ce sens que je demande à chaque nouveau livre de fouiller à fond une « question » qui est à tel moment pour moi vitale : vitale, cela veut dire qu’elle engage ce que l’on est, ce que l’on fait de son existence, la manière par laquelle on peut lui donner un sens. Après coup, chaque livre forme ainsi une sorte de repère dans la continuité de l’existence, un jalon où sont marqués les principaux enjeux du fait de vivre, et l’on peut alors, sans doute, discerner des mouvements, organiser des ensembles.
La « question » qui m’occupait, au temps du Montreur d’ombres, autour de mes 25 ans, c’était de savoir comment survivre après l’espèce de séisme qu’avait constitué pour moi la découverte des théories modernes du « sujet »... Il y avait alors une image qui me parlait puissamment, quant à la possibilité de saisir ce que nous sommes comme sujet, c’est celle de Lichtenberg, son fameux « couteau sans lame auquel il manque le manche »... Un peu plus tard, lorsque j’ai lu Kleist, et en particulier sa bouleversante Correspondance, j’ai éprouvé pour lui un sentiment de connivence fraternelle, car le désastre qu’avait constitué pour Kleist la lecture de Kant, la découverte qu’aucune vérité absolue ne nous est accessible, c’était à mes yeux une expérience de même nature que celle de la remise en cause des conceptions humanistes du sujet à travers mes lectures des maîtres à penser de ces années-là, dans le champ des sciences humaines.
Quant aux deux livres suivants, Le Triomphe du temps et La Fable des jours, il s’agissait d’explorer ce que sont, respectivement, les mythes temporels et les mythes amoureux qui façonnent tout à la fois notre imaginaire et notre expérience du temps et de l’amour. Le roman n’a certes pas pour fonction de proposer des solutions ni de donner des leçons, et chacun de ces trois romans s’achève sur une sorte de « il faut tenter de vivre », par quoi en effet ils s’apparentent au roman de formation, mais par le fait qu’ils constituent un bilan, par le fait qu’ils débrouillent les confusions des expériences de la vie, ils apportent aussi, à leur auteur et peut-être aussi à leur lecteur, un bénéfice psychologique qui permet de continuer, de continuer d’avancer, de continuer de vivre. On ne pourrait dire que l’écriture est le sujet de ces romans qu’à la condition d’ajouter que c’est parce que la possibilité de vivre dépend de la possibilité d’écrire : on n’est pas ici dans l’espace d’une écriture qui se prendrait elle-même pour objet, dans la spécularité et l’épuisement du sujet romanesque, il s’agit de faire affleurer par l’écriture les forces qui rendent la vie possible, ces forces de vie qui s’opposent en nous aux forces de mort.
En ce sens, Lamentations des Ténèbres, comme son titre l’indique, est une plongée dans l’expérience du désespoir : expérience du vieillissement, expérience de l’échec, au niveau individuel et au niveau collectif, historique - c’est un roman écrit dans de cet âge lourdement symbolique de trente-trois ans, et dans ce moment historique particulier qu’a été l’accession de la gauche au pouvoir. Fin du temps de la jeunesse, fin du temps des idéaux révolutionnaires qui ont porté la part la plus vive de l’histoire pendant un siècle et demi : c’est à ce bilan sans espoir que ce roman est consacré, et il a fallu creuser profond, ensuite, pour inventer d’autres raisons de vivre. De ce temps de l’écriture de Lamentations, je garde le souvenir de quelque chose de terrifiant : le moment où l’on frôle la désintégration de soi-même et l’envie d’en finir. L’écriture de ce gros livre de 360 pages bien serrées qui tenaient en trente-sept feuillets manuscrits, que j’ai achevé avec le sentiment que je ne l’avais toujours pas commencé, ce moment d’écriture qui a duré près de quatre ans est resté pour moi une expérience extrême de cette tension dangereuse que peut engendrer le fait d’écrire, lorsque l’une des forces en présence menace de l’emporter, dans cette tension entre la mise au jour par l’écriture des forces de mort qui sont en nous et ce qui fonde en nous le sentiment du vivant, tension entre le travail du discontinu qui désagrège et décompose et le travail du continu où s’exerce le désir d’une forme qui rassemble et qui tienne, tension entre une descente aux enfers et une sortie au jour, entre la fouille des profondeurs et la remontée vers la lumière...
La sortie au jour, elle n’a vraiment eu lieu qu’après Lamentations, avec ces livres qui ont formé pour finir la trilogie des Champs de fouilles, en sorte que rétrospectivement j’ai l’impression d’une coupure nette dans mon travail, entre le versant qui précède et inclut Lamentations et le versant des livres qui suivent, même si je vois bien qu’une part essentielle de ce qui m’intéresse depuis lors est issu de Lamentations : l’écriture de la parole intérieure, « la sensation de la voix » , la mise en voix du récit, l’interaction des voix dans le dialogue intérieur ou dans le récit dialogué... D’ailleurs, le livre qui suit immédiatement Lamentations, ce livre qui n’est pas un roman et qui s’attache à la mémoire ouvrière du Pays de Montbéliard, les Mémoires de l’Enclave sont largement portées, autant que par l’intérêt pour la classe ouvrière au moment où tout paraît la chasser de l’histoire, par une fascination pour la voix : parmi les quelque cent cinquante « récits de vie » enregistrés au magnétophone que j’avais réalisés, ce n’était pas tant le parlé oral qui m’intéressait que l’oralité, la présence d’une voix, et je n’avais retenu que les seuls entretiens où une transcription me paraissait possible parce qu’il y avait un corps et un sujet présents dans une voix, et mon souci, dans ces transcriptions, non pas de l’oral mais de l’oralité, consistait à trouver les moyens littéraires de rendre sensible l’oralité d’une voix.
Que ce soit à travers l’expérience de l’oeuvre d’art dans Les Jardins de Morgante (comment vivre dans un jardin ? c’est-à-dire dans la fréquentation quotidienne de la beauté, par quoi elle n’est ni spectacle ni délassement mais confrontation vitale), l’expérience de la parole amoureuse, amicale ou politique dans La Commémoration (comment faire avec les pouvoirs de la parole ? s’il est vrai que « mors et vita in manu linguae », la mort et la vie sont au pouvoir de la parole, selon l’épigraphe), l’expérience de l’héritage (quelle place faire à ce qui nous revient et qu’on ne choisit pas ?) dans La Maison forte, la trilogie des Champs de fouilles explore ces questions qui ont été à tel moment pour moi vitales.
La Jeune fille en bleu n’échappe pas à ce principe même si son enjeu peut paraître plus léger : car dans la situation stéréotypée ici mise en scène, la fascination d’un homme mûr pour la beauté d’une jeune fille, c’est encore du sentiment du temps qu’il est question, non pas seulement de la nostalgie mais de ce qui peut porter en nous « les couleurs et la force du vivant ».
ACP. Vous êtes un rêveur bachelardien. L’extrême attention et l’extrême sensibilité accordées aux choses de la nature, aux saisons, aux éléments naturels, semblent vous être aussi nécessaires que la musique que l’on entend dans le chant jubilatoire de la langue et le rythme de votre écriture ; seriez-vous d’accord pour dire que vos textes sont lyriques ?
JPG. Je n’aime pas trop cette expression qui évoque, quoi qu’on fasse, une poétisation de la prose ; je dirais la même chose des métaphores musicales, qui sont bien tentantes, elles aussi, lorsqu’on cherche à caractériser une écriture commandée par le rythme, l’allant, un développement par reprises et symétries, une composition par échos et correspondances. Je préfère parler d’énergie, d’écriture du mouvement, de ce qui émeut, transporte le lecteur hors de soi, de ce qui touche au corps le lecteur et qui vient par le rythme : je préfère parler de la voix de la prose, qui est une énergie, impulsée par la syntaxe. Qu’est-ce qui est en jeu, avec cette idée d’énergie ?
Si la littérature, si le roman, le roman essentiel (celui qui ne se confond pas avec « l’art joujou » dont parlait Flaubert, « qui cherche à distraire comme les cartes ou à émouvoir comme la cour d’assises »), contribue à modeler les formes par lesquelles nous nous représentons le monde où nous sommes, je me sens de plus en plus pencher du côté de la vie, je sens qu’il est de plus en plus nécessaire de rechercher les liens qui nous unissent au monde, nous le rendent malgré tout accueillant, désirable ou admirable, plutôt que de cultiver exclusivement les motifs de litige avec lui, dans l’état d’esprit de « celui qui toujours nie »... Rechercher ces liens qui nous unissent au monde où nous sommes, ce n’est pas consentir béatement à l’état du monde tel qu’il est, étouffer la colère et la fureur où nous met le monde tel qu’il va, c’est faire sa place, qui n’est pas moins essentielle, à tout ce qui vient nourrir notre sentiment d’un accord et d’un échange avec « cette bulle enchantée » qu’évoque Julien Gracq, « cet espace au fond amical d’air et de lumière qui s’ouvre autour de l’homme et où tout de même, à travers mille maux, il vit et refleurit ».
Mais il ne s’agit pas seulement d’être en prise avec le monde des éléments naturels, avec le monde des paysages de la terre, afin d’y puiser de l’énergie. Il s’agit en effet, pour le roman, de transmettre de l’énergie dans le moment même où le monde représenté est représenté tel qu’il est, c’est-à-dire fort mal habitable, car « la littérature est bien la preuve », comme le dit Pessoa, « que la vie telle qu’elle est ne suffit pas ». Le monde que représente Le Voyage au bout de la nuit ou Histoire n’est pas un monde habitable, mais l’écriture de Céline ou de Simon dégage et transmet une énergie qui anime en nous le désir d’un monde plus habitable, où par là même les liens que nous pouvons tisser avec lui soient plus riches : l’énergie de l’écriture n’occulte pas l’horreur du monde, elle en change le sens en engendrant une beauté qui n’est pas dans le monde mais dans le roman. C’est un des rôles de la littérature d’opérer cette « transmutation intégrale du monde en splendeur » dont parlait Rilke : non pas une célébration idéalisante, édulcorante et aliénante du monde tel qu’il est, mais une transformation de la nature de ses éléments ; une telle transmutation, pour l’écrivain, c’est dans la langue qu’elle s’accomplit, par la beauté de la langue, par ces liens vivants qui définissent une forme et qui peuvent seuls générer de l’énergie. Parce qu’elle ne se soucie pas de cette transmutation par la forme, une des parts les plus visibles de la littérature actuelle ne peut que se borner à reproduire la même image du monde que celle des médias, dans une complaisance étouffante, morbide et aliénante pour la laideur ou l’ignoble.
Au fond, la littérature, celle que j’aime lire et celle que je cherche à faire, ne relève pas des « arts libéraux », c’est un art « despotique »..., un art qui soumet son lecteur à ses pouvoirs, ses pouvoirs d’enchantement ou d’envoûtement, qui ne sont ni l’agrément, ni le délassement, ni le loisir, ni la consommation, mais ce qu’on appelle le plaisir esthétique. Tout un courant de la critique universitaire, depuis la théorie de la réception jusqu’à la critique génétique, s’est cherché une légitimité professionnelle en privilégiant l’activité du lecteur, en hypertrophiant son rôle dans la production du texte, valorisant ainsi après coup certains aspects déjà périmés de l’esthétique moderne, la discontinuité et le « non finito » : mais le lecteur de roman n’est pas un lecteur professionnel, il aspire à être tout entier saisi dans le monde et le temps achevés d’une oeuvre, parce qu’il sent bien que paradoxalement c’est à ce moment-là qu’il est au coeur du temps de sa propre vie. Je suis déjà en train de vous parler du « continu » dans le roman...
ACP. Cette image est sensible dans tous vos romans, à travers des rêveries de liaison, d’épaisseur, de mouvement ; c’est elle, encore, qui fonde les réflexions poétiques et esthétiques de votre essai sur la prose romanesque...
JPG. A chacun ses images privilégiées pour se représenter cette chose qu’on cherche à atteindre en écrivant : pour moi c’est depuis longtemps l’image du « continu » (elle apparaît à la quatrième de couverture du Triomphe du temps). Le continu, dans la prose romanesque, c’est la liaison, le tressage, plus le mouvement, l’énergie, tout cet ensemble de choses qui travaille à fabriquer des liens, des liens vivants, et qui va de la syntaxe à la composition, de la transition et de l’enchaînement au réseau et à l’épaisseur, de l’allant du rythme au mouvement dynamique, de la coulée sonore à la voix.
Une part essentielle de l’esthétique moderne tient à la valorisation du fragment et du discontinu : on pourrait en trouver la raison dans une sorte de présupposé mimétique qui enjoindrait à l’art de représenter le donné, la discontinuité de nos existences, l’éclatement du sujet, le discontinu de la pensée, la fragmentation des sensations, l’expérience de la perte, du morcellement et de l’irréversibilité du temps, de l’effacement, la faillite des maîtrises, etc. Le discontinu est bien une donnée, mais la compulsion moderne au discontinu n’est plus guère aujourd’hui qu’une rhétorique académique illisible : le continu n’est donc pas une donnée mais une oeuvre, et l’invention d’une forme.
Le roman est un art du temps, il a affaire aux questions et aux angoisses de l’homme devant la temporalité, et il peut opposer à la dispersion et à la fragmentation des expériences existentielles une expérience temporelle de recomposition et de liaison où « nous jouons notre temps pour que nous en jouissions sans en mourir », selon une formule d’Imberty à propos du temps musical. Le roman qui m’intéresse comme lecteur et celui que je cherche à écrire, ce roman est une oeuvre contre le temps, il fabrique du continu contre le morcellement et la désintégration, contre l’irréversibilité du temps. Ce roman est aussi une oeuvre avec le temps, il fait fond sur le dynamisme, l’énergie du mouvement temporel, il fabrique de l’allant, il va de l’avant dans le courant de la lecture. Ce roman est encore une oeuvre dans le temps, il fabrique une expérience temporelle où la durée délinéarise le temps, il est une expérience de l’épaisseur du temps, une traversée des sédiments temporels qu’il dépose couche après couche, en sorte que c’est une des caractéristiques essentielles du roman qu’il n’y ait pas de lecture romanesque possible sans l’activité de la mémoire du lecteur.
Cette esthétique du continu dans le roman permettrait de ne pas confondre le roman avec le récit et ses mille avatars, elle permettrait aussi de penser que les exigences du romancier n’ont depuis longtemps plus rien à envier à celles du poète, qu’il serait heureux que les poètes en finissent avec leur implicite et archaïque conception hiérarchique des « genres » et cessent de s’imaginer que c’est à eux qu’est dévolue la charge de « l’essentiel » ...
ACP. Votre dernier roman est tout entier porté par les monologues intérieurs alternés de Maren et de Wilhem. En donnant sa forme au roman, ils touchent aussi à ces choses de l’esprit, « ingouvernables », selon V. Woolf, et que vous saisissez par la parole intérieure, celle qui donne la dimension des rêves, des aspirations, des regrets... cette dimension intérieure, il semble que vous l’approfondissiez de livre en livre ?
JPG. Ce serait un peu long et sans doute bien difficile pour moi d’essayer d’expliquer pourquoi et comment j’ai été conduit, de livre en livre, à explorer et finalement à élire cette forme qu’on appelle le monologue intérieur - expression qui n’est pas vraiment moins appropriée que celle de lyrisme, mais qu’elle non plus je n’aime guère pour diverses raisons : je préfère dire « parole intérieure », ou mieux encore « parole silencieuse », sur le modèle des « vies silencieuses », ainsi qu’on nomme avec bonheur dans les pays anglo-saxons ce que nous appelons si improprement des natures mortes. Je n’aime guère l’expression de monologue intérieur parce qu’elle renvoie trop fortement à des usages littéraires multipliés au cours du siècle, où prévalaient tantôt la maladresse (c’est évident chez Dujardin, mais même chez Virginia Woolf on rencontre de ces passages où l’activité perceptive est verbalisée à la manière de l’activité de la pensée), tantôt l’illisibilité entraînée par la disparition de tout contexte de référence (et la réussite du monologue de Molly Bloom tient en particulier au fait que c’est tout le roman qui le précède qui lui sert de contexte référentiel), tantôt des présupposés psychologiques ou esthétiques mimétiques qui faisaient accueillir le tout-venant de la pensée. Et puis, l’idée de « monologue » est à l’opposé de ce qui m’intéresse puisque justement je cherche à rendre sensible le fait que la parole intérieure est rarement tout à fait solitaire : elle est le plus souvent tissée de la parole d’autrui, elle se développe dans la reprise et l’assimilation constantes de la parole d’autrui, et de la parole qu’on a ou qu’on aurait pu, qu’on va ou qu’on pourrait adresser à autrui, si bien qu’elle est plutôt une polyphonie.
Ce qui m’intéresse, c’est de représenter l’activité intérieure qui s’accomplit dans ce mélange complexe et hétérogène où se retrouvent des éléments verbalisés ou non : sensations évoquées, images mentales, souvenirs et anticipations, scénarios, bribes de paroles prononcées ou entendues, et bribes de paroles jamais prononcées mais que nous prononcerions si nous avions à parler - tout ce qui fait la « vie intérieure », tout ce qui nous relie à la trame du monde et nous y insère, et qui n’est en réalité qu’un magma incohérent. Une forme littéraire peut tenter non pas de mimer ce magma de l’activité intérieure, non pas de le montrer mais de le représenter, d’en donner un équivalent qui ne soit ni un décalque ni une reproduction : la parole silencieuse n’est pas l’activité mentale réelle que je viens d’évoquer, c’est la forme littéraire que peut prendre sa représentation.
Au fond, il n’y a guère que deux circonstances où nous verbalisions la vie intérieure : lorsqu’on écrit et lorsqu’on s’adresse à autrui. Mes premiers livres mettaient en scène un narrateur-écrivain afin de fixer un cadre vraisemblable à l’activité de verbalisation de la parole silencieuse. Je cherche maintenant à mettre en scène des situations de parole, de parole tenue ou de parole à tenir, qui fixent ce cadre vraisemblable, justifient que soient verbalisés ces souvenirs, sensations, perceptions ou images mentales. La parole silencieuse est ainsi devenue pour moi une forme désirable, de celles qui président à l’entrée dans un livre. Elle est une réponse à la question du « qu’est-ce qui fait raconter ? », en mettant en scène des situations où s’exerce le désir de raconter à autrui. Elle a beaucoup à voir avec le mouvement de la rêverie, sa souplesse, son allant, cette énergie qui la porte en avant, et sans qu’elle ait besoin d’être conclue par une solution, en quoi elle est aussi une quête. Elle tient enfin de la voix, de la sensation de présence de celui qui parle, de cette tension qui porte la voix.