Gioconda, une initiation amoureuse à Thessalonique
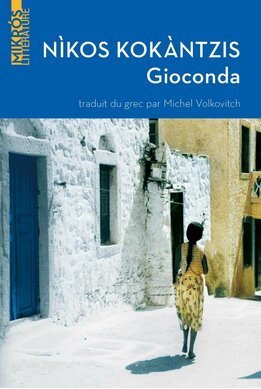
Lorsque je pars en voyage dans un pays étranger, j’aime bien emporter avec moi quelques ouvrages d’auteurs de ce pays. Comme si j’avais envie de donner une sorte de couleur locale à ma lecture, le temps d’un séjour plus ou moins long. Un été, je suis partie en Céphalonie. Cette île de la mer ionienne n’est pas tant sur les circuits touristiques, et pour ce premier séjour en Grèce, je trouvai à Lixoúri, à l’extrémité de l’île, une Grèce telle que j’avais pu me la représenter à travers quelques-unes de mes lectures, d’Homère à Kazantzakis, en passant par Séféris, Ritsos et quelques autres. Cette île ionienne, avec au nord Corfou, au sud Zante et à sa droite, comme accolée à elle, Ithaque, est la patrie de Níkos Kavvadías, l’auteur du Quart, odyssée noire qui peut faire penser à Conrad aussi bien qu’à Melville ou London. C’est aussi la patrie des Valeureux d’Albert Cohen, même si l’on dit que l’auteur de Belle du Seigneur a calqué sur la Céphalonie les traits de son Corfou natal, par nécessité romanesque, car les Céphaloniotes ont la réputation d’être plus « fous » que les Corfiotes. C’est également le cadre du roman de Louis de Bernières, La Mandoline du capitaine Corelli, racontant les amours d’un capitaine italien pour la belle Pelagia, pendant la Seconde guerre mondiale, ce livre fut adapté au cinéma en 2001 par John Madden, à qui l’on doit Shakespeare in Love et Indian Palace, avec Nicolas Cage et Penélope Cruz dans les rôles principaux…
J’avais ces livres avec moi, à Lixoúri, mais c’est un autre que j’ai lu, déniché juste avant mon départ, Gioconda de Níkos Kokántzis, aux éditions de L’Aube, dans une traduction de Michel Volkovitch. La seule « couleur locale » de ce livre était d’être grec, car son action se situe loin de la Céphalonie, à Salonique, l’actuelle Thessalonique. Ce court récit d’une centaine de pages m’a fait prendre conscience de deux choses. Comme souvent, si l’on ne prend pas la peine d’y réfléchir en amont, tout pays étranger nous apparaît tel un bloc monolithique dans son identité, avec d’infimes variations locales. Mais en l’occurrence, je sentais bien, par exemple, que l’histoire d’amour entre le capitaine Corelli et Pelagia, dans le roman de Louis de Bernières, et celle entre le narrateur et sa voisine Gioconda, dans le récit de Kokántzis, ne s’inscrivaient pas exactement dans le même terreau historique et géographique. La Céphalonie n’est pas Salonique, et leurs habitants respectifs sont fortement imprégnés de ces différences locales. Et puis je me suis aperçue que je connaissais mal, et même très mal, l’histoire contemporaine de la Grèce, depuis son indépendance il y a bientôt deux cents ans, en 1830. Ainsi, j’avais atterri à l’aéroport international d’Athènes, qui porte le nom d’Elefthérios Venizélos. J’ignorais qui était cet homme, cet ancien premier ministre considéré comme le « fondateur de la Grèce moderne », pays à l’histoire contemporaine mouvementée.
Salonique ou Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, abrite une importante communauté juive depuis l’Antiquité. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter à la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, écrite vers l’an 50 de notre ère, et adressée à l’Église de Thessalonique, contenant ce passage qui a nourri l’antijudaïsme chrétien et un certain antisémitisme : « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes. » La communauté juive salonicienne s’est surtout développée après le décret de l’Alhambra, en 1492, par lesquels Isabelle de Castille et Ferdinand II d’Aragon, poussés par le sinistre Torquemada, promulguent l’expulsion des Juifs d’Espagne. C’est ainsi qu’une importante communauté séfarade vient s’établir à Salonique, formée de « repentants », des Juifs maranes qui s’étaient convertis pour échapper aux persécutions, en Espagne, et ont renoué avec leur foi à laquelle ils avaient été contraints de renoncer. En deux siècles, les Juifs représentaient plus des deux tiers de la population de Salonique, que l’on surnommait alors la « Jérusalem des Balkans ». Pendant plus de quatre cents, la diaspora juive représenta la majorité de la population salonicienne, ce qui ne manqua pas de causer certaines tensions avec le reste des Saloniciens.
Par ailleurs, les grands empires (la Grèce était alors sous le joug ottoman) s’accommodaient beaucoup plus facilement des minorités ethniques ou religieuses autonomes que les États-Nations, de taille plus réduite, qui y voyaient là une menace à leur volonté d’homogénéisation nationaliste. Le grand incendie de 1917 qui détruit une partie de la ville et, en particulier, de nombreux quartiers juifs, est le prétexte idéal pour la municipalité d’effacer tout se passé non-grec. L’arrivée des Grec (autrement dit de chrétiens orthodoxes) de Turquie, après la signature d’un traité entre les deux pays qui a conclu à un échange de populations, va exacerber les tensions jusqu’au pogrom de 1931. Beaucoup de Juifs saloniciens vont migrer en Europe de l’Est, en Amérique du Nord ou en Palestine.
Paradoxalement, le régime autoritaire du premier ministre d’extrême droite Ioánnis Metaxás, dans la période de dictature qu’on appelle régime du 4-Août, va permettre de tempérer un temps ces violences antisémitiques. En fait, celles-ci ne reprennent véritablement qu’après la défaite de la Grèce, au printemps 1941, qui fait partie du camp allié. La Grèce du Nord, et donc Salonique, tombe sous le joug allemand. Le commandant allemand local, Max Merten, qui ne fut guère inquiété après la fin de la guerre, bien qu’il soit responsable de la déportation de 50 000 Juifs saloniciens, assurait la population locale que les lois de Nuremberg ne seraient pas appliquées à Salonique. Mais la presse juive fut interdite, puis ce sont tous les hommes juifs de 18 à 45 ans, qui sont rassemblés le jour du shabbat sur la place principale de la ville, la place Eleftherías, autrement dit la place de la Liberté. Les Allemands les contraignent à effectuer des exercices physiques humiliants sous un soleil de plomb avant de les envoyer réparer des routes dans des zones dévastées par le paludisme.
Tel est le cadre dans lequel se situe l’histoire racontée par Níkos Kokántzis. On ne sait presque rien de cet auteur, dont c’est le seul et unique livre, sinon qu’il est né en 1930 à Thessalonique, qu’il a étudié la médecine puis exercé la psychiatrie à Londres, où il a vécu longtemps. Ce n’est qu’en 1975 qu’il se décide à écrire Gioconda, pour que celle qui fut le grand amour de sa vie ne disparaisse pas une seconde fois et complètement, comme il l’écrit :
Je crains parfois qu’arrive un jour où je commencerai d’oublier les détails. Cette idée me terrifie. Je veux garder en mémoire à jamais tout ce qui s’est passé entre nous, l’instant le plus infime – toutes les fois où elle m’a dit “je t’aime”, toutes les fois où elle m’a touché de cette façon qu’elle seule, d’instinct, connaissait. Me souvenir à jamais de sa voix quand elle chuchotait, le contact de ses lèvres, l’odeur de son corps. Me souvenir non seulement de ce qui fut dit, mais de tous nos silences. Les gens meurent seulement quand nous les oublions. Gioconda doit rester vivante aussi longtemps que je vivrai – et plus longtemps que moi. Vivante ainsi que je l’ai connue, s’épanouissant sous mes regards, mes caresses, mes baisers.
Gioconda est un tombeau, en tant que genre littéraire. On peut écrire sa propre Recherche du temps perdu en cent pages. Níkos Kokántzis est mort en 2009.
Dès la première phrase, il nous dit que c’est une histoire vraie, dont on se doute qu’elle est la sienne. Revenu en rêve dans le quartier de son enfance pauvre, à Thessalonique, il revoit la maison de sa famille et celle de ses voisins, des Juifs pauvres comme eux mais possédant un piano, que séparait un terrain de vague. C’est là que se réunissait la « bande » à laquelle il appartenait, composée du narrateur, de deux des cousins, des quatre filles et des deux garçons de la famille voisine, auxquels venait parfois s’ajouter un gamin de passage. Ils se connaissent tous depuis leur plus tendre enfance, mais le narrateur est secrètement amoureux de la belle Gioconda, la cadette des quatre filles, d’un an moins âgée que lui, mais plus mûre et déjà jeune femme alors que lui peine à sortir de l’enfance. Voici comment il la décrit dans les premières pages du récit :
Gioconda […] avait des yeux gris-bleu qui louchaient un peu. Elle était belle. Grande, bien faite, avec une nonchalance dans les gestes et un sourire qui éclairait et réchauffait tout autour d’elle. C’était ma compagne de jeux préférée […]. Elle fut mon amie la plus proche depuis que nous sûmes parler jusqu’au jour où elle partit, à quinze ans, avec toute sa famille, emmenée par les Allemands. Deux ans avant cette séparation, elle fut la première femme qui me lança un sourire, de façon soudaine, imprévue, un sourire différent de tous ceux que j’avais connus jusqu’alors, et dont elle-même devait ignorer le sens, levant les yeux jusqu’aux miens quelques instants, dans la pénombre d’une soirée de printemps, tandis que nous étions debout, vaguement mal à l’aise, sous l’abricotier de son jardin – un sourire timide, fugitif qui m’emplit d’un trouble, d’un vertige inconnu.
C’est ce « vertige inconnu » que va s’employer à décrire le narrateur, celui de la découverte d’un amour fou, passionné, entre deux adolescents, dans l’affolement des sens et des sentiments. Comme l’écrit Michel Volkovitch dans sa postface :
Níkos et Gioconda se retrouvent au cœur de la guerre comme deux petits Poucets la nuit dans une forêt pleine d’ogres, avec l’amour pour cabane-refuge. Aucune bonne fée n’interviendra au dénouement ; mais les deux jeunes amants auront tout de même obtenu du sort une espèce de miracle : vivre en quelques semaines d’amour fou l’équivalent de toute une vie.
Cette histoire d’amour est sans doute parmi les plus belles de la littérature, en raison d’une forme « de naturel, d’innocence, de ferveur » jusque dans l’érotisme saisissant de leurs ébats amoureux, avec toute la maladresse de deux adolescents qui s’initient ensemble et mutuellement à la découverte des corps, commence pourtant mal.
Le narrateur, persuadé que Gioconda, dont il est secrètement amoureux, lui préfère Rudi, le cousin de celle-ci, plus âgé que lui, par jalousie et dépit, tel Othello, le traite un jour de « sale Juif », avant de s’enfuir de honte et de rage. Il n’ose plus se montrer, se réfugie sur un muret surplombant la mer. Agacé, il entend bientôt des bruits et quand il se retourne, il voit venir à lui Gioconda. Mais contrairement à ce qu’il redoutait, elle n’est pas en colère. Au contraire, elle lui dit qu’elle a ainsi compris qu’il l’aimait autant qu’elle l’aimait lui. S’ensuit un premier baiser aussi fougueux que maladroit, où leurs dents s’entrechoquent et où la lèvre supérieure de Gioconda se met à saigner…
Je ne savais pas embrasser […]. Mais ce baiser naïf était plus fort que du vin et nous donnait le vertige. Elle était à moi, j’étais son amant, nous étions mariés, nous n’étions pas mariés, nous avions des enfants, nous n’étions rien que nous deux, les Allemands étaient partis, la guerre était finie, nous étions aux Indes, en Afrique, en Espagne, au Tibet, nous avions une jolie petite maison, nous étions vieux et avions des petits-enfants, nous voguions dans des yachts blancs, nous volions au ras des flots dans notre avion, j’étais à la guerre, on m’avait décoré, j’étais revenu en permission et elle m’attendait, […] il n’y avait pas de guerre, nous traversions le désert à dos de chameau sous un soleil insoutenable, nous descendions le Nil blanc parmi les odeurs du soir, nous découvrions Samarkand, Kaboul, Bénarès…
La guerre est pourtant là, et les Allemands resserrent leur étau. Le narrateur a quinze ans. Il entre dans la Résistance. Sa « petite participation à quelque chose d’énorme, d’affreux, de grandiose, de sacré, d’unique », comme il l’écrit, consiste à jeter des tracts dans des cours, participer à des réunions secrètes, écrire des slogans sur des murs. Mais les risques encourus sont énormes, et l’âge ne compte pas si l’on se fait prendre. Il suffit de se rappeler que Sophie Scholl, à la tête du réseau de la « Rose blanche », a été guillotinée par les Nazis à 22 ans pour avoir imprimé et distribué clandestinement des tracts. Des personnes sont exécutées. On entend des tirs dans la nuit. Les restrictions augmentent en même temps que la menace pour la population juive. « Entre la mort et la peur, nous avions la joie, l’espoir et le rêve, écrit le narrateur. Nos cœurs étaient ouverts au chagrin, à la misère, au cauchemar qui nous entouraient, mais nous gardions tout au fond de nous-mêmes, un noyau irréductible de sérénité et de joie. »
Quand la nouvelle se confirme de l’arrestation et de la déportation des Juifs, le père du narrateur propose de cacher Gioconda chez eux, mais ses parents refusent. Quand le camion militaire vient les chercher « par une chaude fin d’après-midi », malgré les supplications du narrateur, Gioconda refuse de se séparer des siens. Elle lui offre un grand cahier qui lui servait d’herbier quand elle était écolière, en lui demandant de le garder jusqu’à son retour, puis « elle me demanda pardon pour le mal qu’elle faisait en partant, en n’ayant pas le courage de rester sans sa famille, pour le chagrin qu’elle me causait. » La scène des adieux est poignante, dans la brutalité de son irruption après leurs nombreuses étreintes dans la chambre du narrateur, quand la maison est vide, ou bien dans une cabane où ils se retrouvent.
Dix-huit trains transportant des Juifs de Thessalonique ont été envoyés à Auschwitz. Près de 50 000 y sont morts, et au total, c’est 98% de la population juive salonicienne qui a disparu pendant la guerre. Dont Gioconda et sa famille. Comme l’écrit Níkos le narrateur : « En s’efforçant de croire qu’il était humainement impossible d’aller plus loin, on oubliait, tout simplement, que c’était inhumainement possible. »
Gioconda de Níkos Kokántzis, traduit par Michel Volkovitch, aux éditions de l’Aube en 2002, nouvelle édition en 2022.