François Bizet | Dans le Mirador
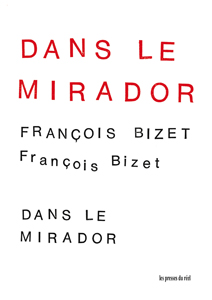
Présentation (Les presses du Réel) :
" Qu’est-ce que ce Mirador ? Conçu, et construit, dans un très lointain passé, on ne sait quand ni par qui, sur une terre et dans un paysage dévastés. Telle est bien la question, car s’il s’agit d’un monument d’architecture en perpétuelle expansion, il s’agit également d’un espace, avec lequel il tend à se confondre. Un espace paradoxal, sans dehors, où les dehors sont dedans. Sans doute comme celui du texte que le lecteur s’apprête à parcourir, sans y être jamais entré parce qu’il s’aperçoit peu à peu, comme les visiteurs du Mirador, ou ses multiples agents, qu’il l’a toujours habité. Le lecteur est alors pris au piège d’un labyrinthe, d’un « système », agencé de telle manière qu’il ne sait plus bientôt s’il s’agit de la description d’un « mirage », du récit d’une « chimère », ou d’une fiction très minutieusement réaliste qui ne fait que restituer les traits les plus cruels du temps qu’il est en train de vivre ou d’une société qui « ne cesse de s’enlever sur fond de nuit, et de s’y abîmer ». Le Mirador nous conduit « vers ce point zéro que nous savons être à la fois notre vérité et l’instant t de notre pulvérisation »


Un extrait

 Les surfaces furent lissées, cirées, repolies de telle sorte que disparut toute notion de suture. On rechercha les vernis les plus immatériels. Les baies des nacelles porteuses furent élargies à des dimensions exorbitantes, puis le verre finit par se substituer aux matériaux originels des planchers et des plafonds. Quant aux entrelacs de la voûte, si impeccablement agencés qu’ils eussent paru d’abord, on les vit prendre à la longue l’aspect d’un organisme variable, éponge ou hyménoptère, puis d’un détail de cet organisme dont les tissus, comme grossis par la lentille d’un microscope géant, et enduits désormais d’une patine naturelle, semblaient évoluer de façon autonome au gré des éclaircies.
Les surfaces furent lissées, cirées, repolies de telle sorte que disparut toute notion de suture. On rechercha les vernis les plus immatériels. Les baies des nacelles porteuses furent élargies à des dimensions exorbitantes, puis le verre finit par se substituer aux matériaux originels des planchers et des plafonds. Quant aux entrelacs de la voûte, si impeccablement agencés qu’ils eussent paru d’abord, on les vit prendre à la longue l’aspect d’un organisme variable, éponge ou hyménoptère, puis d’un détail de cet organisme dont les tissus, comme grossis par la lentille d’un microscope géant, et enduits désormais d’une patine naturelle, semblaient évoluer de façon autonome au gré des éclaircies.  Il n’y a rien ici (qui ne le comprendrait, ou se refuserait à le comprendre ?), il n’y a personne que sa présence dans le Mirador ne voue définitivement à la transparence et à la circulation. Où que l’on porte le regard, on croise nécessairement, sans jamais qu’un obstacle ne vienne empêcher cette sympathie gravitationnelle, les regards plus ou moins extasiés d’un groupe en partance pour les étages supérieurs, ou au repos dans les alcôves, ou en transit entre deux esplanades, soit qu’on est soi-même entraîné par la vitesse régulière d’un trottoir roulant, ou par l’accélération d’une cabine d’ascenseur aussi rutilante que silencieuse, soit tout bonnement qu’on déambule, en file, à l’oblique sur l’une de ces rampes qui longent les deux baies de l’immense hall aménagé après coup, par pure horreur d’une possible non-occupation des sols, sur ce qui subsistait depuis la mystérieuse chute des Murs d’une sorte de douve en vague forme d’amande. Ce sont ces mêmes coursives qui, reliées aujourd’hui par un va-et-vient de passerelles, constituent un des cœurs du système – la totalité des centres vitaux de notre complexe se trouvant en tout point, comme il se doit, en interconnexion. Ainsi, et la langue a raison lorsqu’elle dit aussi que l’œil porte, il est loisible à n’importe qui, de n’importe lequel de ces centres, de jouir non seulement des attractions qui ont lieu dans les périphéries les plus proches (et ce faisant de comprendre qu’il est lui-même l’objet d’une curiosité assidue de la part des provinces d’en face, elles aussi vissées à leurs télescopes), mais encore de tous les faits lointains, dont les nombreuses annexes, dépendances et autres bâtiments satellites sont le théâtre.
Il n’y a rien ici (qui ne le comprendrait, ou se refuserait à le comprendre ?), il n’y a personne que sa présence dans le Mirador ne voue définitivement à la transparence et à la circulation. Où que l’on porte le regard, on croise nécessairement, sans jamais qu’un obstacle ne vienne empêcher cette sympathie gravitationnelle, les regards plus ou moins extasiés d’un groupe en partance pour les étages supérieurs, ou au repos dans les alcôves, ou en transit entre deux esplanades, soit qu’on est soi-même entraîné par la vitesse régulière d’un trottoir roulant, ou par l’accélération d’une cabine d’ascenseur aussi rutilante que silencieuse, soit tout bonnement qu’on déambule, en file, à l’oblique sur l’une de ces rampes qui longent les deux baies de l’immense hall aménagé après coup, par pure horreur d’une possible non-occupation des sols, sur ce qui subsistait depuis la mystérieuse chute des Murs d’une sorte de douve en vague forme d’amande. Ce sont ces mêmes coursives qui, reliées aujourd’hui par un va-et-vient de passerelles, constituent un des cœurs du système – la totalité des centres vitaux de notre complexe se trouvant en tout point, comme il se doit, en interconnexion. Ainsi, et la langue a raison lorsqu’elle dit aussi que l’œil porte, il est loisible à n’importe qui, de n’importe lequel de ces centres, de jouir non seulement des attractions qui ont lieu dans les périphéries les plus proches (et ce faisant de comprendre qu’il est lui-même l’objet d’une curiosité assidue de la part des provinces d’en face, elles aussi vissées à leurs télescopes), mais encore de tous les faits lointains, dont les nombreuses annexes, dépendances et autres bâtiments satellites sont le théâtre.  Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, on ne trouvait ici absolument rien. Pas une larve de mouche. Pas une racine. Le taux de fertilité était nul. Impossible, dans cet air empuanti de gaz, de bêcher le sol sans risquer de heurter d’anciennes mines ou d’exhumer les ossements stratifiés par les campagnes successives. Les descendants des rescapés fuyaient devant les précipitations par crainte de nouvelles catastrophes, glissements de terrain ou intoxications.
Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, on ne trouvait ici absolument rien. Pas une larve de mouche. Pas une racine. Le taux de fertilité était nul. Impossible, dans cet air empuanti de gaz, de bêcher le sol sans risquer de heurter d’anciennes mines ou d’exhumer les ossements stratifiés par les campagnes successives. Les descendants des rescapés fuyaient devant les précipitations par crainte de nouvelles catastrophes, glissements de terrain ou intoxications.  Aujourd’hui c’est un ruissellement ininterrompu d’amateurs et d’oisifs, de badauds, de flâneurs ébahis par la nouvelle amplitude de leur champ visuel. On se presse sur des terrasses sans mesure, circulaires comme l’horizon. Des files s’allongent aux heures pleines dans les salles d’attente qui se multiplient jusqu’à quinze mètres sous la surface des lagons alentour. On y patiente sous de hautes cloches vitrées pour la visite des pépinières, et plus loin des orangeries et des canopées. Une statuaire monumentale aspire les pèlerins vers des nids d’aigles où des tables d’orientation gravées à même la roche indiquent les prochaines étapes du circuit. Ici, une extension récente du combinat permet d’embrasser, du haut d’un pont flexible suspendu à une poignée de câbles, un détroit où s’affrontent à heures fixes, sans jamais se mêler les eaux de l’océan et de la mer intérieure. Et vers le sud, des kilomètres carrés de zone paludéenne sont maintenant parcourus d’un réseau de chemins à fleur d’eau menuisés dans les bois odorants des réserves continentales, qui fournissent aussi ces observatoires, là, camouflés dans la flore tentaculaire, grouillante d’une faune amphibie. De partout il ne suffit plus que de se pencher. Le spectacle infiniment renouvelable d’une métamorphose d’insecte ; l’explosion d’une étoile ; la lente dérive des icebergs ; la fission d’un noyau atomique ; la naissance tourbillonnaire d’organes primitifs ; un raid aérien chirurgical ; l’expansion du vide entre les galaxies ; la cristallogenèse ; l’isolement d’un virus ; la dissipation d’un cyclone : il n’est pas un objet au cœur duquel le Mirador ne vous ravisse, à l’œil duquel il ne vous expose.
Aujourd’hui c’est un ruissellement ininterrompu d’amateurs et d’oisifs, de badauds, de flâneurs ébahis par la nouvelle amplitude de leur champ visuel. On se presse sur des terrasses sans mesure, circulaires comme l’horizon. Des files s’allongent aux heures pleines dans les salles d’attente qui se multiplient jusqu’à quinze mètres sous la surface des lagons alentour. On y patiente sous de hautes cloches vitrées pour la visite des pépinières, et plus loin des orangeries et des canopées. Une statuaire monumentale aspire les pèlerins vers des nids d’aigles où des tables d’orientation gravées à même la roche indiquent les prochaines étapes du circuit. Ici, une extension récente du combinat permet d’embrasser, du haut d’un pont flexible suspendu à une poignée de câbles, un détroit où s’affrontent à heures fixes, sans jamais se mêler les eaux de l’océan et de la mer intérieure. Et vers le sud, des kilomètres carrés de zone paludéenne sont maintenant parcourus d’un réseau de chemins à fleur d’eau menuisés dans les bois odorants des réserves continentales, qui fournissent aussi ces observatoires, là, camouflés dans la flore tentaculaire, grouillante d’une faune amphibie. De partout il ne suffit plus que de se pencher. Le spectacle infiniment renouvelable d’une métamorphose d’insecte ; l’explosion d’une étoile ; la lente dérive des icebergs ; la fission d’un noyau atomique ; la naissance tourbillonnaire d’organes primitifs ; un raid aérien chirurgical ; l’expansion du vide entre les galaxies ; la cristallogenèse ; l’isolement d’un virus ; la dissipation d’un cyclone : il n’est pas un objet au cœur duquel le Mirador ne vous ravisse, à l’œil duquel il ne vous expose.

Editions Les presses du Réel
collection PLI
dirigée par Justin Delareux & Jean-Marie Gleize
paru en octobre 2018
96 pages
ISBN : 978-2-37896-033-9
http://www.lespressesdureel.com
7 novembre 2018