Je crois la voir (la femme malade)
Les longues soirées d’hiver, en ces jours de froid sibérien, sont propices à la lecture, et c’est avec une certaine gourmandise que j’ai lu un petit ouvrage d’Arlette Farge intitulé : Un ruban et des larmes, Un procès en adultère au XVIIIe siècle (Ed. des Busclats, 2011).
Arlette Farge est femme, chercheuse au CNRS, et sociologue de la condition féminine. Dans ce petit livre délicieux, elle raconte en détail le procès en adultère d’Anne-Sophie Bourgeot, poursuivie en 1778 par son mari pour s’être enfuie rejoindre un, ou plutôt deux amants, les sieurs Desbois, confiseur, et Le Dreux, plumassier. Elle-même est l’épouse du ferblantier Réné-Jean Branchu : on est dans le milieu des petits artisans du XVIIIe siècle, qui intéresse la sociologue.
Les archives de ce procès ont été conservées, elles sont truffées de pièces croustillantes, révélatrices des mœurs, de la sociologie et de la condition des femmes à cette époque. Anne-Sophie Bourgeot, qui risque, si elle est condamnée, de passer de longues années en prison ou, au mieux, au couvent, est accusée de commerces licencieux scrupuleusement rapportés par 17 témoins à charge, et par son mari, qui la décrit comme entièrement « livrée à sa passion ». Les pièces sont nombreuses qui dénoncent une libertine pratiquant sans vergogne une sexualité débridée sous le nez des domestiques. On la vit « prendre dans sa main le membre viril qu’elle baisa plusieurs fois et mit dans sa bouche » […] « jouir deux fois tout debout avec un ami nommé Dix » à qui, épuisée, elle aurait demandé « de la laisser car elle n’en pouvait plus ». Le Dreux, lui, aurait « porté l’indécence jusqu’à lever ses jupons, la jeter sur le lit puis lui donner des claques sur le derrière » ; toutes descriptions dignes d’un mauvais porno.
On sent une sorte de sympathie, voire même de solidarité féminine de la part d’Arlette Farge, pour cette femme prisonnière de son temps et de sa condition, mais libérée avant l’heure, fière maîtresse de son corps, dans un univers d’hommes qui s’apprêtent à lui faire payer sa liberté en l’envoyant au couvent, ou, pire, en prison. En attendant son procès, elle croupit au Grand Châtelet, où l’on s’inquiète pour sa santé : elle s’étiole et dépérit.
Cependant, Anne-Sophie Bourgeot conteste avec énergie ce qui lui est reproché, elle « dit que tout cela est un tissu d’horreurs imaginé pour la perdre… ». Et peu à peu, Arlette Farge découvre dans les archives du procès, sagement endormies depuis presque deux cent cinquante ans, la vérité : M. Branchu était un homme violent, qui avait abusé sa femme au moment de leur mariage, en faisant état d’une rente de 300 livres qu’il n’avait pas. Il était essentiellement intéressé par sa dot de 10000 écus, bien réelle.
Après la découverte du mensonge, leurs rapports s’étaient dégradés, et Branchu avait arrangé avec l’aide du commissaire de quartier Dupuy un dossier bidon, fabriqué de toutes pièces, afin que sa femme soit envoyée au couvent. Il faut lire ce petit livre pour savourer le dénouement, le retournement de tous les témoins, l’enquête sur le véreux Dupuy qui avait touché 25 Louis d’or pour sa forfaiture, et l’honneur rendu à Anne-Sophie Bourgeot par le « hors lieu » prononcé le 28 juillet 1779.
Comme beaucoup de chercheurs, j’aime les archives. Mais si Arlette Farge s’intéresse à la condition féminine au travers des procès en adultère, je dépouille plutôt les Mémoires de l’Académie Royale des Sciences.
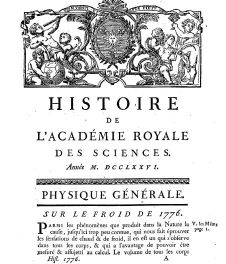
En l’année 1779, date du procès d’Anne-Sophie Bourgeot, Morand remet à l’académie un rapport d’ « Arithmétique politique » sur la population française, entre autres rapport sur la finesse de la laine ou l’étranglement des intestins.
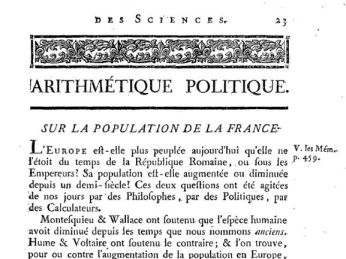
Car en effet, on se demande encore si elle tend à augmenter ou diminuer : « L’Europe est-elle plus peuplée aujourd’hui qu’elle ne l’était du temps de la République romaine, sa population est-elle augmentée ou diminuée depuis un demi-siècle … Montesquieu et Wallace ont soutenu que l’espèce humaine avait diminué depuis les temps que nous nommons anciens, Hume et Voltaire ont soutenu le contraire… ».
Le rapport de Morand est d’une lecture fascinante puisqu’on y lit entre autres : « La population a augmenté … mais comment ce résultat peut-il s’accorder avec les progrès du luxe, la corruption des mœurs dans la capitale, l’augmentation de la misère dans les provinces ? …. On ne peut nier que l’agriculture n’ait fait des progrès, les prairies artificielles se sont multipliées, la culture des pommes de terre s’est répandue de nos jours dans plusieurs provinces, ainsi le raisonnement est ici d’accord avec l’observation, & l’on voit que la population s’est accrue & qu’elle a dû s’accroître. D’ailleurs la classe du peuple qui vit de son travail a plus d’aisance ; il suffit pour s’en assurer d’observer l’augmentation de la consommation de viande dans les bourgs et les villages, de comparer les logemens des habitans des campagnes, leurs habillemens, avec ce qu’ils étaient il y a un demi-siècle ; on peut observer que le commerce et l’industrie ont fait de grands progrès, qu’ils jouissent en général d’une plus grande liberté ; que les lois fiscales sont exécutées avec moins de rigueur, quoique les revenus du fisc soient augmentés. Tous ces changements n’auroient pu se faire si la misère n’étoit pas diminuée. »
Ainsi en 1779, les taxes diminuent mais les revenus de l’impôt augmentent, dans une atmosphère de régime carné et de mœurs relâchées : Anne-Sophie est certes innocente des turpitudes dont on l’accuse, mais enfin, les faux témoignages avaient été produits pour être crus, c’est donc qu’ils étaient plausibles. Je ne suis pas certain qu’aujourd’hui, parmi mes amies ou relations, je puisse trouver quelqu’une qui ait suffisamment de domestiques et suffisamment peu de pudeur pour pratiquer des fellations publiques dont ils pourraient rendre compte ; c’est dire si l’évolution des mœurs en 250 ans a été incrémentale sinon élastique.
Un autre fait concomitant de l’affaire Branchu contre Bourgeot pourrait nous intéresser : en 1776 et 1777, quand commencent les troubles dans le couple Branchu, il a fait très froid dans Paris, un froid extraordinaire, et si mordant qu’il fera l’objet de comptes rendus dans les mémoires de l’Académie des Sciences, par l’académicien Messier (celui des étoiles).
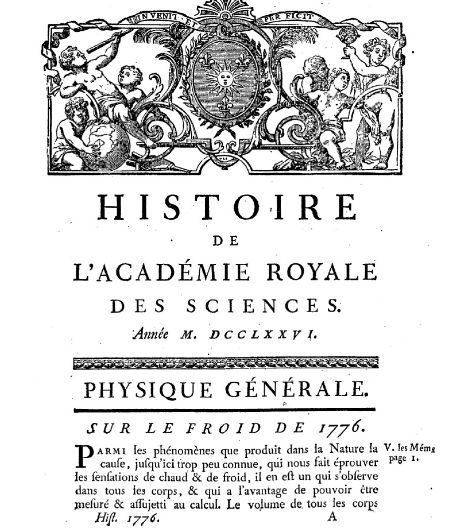
Messier va mettre en pratique la récente invention du thermomètre pour évaluer le froid réel qu’il fait à Paris, notamment en prenant des températures précises sous abri. Il enverra des « commissaires » de l’Académie prendre des mesures dans plusieurs endroits de Paris alors sous la neige.
« M. Messier a suivi avec la plus grande exactitude le froid de 1776 ; huit thermomètres ; deux de mercure & six d’esprit de vin lui ont servi à connaître les différences locales du froid dans les lieux fermés ou en plein air, dans les différentes expositions… Le plus grand froid donné par un thermomètre de mercure exposé en plein air & au nord est arrivé le 29 janvier »
Dans son rapport Messier donne avec la plus grande précision la méthode de mesure, et le nombre de degrés comptés entre la glace fondante et l’eau bouillante (85).
Comme expliqué dans ce mémoire :
« ces considérations ont déterminé M. Messier à publier les Observations dans le plus grand détail afin que les physiciens qui voudroient dans la fuite comparer un grand froid à celui de 1776 euffent tous les moyens poffibles de faire cette comparaifon. Les travaux fur les Sciences ne font affranchis des détails que lorfqu’elles font dans l’enfance ou qu’elles approchent de la perfection ».
C…˜est ainsi que je peux vous annoncer qu’il faisait -19,11 degrés le 29 janvier 1776 à Paris, Boulevard de l’Observatoire. Pour ceux qui connaissent, c’est dans le 5e arrondissement, limite 14e. Ainsi Messier n’aura pas travaillé en vain, nous sommes là pour hériter de ses travaux et lui rendre hommage. D’ailleurs ce mémoire fait preuve d’un optimisme visionnaire puisqu’il prédit :
« la perfection que les inftrumens météorologiques ont acquise dans ce derniers temps & la multiplication du nombre des observateurs nous font efpérer que bientôt la Phyfique va être augmentée d’une nouvelle Science » (la météo NdA)
Mais, me direz-vous, quid de la température ressentie, dont on nous rebat les oreilles ?
Qui peut croire que ce concept apparu récemment dans les bulletins météolor… métérolo…météolorologiques est déjà présent dans les mémoires de l’Académie des Sciences, dès 1710, dans un mémoire intitulé « De l’effet du vent à l’égard du thermomètre ».

« Si l’on souffle contre ma main avec un soufflet, je sens du froid, quoique l’air poussé contre ma main ne soit pas plus froid que celui dont elle était environnée auparavant : mais c’est qu’elle était enveloppée auffi bien que le refte de mon Corps, d’une Atmosphère chaude formée par la tranfpiration, le fouffle l’en dépoüille & fait que l’air extérieur plus froid que cette atmosphère s’applique immédiatement sur elle. »
On voit donc que la température ressentie était bien comprise il y a trois siècles, à peu près dans les mêmes termes que l’explication donnée récemment par un présentateur télé.
Cependant, ce mémoire de 1710 sur la température ressentie nous rapproche du texte le plus émouvant des Histoires et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences. Il se trouve dans le volume 1702, et il relate l’Histoire d’un fœtus humain tiré du ventre de sa mère par le fondement.

En mars 1702, L’académicien Cassini informe le médecin Littré d’un cas d’une femme alitée, moribonde, qui semble avoir « vidé par le siège » quelques os d’un fœtus. Depuis lors, la femme agonise à petits feux.
Elle était mariée depuis douze ans, et pendant les six premières années de son mariage, elle avait eu trois enfants. Au mois d’août 1701, elle avait ressenti une douleur à la hanche, puis les choses avaient été de mal en pis, dans une séquence complexe de douleurs aiguës, puis moins aiguës, puis atroces, le tout accompagné d’étouffements, de nausées etc.

La pauvre malheureuse, prise de fièvres, de nausées et d’une faiblesse générale était devenue décharnée et squelettique, alors qu’elle jouissait avant ce mal d’un certain embonpoint.
« Avant que d’examiner la malade, je demandai à voir les os qu’elle avait rendus par le fondement. Je reconnus d’abord qu’ils étaient de véritables os d’un fœtus & d’un fœtus d’environ six mois. »
Cette constatation de Littré est confirmée par les faits suivants : « au mois de Mai 1701, elle avait eu une forte envie de manger d’un maquereau, qu’elle n’avait pu satisfaire à cause de la cherté. On la fit encore se souvenir que dans la même tems elle avait été dégoûtée des alimens ordinaires contre la coûtume & qu’elle avait eu des maux de cœur. Or de fortes envies, des dégoûts des maux de cœur étant des signes de grossesse, on peut dire que cette femme étoit devenue grosse en ce tems là ».
Ainsi, la pauvre malheureuse, avait fait une grossesse extrautérine. L’enfant était mort à 6 mois de gestation dans les trompes, et la décomposition du fœtus avait abouti à une large perforation du colon, par lequel des morceaux du fœtus était sortis en direction du rectum et finalement l’anus.
Nous sommes en 1702, inutile de dire que cet épisode se traduisait par une infection généralisée, une occlusion intestinale, des douleurs atroces, une ulcération générale de l’intestin, du rectum et de l’anus. Et la perspective d’une mort certaine à brève échéance.
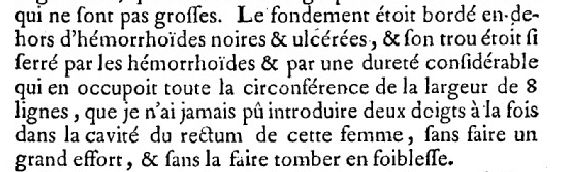
Examinant l’intérieur des boyaux, Littré découvre que c’est la tête du fœtus qui obstrue le colon par sa grosseur, et que cette tête ne peut pas sortir par les voies naturelles.
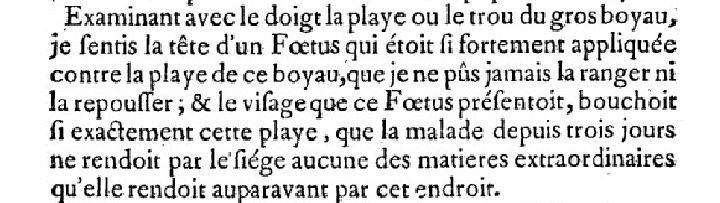
Constatant ce fait mécanique qui la condamne, Littré va entreprendre une fantastique opération de sauvetage qui va durer plusieurs mois.
Tout d’abord, il va nourrir la malade avec des bouillons pour lui redonner des forces et la mettre en situation de subir une opération par les voies naturelles.

En second lieu, il va faire fabriquer des outils spéciaux permettant de découper la tête du fœtus dans l’abdomen, en passant par l’anus et le trou déjà présent dans le colon.

L’extraction des os du crâne prit un mois. D’abord, Littré pensa renoncer et la laisser mourir.

Finalement, il tenta l’opération avec les pincettes conçues spécialement pour cette intervention. Procédant à tâtons, pinçant et découpant les parties du fœtus en s’assurant de plusieurs façons qu’il n’est pas en train de découper la mère ; Littré va parvenir à sortir en petits morceaux l’enfant mort. Cette opération va prendre un mois, en causant à la mère d’atroces souffrances.
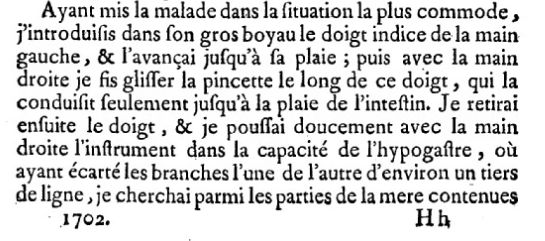
Cette opération réussie, la malade n’est pas tirée d’affaire. Littré identifie 6 étapes nécessaires pour sauver sa patiente. La première consiste en un nettoyage et une stérilisation de la plaie infectée et glaireuse depuis plusieurs mois ; de tout l’abdomen en fait.
La seconde est de cicatriser les plaies de l’abdomen, sur tout le chemin emprunté par le cadavre du fœtus entre la trompe et le colon.
La troisième est de cicatriser, si faire se peut, le trou béant dans le colon communiquant avec l’abdomen.
La quatrième de fondre et guérir tous les hémorroïdes et ulcérations du fondement.
La cinquième de faire de même avec les ulcérations intérieures du colon.
Et finalement de guérir toutes les autres lésions dues à la maladie, rétablir la digestion etc.
La guérison complète de la malade, avec d’infinies précautions va prendre encore trois mois.
Vers la fin septembre 1702, soit un an et cinq mois après le début de sa grossesse extrautérine, cette femme « est aussi forte & dans un aussi embonpoint qu’avant, & elle jouit d’une santé parfaite. »
Le reste du mémoire est consacré à étudier comment le fœtus a pu parcourir ce trajet et causer tous les maux observés sur la malade.
Je me rends compte en relisant ce mémoire, que mes activités de recherche sont beaucoup centrées sur l’anus, qui est un acteur essentiel de la formation des deutérostomes (les animaux, comme nous, qui font la bouche en second, façon aimable de dire que nous faisons l’anus en premier, au cours de l’embryogénèse). Une partie très importante de mon activité consiste à filmer les mouvements embryonnaires qui causent la formation de l’anus, comme dans le film ci-dessous (pleine échelle environ 2 millimètres).

Sachant qu’ensuite l’anus tire pour nous fabriquer, comme dans ce film-ci (pleine échelle environ 4 millimètres).

Le rectum et l’anus, chez beaucoup d’animaux, se confondent avec les voies urogénitales, qui n’ont pas un tractus spécifique. Les œufs ou les semences sont balancés dans un cloaque avec le reste. La formation d’une tuyauterie spécifique pour l’appareil urinaire et reproducteur est une innovation qui repose d’ailleurs sur de la physique.
Je suis un peu troublé qu’Arlette Farge ait l’occasion, en tant que sociologue de la condition féminine, d’identifier des textes savoureux et élégants, en relation avec l’émancipation des femmes, sujet noble et de circonstance qui la valorisent. Pour ma part, biophysicien de la chose anale, si j’ose dire, je me retrouve attiré par des textes singuliers comme le fœtus tiré de sa mère par le fondement, qui relèvent plutôt du film d’horreur scatologique.
Cependant, ce texte présente un cas merveilleux d’une femme jeune, mariée, et mère de famille, arrivée au bord du gouffre dans des douleurs atroces, un pied et la moitié de l’autre déjà dans l’au-delà, et finalement guérie. Cette femme est revenue, grâce aux médecins, dans le monde des bien portants, après des mois de souffrances.
Et tout à coup mes yeux s’écarquillent, et je me dis que peut-être le destin a-t-il mis ce texte sous mes yeux, pour une autre raison.