L’esthétique de la résistance, roman, le journal des lectures, première série
Mardi 25 octobre 2005
Dans les derniers temps il avait à soigner presque autant de patients perturbés psychiquement que de combattants arrivés avec des blessures corporelles.
Le narrateur, au lieu d’aller au front comme il l’espérait, se retrouve à l’arrière, dans une propriété aristocratique occupée par un médecin et plus d’une centaine de malades et de blessés.
Brusque changement de perspective et de ton. Nous aussi sommes désarçonnés, déplacés.
On s’était heurté, dans les premiers jours de route vers le front, aux signes, aux rumeurs, aux actes d’autorité - voici maintenant une description drôle et lamentable des larcins, de la démoralisation, du relachement qui succèdent à la tension du combat.
C’est comme si on se devait de réfléchir aux lendemains de révolution, ou de révolte, quand les projections vers le futur sont revues à la baisse.
Hodann, le médecin, fait une entrée dramatique : crise d’asthme, et une entrée de sage : sa parole dénoue les conflits. On sait pouvoir, lecteurs, s’appuyer sur lui dans les disputes qui suivront.
Et tout de suite est posée son opposition à Diaz, le commissaire politique. On a parfois été embarqués, jusqu’ici, dans quelques-unes des embardées dogmatiques du jeune narrateur sympathisant communiste. On sait maintenant, ayant Hodann pour guide, Hodann qui est l’un des fondateurs de "la ligue mondiale pour une réforme sexuelle scientifique", qu’on ira chercher profond dans les causes de la domination...
De tout cela, on pouvait se douter, question d’éclairage, dans cette scène, d’un Peter Weiss cinéaste, quand le narrateur quitte Cueva La Potica pour rejoindre l’unité sanitaire :
Derrière la lourde porte de bois portant le numéro quatorze et la date de mille-huit-cent-quatre-vingt-seize en fer forgé, un escalier de marbre conduisait vers un hall au centre duquel l’éclairage venait d’un cube aux cloisons de verre, entouré d’un couloir sur les murs de verre duquel se trouvaient les portes donnant dans les autres pièces. Le décor de stuc des plafonds, les motifs floraux des mosaïques sur le sol se reflétaient et se réfractaient dans les vitres, les boîtes et les bouteilles, les instruments chirurgicaux et les seringues à injection sur les tables étaient doubles, ils formaient des alignements dont on ne pouvait dire avec certitude dans quel placard de verre ils se trouvaient effectivement, les infirmiers aussi, soldats détachés du front, circulaient dans les pièces démultipliées avec des bulletins de commandes, des paquets et des sacoches, et le kaléidoscope d’un visage tout en rondeurs et en plaques brillantes, en barbiches noires, glissait vers moi jusqu’à ce qu’il se précisât, c’était le visage de Feingold, membre de l’administration de Cueva la Potica, qui m’attendait pour me conduire dans une automobile surchargée jusqu’à l’hôpital près du Jucar.
Mardi 11 octobre 2005
C’est ici qu’est ma place, ici, dans le paysage de Don Quichotte(...)
On a rejoint le front de l’armée des républicains, et on fait connaissance avec Hodann, un personnage seulement cité en passant dans la première partie, un psychanalyste au côté des communistes, et nous aurons besoin de son questionnement et de son intelligence critique pour voyager yeux grands ouverts dans la guerre contre les fascistes mais aussi et surtout dans les débats dramatiques, et qui peuvent se conclure dans le sang, entre anarchistes et communistes.
Lire, écouter L’esthétique de la résistance au Tunnel
Bernard Moreau est un jeune écrivain, il vit et travaille dans les Yvelines, il est venu jusqu’aux Buttes Chaumont, en juillet dernier, et il nous fait parvenir ces notes prises quelques semaines après, comme une correspondance entre la physique du livre et celle du lieu dans lequel il est lu.
Une heure de lecture dans le secret d’un immeuble parisien qu’est son fond de cour et son espace encaissé, ses locaux d’un autre âge qui basculent sur autre chose de la ville, son passé, un décor incongru, des associations cachées, des métiers perdus ou bien encore ces personnages invisibles dans la rue, une heure de lecture de L’esthétique de la résistance dans le Tunnel et c’est déjà goûter la vision de la première pierre d’une construction à venir. La voix de Laurent Grisel s’installe derrière la petite lampe posée sur sa petite table et voilà que s’accumulent les phrases, que se façonnent les courbures du récit, que se scellent les changements de lieux et d’époques et la main mentale de l’oreille peut commencer à glisser sur les parois du texte, sur les murs de l’édifice, sur la façon qu’a la pensée d’attaquer la pierre, d’en faire ce rempart, cette avancée dans le corps mou de l’époque. Ce jour là, il est question de Pergame, autant de pierres, autant de volonté d’édifier, autant d’hommes aussi rassemblés à travailler ensemble, comme plus tard ces ouvriers qui écoutent à la pause les paroles et les discours de ceux qui parlent et l’on perçoit encore cette volonté de construire, l’espace s’agrandit aux dimensions de l’usine, de la somme des hommes en pause qui vont reprendre, dans l’instant qui suit la narration, leur formidable efficacité collective, de si peu de profit pour chacun d’entre eux. Et on la devine encore cette grande architecture lorsque le récit se replie dans cette étroite cuisine confinée où quelques uns tentent d’édifier leur propre savoir et la cuisine devient un laboratoire aux dimensions de l’humanité, le temps a passé et les mots se sont accumulés et l’heure de lecture est devenue tout l’air que l’on respire dans l’ascétisme d’une salle de fond de cour, les pavés gris que font les paragraphes sur les pages tournées là-bas sous la petite lampe ont pris corps entre les piliers de métal de la salle, ont construit cet espace qui lie les gens assis, ont lancé le corps du livre à l’assaut du rien ou du peu qu’abrite le fond de la cour, petite pièce blanche comme un écran de trois dimensions qui attend que les mots dits, les mots articulés dans le récit épique, intime, dans le discours historique, savant, politique, polémique, social et artistique, que tous ses mots viennent la remplir comme une nouvelle construction dans laquelle on entre, on est entré, voilà maintenant qu’on peut en parcourir le volume sensible, on veut apprendre, on veut comprendre et le mystère de l’épaississement du monde se consomme.
On était peu nombreux ce soir là de juin dans l’éblouissement du soleil de fin de soirée. Lorsque la lecture a fini, le temps avait passé, le soleil tiédissait dans la cour. Tous nous sommes restés pourtant dans la salle, un peu de vin et d’amuses gueule y incitait, mais enfin il y avait aussi cette présence du texte dit dans l’espace, cette visite au livre réalisée ensemble, ces choses vues mentalement de concert. Chacun y installait ce qu’il avait entendu, les langues se sont un peu déliées pendant que nos corps s’étiraient après l’engourdissement d’être restés assis, les discours se sont croisés, parfois heurtés. Le livre renvoyait en tous cas aux préoccupations que chacun avait laissé en ouvrage avant de venir. D’avoir rendu sensible le texte à nos oreilles, s’il ne restait que des bribes de phrases encore debout, cela nous en laissait un souvenir encore palpable et dans cette présence de la matière, chacun pouvait tirer de quoi nourrir son expérience et sa position dans le monde. Je sortais d’une lecture de plusieurs jours à propos du savoir et de l’abrutissement et le texte de J. Rancière entrait en résonance avec les propos tenus dans la cuisine de Coppi sur le savoir, la science et les rapports de domination. Une heure seulement de ce livre imposant (pour qui comme moi ne le connaissait pas) et on en comprend déjà l’importance à cette capacité dans le flux à haut débit du texte lu à soulever les questions et à pointer des horizons le plus souvent enfouis dans le monde tel qu’il est. Et l’envie vient, malgré les kilomètres, de revenir explorer quelques salles supplémentaires que la lecture au long cours construira dans les mois qui viennent...Bernard Moreau
Mardi 11 octobre 2005
C’est ici qu’est ma place, ici, dans le paysage de Don Quichotte, ces mots de la lettre de Hodann qui m’avait été adressée à Warnsdorf par le comité pragois pour l’Espagne, me vinrent à l’esprit lorsque, serrés dans le camion, nous sommes arrivés sur le haut plateau de la Manche sous un amoncellement de nuages que teintaient de rouge, de violet, les rayons du soleil couchant. Une semaine auparavant nous avions laissé derrière nous les garde-frontières français, nous avons progressé à travers la caillasse entre Céret et Junquera à travers les buissons et les oliveraies, puis nous avons trouvé les premiers postes républicains. Passant Gerona, Carella, (...)
Début de la deuxième partie (le livre en compte sept), brusque changement de décor : nous sommes en Espagne, nous rejoignons les lignes des républicains. Mais halte pour commencer à Barcelone, et visite de la Sagrada Familia de Gaudi...
C’est comme si on recommençait : à nouveau, comme dans dans les toutes premières pages du livre quand nous tournions autour du temple de Pergame, un sidérant panoramique, une oeuvre en fragments, une oeuvre qui englobe une totalité mais dont on doit reconstituer le mouvement d’ensemble, deviner des détails disparus, un appel à l’interprétation.
Introduction d’un nouveau personnage, un jeune homme lui aussi follement curieux d’art, et qui s’appelle Ayschmann, un juif, - dans la lecture à chaque fois je trébuche sur son nom, tant est forte la parenté sonore avec Eichmann le bourreau.
Et le narrateur, de son camion qui les transporte tous vers le front, regarde souvent les nuages.
Mardi 4 octobre 2005 - autant il était facile de rendre ce que j’avais imaginé, autant il était difficile de fixer quelque chose de ce qui m’était vraiment advenu
Le libraire posa le grand livre des éditions Schroll sur un lutrin et la petite ville de Warnsdorf dans la Bohême automnale se fondit avec les paysages flamands du seizième siècle tout comme durant les jours qui suivirent, tandis que je lisais Kafka, le village et le château qu’il décrit vinrent s’inscrire dans la solitude rustique, petite-bourgeoise m’entourait ici. Brueghel et Kafka avaient peint des paysages universels, fins, transparents, mais dans les tons de la terre, leurs tableaux étaient à la fois lumineux et sombres, ils paraissaient massifs, lourds dans l’ensemble, incandescents, plus que nets par leurs détails.
Chance ce soir, et impromptu : Rüdiger Fischer, de passage à Paris, lit en allemand, en alternance, deux extraits, en début de lecture : on entend chanter l’allemand, la langue natale de Peter Weiss et dans laquelle il écrivit la plupart de ses oeuvres, comme, de Suède où il vivait, d’une province éloignée.
Et dans le monde qui vient, il y a maintenant un cercle d’habitués, quelques qui reviennent d’un mois sur l ‘autre, et des nouveaux, et ce soir, grève ou pas, venus en vélo, deux jeunes attentifs qui viennent voir Rüdiger en fin de lecture pour consulter l’édition allemande - la jeune femme, c’est Léonie De Rudder qui présentera, le 9 décembre prochain, les films de Peter Weiss à la Cinémathèque - les lecteurs de remue en sont informés par la chronique de Dominique Hasselman. Nous ferons place à ces films lors d’une prochaine lecture et, aussi, dans le dossier Peter Weiss de remue.
Nous sommes dans les tableaux de Brueghel, nous relisons Le château de Kafka. La domination, la soumission, inscrites dans les oeuvres. Précisément en quoi elles sont bouleversantes : ce qu’elles révèlent de sa propre condition. Et ces prises de conscience, qui ont la force d’une vérité qui ne fait plus de différence entre intérieur et extérieur, font qu’on ne peut accepter de rejeter ces oeuvres, même quand on est le jeune narrateur, sympathisant communiste, ouvrier autodidacte, des années 37 - 37, en pleine période de réalisme socialiste et de littérature prolétarienne.
Et puisqu’on va par contrastes, par questions nourries de réputés réconciliables qu’on s’efforce de saisir ensemble, malgré tout, le narrateur compare Le château avec un roman rouge à un mark, Les barricades de Wedding de Neukrantz.
[Le livre de Neukrantz fut le premier qui] éveilla en moi le désir de noter quelque chose par moi-même (...). Je voulais moi aussi m’y mettre sans détour, de la même manière ouverte et partiale, (...). C’est alors que le livre sur le château vint s’ajouter à une inquiétude longuement accumulée et un désir d’apprendre qui en était encore à ses débuts. Il m’oppressa, me contraignit à voir mes faiblesses et mes négligences. A cette époque, six ans plus tôt, il n’y avait rien d’insurmontable, j’étais assis dans les branches du petit bois de tilleuls, dans la baie aux roseaux, en face de Baumwerder et j’écrivais dans mon cahier bleu, sans modifier un seul mot, rapidement, avec facilité, sous la dictée d’une voix intérieure, puis j’entrai dans le monde du travail et, autant il était facile de rendre ce que j’avais imaginé, autant il était difficile de fixer quelque chose de ce qui m’était vraiment advenu. Tout en recherchant une expression il fallait d’abord surmonter tout ce qui avait été détruit, déstructuré en nous. Nous nous demandions ce qu’était le vrai dans l’art (...)
Et Peter Weiss rêve d’une littérature qui se développerait dans la confrontation de l’expérience ouvrière, politique, et de l’étude intime critique des maîtres, de nos classiques.
Nous terminons ce soir la première partie de ce roman qui en compte sept au total. Sur un crime ; un simple d’esprit, surnommé Le juif, lapidé par des voyous.
Mardi 27 septembre 2005
En septembre trente-six, mon père et Wehner longeaient le boulevard Raspail, à l’ombre des feuillages, Piscator avait surgi devant eux, tout juste rentré de Moscou, le visage gris, passant la main sur ses yeux, décrivant les soupçons qui pesaient sur Neher, la comédienne avait fui l’Allemagne du jour au lendemain, et ses efforts pour l’atteindre, elle, ainsi que d’autres antifascistes qui avaient été traînés devant les services de contrôle.
Mardi 20 septembre 2005 - c’était comme si on ne disposait pas encore de langage
Nous sommes en 1937, en Allemagne, la dictature est presque au plus haut, la défaite des partis de gauche immense, les quelques résistants qui nous emmènent dans ce récit en ont seulement une intuition vague, par manque d’informations sur cette situation qui leur échappe, et très aigue, par la menace qui pèse sur leurs vies à chaque instant.
La douleur de la lecture de ce soir est celle de vivre dasn l’incertain et dans l’incompréhension de ce qu’on subit, de ce contre quoi on lutte. On commence par les fausses certitudes et c’est tout de suite pour basculer dans l’incertitude et les questionnements :
Pour nous, le fascisme était la dictature manifeste du capitalisme et des financiers, il était l’arme des forces les plus réactionnaires, au service de leurs intérêts qui exigeaient une redistribution de l’Europe. Mais cette formule, dit mon père, n’expliquait pas encore pourquoi, dès l’année trente, une bonne partie de la classe ouvrière donna sa voix aux national-socialistes et pourquoi le nombre des électeurs en faveur du fascisme pouvait atteindre les dix-sept millions au printemps trente-trois. Il ne suffisait pas, dit-il, d’en rendre responsables les seules années de crise, l’éclatement de la classe ouvrière, il fallait chercher les véritables causes (...)
La contrainte très forte qui organise ce roman de 950 pages - une voix de narrateur au présent - et seulement elle - seukement ce qu’elle rapporte - cette contrainte entre en résonnance avec cette quête de l’issue, une victoire rêvée au sein de la défaite la plus dramatique.
On lie, à chaque phrase, à chaque mot, le destin collectif et la responsabilité personnelle. Et c’est à chaque instant une question de vie ou de mort :
(...) on ne pouvait obtenir que de vagues informations qui étaient aussitôt brouillées. C’était comme si on ne disposait pas encore de langage pour ces fouilles, ces recherches, ces planques interminables où on retenait son souffle, ces lents tâtonnements, la quête d’intermédiaires anonymes, d’adresses chiffrées, pour le face-à-face soudain avec l’assassin. Si le contact avec le poste suivant de la chaîne organisée échouait (...) cela voulait dire que d’une heure à l’autre un groupe avait fait défaut et qu’il fallait prendre de nouvelles décisions. Chacun, même s’il faisait partie d’un groupe d’action important, ne devait compter que sur lui-même, ne répondait que de lui-même et devait, en cas de besoin, porter la responsabilité pour tous les autres, aller seul à sa perte avec cette responsabilité.
Mardi 13 septembre 2005 - J’allais devoir commencer par ce qui n’a pas de forme
Ce mardi, reprise des lectures, et nous sommes dans la conversation entre le narrateur et son père, l’examen difficile, contradictoire des raisons de la défaite des forces de gauche en Allemagne, dans les années ’30.
Ce qui crée le mouvement dans cette partie du texte (et aussi, dans le fond, dans tout ce roman de Peter Weiss), c’est la succession des raisons : chacune joue son rôle et laisse la place à d’autres. Lisant, écoutant, on se prend à s’interroger sur les raisons que l’on aurait de se satisfaire de l’une d’elles et d’arrêter... Mais non, le roman, la recherche continuent.
Ce n’est pas encore l’automne, il fait beau dans la cour du Tunnel, mais déjà d’une lumière oblique, les jours raccourcissent à toute vitesse. Nous reprenons la lecture par ces quelques lignes, c’est le père du narrateur qui parle :
À l’époque, je n’étais pas encore capable de préciser mes doutes, dit-il, mais j’étais déjà dégoûté de voir à la suite de constantes dissensions un groupe dirigeant en remplacer un autre et de voir - en des termes qui dépassaient en haine ceux de la social-démocratie - rejeter tout soudain comme sectaires, comme renégats, par les gens de leur propre bord, les forces les plus actives, les plus dévouées sans lesquelles il n’y aurait eu ni Parti, ni Internationale, simplement parce qu’elles ne soutenaient pas la ligne du moment admise comme juste.
Deux thèmes se superposent : la recherche des causes de la défaite, mais aussi les difficultés de s’informer, d’analyser, de comprendre ce qui se passe autour de soi dans un monde d’informations biaisées par la dictature et la lutte clandestine.
On se rend compte tout d’un coup que cet entrelac est peut-être, simplement, sur un autre plan, une métaphore : celle de la difficulté de faire son chemin d’écriture et de fiction au milieu des pressions et contraintes de toutes sortes qui qui menacent la vie même, c’est à cet endroit du roman, page 142, qu’on découvre que le narrateur va nous parler de sa vocation d’écriture :
Mais si je réussissais un jour à jouer au plus fin avec les forces qui cherchent toujours à détourner le cours de mes pensées et à réserver leur liberté de mouvement aux incitations, aux intuitions (...) en train de mûrir en moi, je n’attacherais pas quant à moi d’importance au fait que celui qui écrit doit faire partie d’un pays déterminé, d’une culture nationale (...) afin que ce qu’il écrit soit convaincant. (...) De même que cette pièce où nous parlions ensemble n’était que fortuite et pouvait se trouver dans n’importe quel pays, de même devrais-je, en écrivant, m’adresser à des hommes qu’on pouvait trouver partout, indépendamment de leur origine, l’internationalisme deviendrait le signe distinctif de mon appartenance. Car notre seule patrie était notre esprit partisan (...) Je pouvais certes reconnaître les avantages que l’on a d’appartenir à un pays, à une ville, mais mon projet n’avait pas ce point de départ, j’allais devoir commencer par ce qui n’a pas de forme, ne se rattachait à rien et chercher des corrélations par delà les frontières et les langues.
Mardi 12 juillet 2005
À quoi nous a servi notre engagement, dit-il, même si on le qualifie d’héroïque, il ne suffisait pas à stimuler d’autres gens, à les entraîner, dans ce froid printemps la population avait perdu la force de se battre. Ils avaient, dans la tourmente de neige, porté leurs morts en terre, des appels isolés à la vengeance retentissaient encore ça et là, le cortège accablé pouvait passer dans les rues sans être importuné, les responsables de la municipalité étaient sûrs de leur affaire. Pourtant, même aujourd’hui, dis-je, il y en a qui se maintiennent. Rien que des petits groupes, répondit-il, vingt ans plus tard des groupes toujours aussi réduits (...)
La défaite de la révolution de 1919 et la prise du pouvoir de Hitler se superposent ; vertige.
Je me demandais comment se passerait cette lecture d’une heure entièrement consacrée à l’analyse historique et politique. Très bien. Ce sont les rapports entre le narrateur et son père, entre le le père et le fils, qui tiennent toute la scène, qui nouent la fatigue, la tristesse, celles du père, et l’espoir, celui du fils, un espoir qui se confond indissolublement avec la soif de savoir et de comprendre.
Une autre clé de cet épisode est le rapport au temps : pour chacun des acteurs c’est le critère décisif ; Rosa Luxembourg qui a raison trop tôt quand au régime soviétique, à un moment où on ne peut l’entendre ; la contradiction entre la très longue durée qu’exige l’auto-éducation, la conquête de l’esprit critique et de l’autonomie - et la précipitation d’événements dramatiques, une course de vitesse gagnée dès le premier assassinat. La longue phrase tendue de Peter Weiss tient ces durées ensembles, rend leur contradiction palpable et insupportable.
Et vous étiez plutôt nombreux dans cette salle du Tunnel qui nous abrite de la chaleur, attentifs extrêmement, une énergie que je prends et emmène avec moi tout au long de cet été, pour la préparation des lectures de l’automne et de l’hiver prochain. Encore merci à vous tous.
Mardi 5 juillet 2005
Peut-être m’étais-je trompé dans mes calculs en organisant mon plan ou, me demandai-je, avais-je pensé qu’il me faudrait encore un long temps de réflexion avant le départ, afin de récapituler les années passées dans ce pays. Mais à présent il était pourtant clair qu’il ne se passait rien de décisif, que la date du voyage ne pouvait être séparée des dates qui suivraient, que le temps était une seule et unique continuité, indivisible, à considérer, à observer toujours comme un tout, et plus une période était éloignée du point où l’on se plaçait, plus elle se fondait dans l’homogénéité de ce qui la précédait et de ce qui la suivait. Ainsi cette heure contenait-elle déjà toutes les heures à venir et je me demandais ce qui distinguerait ce vingt-deux septembre dix-neuf-cent-trente-sept, un mercredi, dans quelques jours à Warnsdorf, dans quelques semaines en Espagne, dans trois ou quatre décennies en des lieux encore inconnus en dehors du cube dans l’angle duquel j’était assis entre deux surfaces, repérant les trous laissés par les clous, l’empreinte de quelques meubles. Cela aussi faisait partie de la fuite : le fait qu’au moment même où je tentai d’attribuer une place historique à la journée que je venais de vivre, tout ce que j’en savais c’était qu’on avait enterré à Lany près de Prague Masaryk, le président du pays dont j’étais citoyen depuis que le lieu de naissance de mon père avait été cédé à la Slovaquie...
Quelques jours avant de partir vers l’Espagne, le narrateur entre dans une profonde rêverie où il rencontre son père mort et vivant, et ils se parlent comme ils ne se sont jamais parlés.
Le narrateur s’envole par la fenêtre et il se demande pourquoi on croit que ce que l’on voit est vrai.
C’est comme si toute l’énergie des discussions précedentes sur le réalisme, sur les briseurs de visions convenues (cubistes, surréalistes, etc), et aussi sur le désir de voir et de savoir des autodidactes, comme si cette énergie permettait qu’enfin il s’envole.
Et il interroge son père. Leurs souvenirs se superposent. Son enfance (la sienne) et son enfance (la sienne) : leurs enfances. Il (le narrateur) a entendu les fusillades de la révolution de 1919 à Brème, ce sont les récits de son père qui calent ces souvenirs et leur donnent un sens, et le choc, comme transmis au fils, d’une balle qui démet l’épaule.
Le mouvement de ce roman qui explore toutes les raisons de lutter est de n’épargner aucune défaite, de les scruter toutes.
Mardi 28 juin 2005
Et nous nous demandions si la dépendance dans laquelle se trouvaient les artistes par rapport à la cour et au clergé, l’obligation pour eux de répondre aux désirs des clients n’assurait pas à leur travail une sécurité et une vigueur plus grandes qu’à des époques ultérieures où ils s’isolèrent, n’assumant de responsabilité qu’en leur propre nom. La lente et tranquille exécution de l’oeuvre au sein d’une série stabilisée par la tradition fut remplacée par le besoin d’originalité, la nouveauté n’était pas attribuée au talent accompli mais au génie et cette obligation de se singulariser, de se vouer à l’individuel conduisit à l’isolement, à la délectation morose, les souffrances personnelles, le dégoût devinrent les notes dominantes et, pour finir, l’art lui-même fut mis en question. La gravure de Dürer représentant Le fils prodigue et sa Mélancolie marquèrent la séparation entre l’art hiérarchique et l’art ne dépendant plus que de lui-même et contraint de faire ses choix absolument seul. Nous nous demandions alors s’il ne serait pas légitime d’imposer néanmoins une ligne directrice à l’art et à sa prétention à l’exclusivité et si le fait de lui fier ainsi une fonction déterminée produirait de nouvelles conséquences, réveillerait des convictions. Mais un style ne se laissait pas imposer de force, il devait se développer organiquement. Un des aspects de la période dans laquelle nous vivions (...)
Ces premières phrases donnent une idée de l’un des plaisirs de cette fiction, d’une des raisons de la lire à voix haute c’est-à-dire partagée : nous sommes du côté de ces trois ouvriers, Heilmann, Copi et le narrateur, et nous sommes donc remis au début de notre vie intellectuelle, autodidactes, et nous nous demandons ce qu’apportent chacune des rencontres artistiques que nous faisons, liberté, fraternité. Et nous nous rendons compte que ce souffle, la transmission d’énergie venue de toute l’humanité, une force accumulée depuis l’antiquité, depuis bien avant, nous pourrions vouloir la mettre à notre service... Et parce que nous sommes, avec Peter Weiss, dans cette Esthétique de la résistance, en 1937 et après, au coeur des errances du mouvement ouvrier - au moment où l’on paie le plus gravement ses erreurs, non seulement par les purges stalinennes mais aussi par les divisions qui ont pour conséquence la destruction du mouvement ouvrier en Allemagne et dans d’autres pays - que nous pouvons saisir immédiatement les conséquences dramatiques de toute volonté de maîtrise et d’asservissement de l’invention artistique.
Alors c’est le moment de descendre, avec Dante, en enfer.
Coppi, Heilmann et le narrateur avancent comme ils peuvent dans ce texte, ils souhaitent se construire leur propre interprétation, ils ne se fient donc pas à la traduction (à l’interprétation) "de Gmelin dans la Bibliothèque universelle de Reclam ni à celle de Borchardt dans l’édition des livres de poche de Cotta". Ils tâtonnent,
comparant les tercets avec le texte italien que nous lisait Heilmann en s’aidant de sa connaissance du latin et du français. Avançant ainsi à partir des inexactitudes linguistiques, des métaphores adoucies, des rythmes et des successions de sons de la couche extérieure jusqu’aux corrélations internes d’une ardeur qui ne se relachait jamais, nous constations que se réveilllaient en nous des choses vécues dont nous n’avions rien su auparavant, qui s’étaient déposées en nous mais que seule la poésie faisait revivre.
Tous ces morts que Dante rencontre, et ces rencontres elles-mêmes, que transmettent-ils ? Le désir de savoir qui est qui, et donc ce qu’on pourrait être soi-même, et la mémoire de ce qui est passé, et de ce qui sera - car aucun acte n’est sans conséquence.
C’est dans ces enchaînements qu’on expérimente la liberté de création : celle de tracer un portrait inouï de son époque, "le catalogue quasi pédant de tous les attributs s’attachant inévitablement à ceux qui gravaissent tous les échelons du pouvoir".
Et cette liberté a à voir avec la mort.
Il apparut ensuite dans la démarche mesurée, consciente de la composition que le contact avec l’idée de la mort, la vie avec la mort et avec les morts pouvaient donner l’impulsion à la création, mais que le produit achevé était destiné aux vivants et devait donc être exécuté conformément à toutes les règles de la réception et de la réflexion vivantes. Dante illustrait bien cette double démarche où la peur de la disparition se surmontait elle-même, en laissant des signes qui survivaient à sa propre vie et si, au début, on avait l’impression que cette métamorphose se dissimulait sous des symboles et des allégories que seul pouvait comprendre le familier de la scolastique, ce qui apparaissait en filigrane dans les symboles révélait peu à peu à nos tâtonnements des détails qui parlaient d’une réalité observée de très près. Il n’était plus nécessaire que nous comprenions dans l’énoncé du texte exactement ce qu’il voulait dire peut-être six cents ans plus tôt, mais que cet énoncé puisse être transposé dans notre époque, qu’il reprenne vie ici, dans ce parc à côté du terrain de jeu des enfants, ici, parmi ces tombes fraîchement refermées, en aval de l’église Saint-Sébastien, car ce qui lui conférait sa durabilité c’était le fait qu’il suscitait notre propre réflexion, qu’il appelait nos propres réponses.
Mardi 21 juin 2005
Nous voyions dans les tableaux de Max Ernst, Klee, Kandinsky, Magritte la liquidation de préjugés visuels, une lumière crue jetée sur la fermentation et la pourriture, la panique et le défrichement, nous faisions la distinction entre les attaques contre ce qui était dépassé et en plein déclin et le simple manque de respect qui, en fin de compte, n’entravaient en rien la liberté du marché. Nous évoquions les conceptions contradictoires qui préféraient, d’une part, dépeindre la réalité dans sa diversité, son éclatement et sa confusion, qui d’autre part, rendaient le déclin de façon objective et précise, comme Dix et Grosz, qui disséquaient et évaluaient la réalité du moment, comme Feininger, et d’autres qui la laissaient s’embraser, exaltés, comme Nolde, Kokoschka ou Beckmann. Stimulés par les interdits, par les arrêtés décrétant ce qui désormais devait être considéré comme de l’art, par les mesures de censure qui montraient que les maîtres de l’heure reconnaissaient le travail de sape dont l’art était capable, nous étions toujours à la recherche de livres et de revues (...)
Toute cette lecture, ce quatrième épisode, dans la lumière des cours du soir que suivent Heilmann, Coppi et le narrateur, nous luttons contre le sommeil et la fatigue, et nous passons en revue l’histoire de la peinture réaliste, jusqu’à son retournement en coquille vide, conventionnelle (le dit "réalisme socuialiste"), et à chaque tableau nous lui demandons quelle est sa nécessité - le fait que nous approfondissions pour chacun d’entre eux en quoi il est en résonance avec son époque, n’enlève rien de sa force actuelle et inactuelle.
Nous sommes en 1937, la répression nazie a balayé apparemment toute résistance, de plus en plus rares sont les cellules encore actives, et au voisinage des oeuvres que nous examinions nous sommes dans un état de non-solitidude paradoxale.
Guenaël Boutouillet anime l’atelier d’écriture du Manège avec Cathie Barreau, il était parmi les auditeurs, et de mon livre et ma lampe, même si je redresse la tête de temps à autre, une espèce de ponctuation, le cercle des attentions silencieuses, je ne saurais plu s dire où il était assis. Quelques jours plus tard il m’envoie ses impressions de lectures, j’y trouve un écho de l’énergie dégagée par la fiction de Peter Weiss ; "un grand calme nous agite" dit G. Boutouillet. Mais lisez :
Je n’ai cessé d’en parler aux uns et aux autres depuis cette petite heure passée au Tunnel à écouter un bout de ce texte, n’ai cessé d’affirmer - et continue - que c’est important. Un simple bout de L’Esthétique de la Résistance ; un fragment de ce temps étiré sur un an et demi et découpé en à peu près cinquante portions ; une seule de ces portions - m’ont semblé énormément denses.
Je saurais dire aussi que ça m’a reposé de la dilatation par la chaleur et la fatigue, un soir de fête de la musique.
C’est là que ce découpage et ce passage à haute voix prennent un surcroît de sens : car oui c’est un texte ardu, et forcément, puisqu’il traite en une folle tentative d’exhaustivité les rapports de l’art et du politique. Mais c’est un travail de lisibilité auquel s’astreint Laurent Grisel, en ponctuant et aérant - en éclairant, modestement, comme à la lampe de poche - un travail qui permet. Un travail important maintenant, précisément maintenant. Important, oui, qu’un grand calme ainsi nous agite, ensemble même isolés : il faut des lumières comme celle-ci qui, même ténue, pour tenir : debout, ouvert.
Mardi 14 juin 2005
Le valet tenait le lourd morceau de minerai dans une main et la feuille légère dans l’autre, il voyait les nervures et le scintillement des grains et des stries, le fin tissu était arraché de la branche, le fragment avait été détaché du rocher fendu, la lumière y jetait mille reflets que le propriétaire foncier voyait lui aussi, mais ce dernier savait aussi que la matière se compose des plus petites particules, les atomes qui, grâce à de multiples propriétés et attributs, donnent leurs formes à tous les phénomènes. Même si lui, le maître, foulait le même sol que son aide, s’il contemplait le vaste horizon avec ses collines, ses vols de grues et les crêtes des montages s’estompant dans la brume, il avait tout de même conscience de toutes autres dimensions que celles que percevait le journalier. Poussé par le désir de comprendre ce dont il avait besoin, il s’était ouvert à la notion de l’espace à quatre dimensions, après avoir vu se courber la surface de la terre il avait découvert qu’elle était ronde et trouvé qu’en suivant une ligne droite, (...)
Mardi dernier, nous avions un sale goût de défaite dans la bouche : la mort d’Héreclès dans d’effroyables souffrances, la division du mouvement ouvriers en partis qui se combattent, et de moins en moins de cellules de résistance actives, les militants emmenés dans les camps de torture les uns après les autres, les anciens camarades qui applaudissent les nouveaux maîtres.
Il y a un arbitraire dans ces lectures : un découpage d’une heure à peu près. Et je m’arrange pour interrompre brusquement, au milieu d’un développement. Et pourtant chacune de ces lectures (je les note "épisode", ce 14 c’était l’épisode 3, mardi prochain 21 juin ce sera l’épisode 4) est tendue comme une corde de piano, a sa cohérence propre, suit un trajet vibrant.
Ce mardi 14, épisode 3, cette prose est comme un poème de la nécessité et de la liberté. Et on va vers la liberté. Au moment où la lecture s’interrompt, nous évaluons et savourons le goût de liberté donné par le surréalisme ; que représentait-il pour de jeunes ouvriers communistes et socialiste sous le régime nazi,à Berlin en 1937 ?
Mardi 7 juin 2005
Et voici que le roi et tous les dignitaires déclarèrent à Héraclès qu’il était le meilleur, le plus fort, que c’était à lui en réalité que revenait le rang que lui avait volé le souffreteux et médiocre Eurystée, mais ils manoeuvrèrent en même temps pour amener sur le trône de Mycènes celui qui était né avant lui, et celui-ci, de son nouveau trône, envoya des troupes lourdement armées pour massacrer les paysans révoltés et rattraper les esclaves échappés. Ce fut le temps de l’aliénation d’Héraclès, dit Heilmann tandis que de la halle centrale du marché, des camions lourdement chargés de caisses et de cartons vides roulaient vers nous. Ensorcelé par les charmes de Mégara, il ne remarqua même pas que ses gardes du corps avaient été assassinés et enterrés, aucun cri d’alarme ne lui parvint de derrière les murs du château et lorsque, vêtu de soie, il passa pour la première fois sous les portes de la ville où, comme il le croyait, avait commencé l’ère de prospérité, il ne trouva que des mendiants et des enfants à l’abandon qui lui jetèrent des pierres et quelques artisans qu’il tenta d’appeler se détournèrent de lui. Un seul instant d’inattention pouvait réduire à néant tout ce qui avait été atteint et voici qu’avaient passé des mois, peut-être même des années où il était resté à ne rien faire,(..)
Nous avons laissé le peuple de Pergame en plein triomphe ; et dans cette deuxième lecture, le 7 juin, nous allons de façon fatale jusqu’à la mort d’Héraclès, « dans d’effroyables souffrances ».
Puis, sans transition, passé et présent pris dans le même temps du récit et de nos questions, nous arrivons, avec Coppi, Heimann et la narrateur, dans la cuisine de la famille de Coppi ; la porte est vérouillée, les fenêtres sont cachées par des rideaux ; on essaye de comprendre les instructions venues de l’extérieur : comment résister ? est-il possible de surmonter les divisions héritées du mouvement ouvrier ? On parle des destructions : de temples, de sculptures, de livres.
Dominique Dussidour est parmi les auditeurs, elle écoute, et aujourd’hui (ce mercredi 8 juin), elle m’envoie ce texte.
Notes sur un passage de L’Esthétique de la résistance, roman de Peter Weiss entendu le mardi 7 juin.
Il y a les livres que possèdent les écrivains.
Et il y a les livres que possèdent les personnages des romans.
Peter Weiss écrit :
Nous possédions un choix de poèmes de Maïakovski, quelques écrits de Mehring, Kautsky, Luxemburg, Zetkin, Lafargue, quelques romans de Gorki, d’Arnold Zweig et de Heinrich Mann, de Rolland, de Barbusse, Bredel et Döblin. Au lieu d’une couverture en dentelle, d’un vase de porcelaine, mes parents avaient toujours acheté ces petits blocs de papier épais tout recouvert d’informations, de propositions, d’indications imprimées et même lorsque l’argent était rare il arrivait que mon père ou ma mère rentrent à la maison avec un nouveau livre de Toller ou de Tucholsky, de Kisch, d’Ehrenbourg ou de Nexö et, le soir, nous étions assis sous la lampe de la cuisine, lisant à voix haute chacun son tour et commentant le contenu. L’importance de ces livres et la force du lien qu’ils créaient entre nous, nous apparurent à l’époque où, à tout moment, la police faisait irruption chez l’un ou l’autre d’entre nous et se servait des noms des auteurs comme preuves contre nous, et c’est alors que le fait de posséder un volume de Lénine équivalait à un crime de haute trahison.
La scène se déroule à Berlin, en 1937.
Ces livres qui appartiennent à la famille du narrateur ne semblent pas former « bibliothèque » (ou « librairie »).
Du moins ce mot n’apparaît pas. Qu’ils forment ou pas « bibliothèque » aurait dépendu de quoi ? Est-ce une question de quantité de livres ? Non. Comment des livres forment-ils un jour « bibliothèque » ? Ou une bibliothèque n’existe-t-elle que dès l’instant où elle est nommée en tant que telle ?
Les polices politiques interdisent des livres, jamais des bibliothèques. Est-il possible d’interdire une bibliothèque ? Les bibliothèques qui dérangent sont détruites ou bombardées, comme à Kaboul ou Sarajevo.
Cette équivalence entre « un volume de Lénine » et « un crime de haute trahison » en rappelle une autre, dans un autre roman :
la grand-mère n’entendait rien aux livres, elle ne pouvait donc rien interdire. elle montait mon père contre mes lectures. un jour il découvrit kafka chez moi, la métamorphose, et kafka fut interdit.<br
j’avais treize ans et je savais que le premier traducteur de kafka s’était suicidé à paris, solitaire et amer, et les livres de kafka étaient pour les services secrets la preuve à conviction que leur lecteur était sur la voie de la subversion. même les tribunaux militaires - compétents pour les délits politiques - savaient que kafka était nuisible. tout le monde le savait et personne ne pouvait ou ne voulait me l’expliquer.
La scène se déroule à Téhéran, en 1960. Elle est racontée dans Paysages d’une mère lointaine, écrit en allemand par l’écrivain iranien Saïd.
Dans chacune de nos bibliothèques, sous un régime totalitaire quels livres nous vaudraient l’accusation de haute trahison ?
La résistance commence avec la lecture, c’est ce dont parle Peter Weiss.
Dominique Dussidour
Mardi 24 mai 2005
Tout autour de nous les corps surgissaient de la pierre, pressés en groupes, entrelacés ou éclatés en fragments, esquissant la silhouette d’un torse, d’un bras qui s’appuyait, d’une hanche fendue, d’un fragment d’escarre, toujours dans l’attitude du combat, esquivant, rebondissant, attaquant, se protégeant, dressés ou courbés ça et là, anéantis, avec pourtant un pied libre arc-bouté, un dos tourné, le contour d’un mollet pris dans un seul et même mouvement. Une lutte gigantesque émergeant du mur gris avec le souvenir de sa forme achevée, retombant dans l’informe. Une main surgie du fond gris, prête à l’empoignade, reliée à l’épaule par-dessus la surface vide, un visage écorché aux fissures béantes, la bouche ouverte, les yeux fixes et vides, encadré par les boucles foisonnantes de la barbe, le drapé impétueux du vêtement, le tout sur le seuil de sa fin dans l’effritement et sur le seuil de son origine. Chaque détail conservant son expression, fragments friables dans lesquels pouvait se lire l’ensemble, des moignons rugueux à côté d’une glissance polie animée par le jeu des muscles et des ligaments, chevaux de combat aux harnais tendus, boucliers arrondis, lances dressées, une tête fendue en un ovale grossier, un bras levé, triomphant, des talons en plein saut, battus par la tunique, le poing fermé sur une épée disparue, des chiens de chasse ébouriffés, les gueules accrochées dans les hanches et les nuques, un homme, en tombant il visait de la base du doigt l’oeil de la bête au-dessus de lui (...).
Ce sont les premières lignes de L’esthétique de la résistance, roman, lues ce mardi 24 mai 2005.
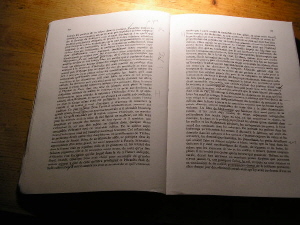
Nous y sommes. La salle est pleine, quelques assis sur des coussins, sur le tapis d’hospitalité ; écoute ; ce texte si souvent répété se déroule devant nous ; c’est comme si j’étais entré, dans ces instants, dans un long couloir de temps.
Nous sommes le 22 septembre 1937, à Berlin, bruits de bottes et uniformes bruns partout. Les personnages et le narrateur font le tour de la frise de l’autel de l’autel de Pergame. Le héros de ces premières pages est Héraclès. Les légendes antiques sont réentendues comme des histoires d’oppression et de libération, on redécouvre ce qu’on croyait savoir. Mais on ne trouve plus trace ou presque d’Héraclès dans ce qui reste de la frise :
(...) Coppi qualifia de présage le fait que lui qui était notre égal manquait et qu’il nous fallait donc nous faire nous-même une image de cet avocat de l’action.
Cette phrase contient toutes ces premières pages, le passé vient au présent de toute notre imagination. Elle contient aussi le livre entier, c’est ce qu’on entendra, j’espère, tout au long de cette lecture.
Au total près de 950 pages, trois volumes traduits par Éliane Kaufholz (Klincsieck) qui seront lus à raison d’une heure par semaine, sauf vacances scolaires ; on passera plus d’un an plongé(s) dans ce texte étonnant ; un essai d’entendre et comprendre le très long et très vieux rêve de vivre libres et humains.
Initiative soutenue d’enthousiasme par remue et par Cassandre / Horschamp.
Merci...
...à celles et ceux qui m’ont aidé pour l’organisation de ces lectures :
Valérie de SaintDo, Nicolas Roméas, Samuel Wahl, Olivier Perrot, Hélène de Grand Pré (Cassandre Horschamp) ;
Dominique Dussidour, François Bon, Philippe de Jonckheere, Julien Kirsch (remue.net) ;
Caroline Girard, pour les répétitions et Véronique Perrin aussi ;
Mirella Rosner, pour un rideau rouge ;
Mariette Barret (Le tunnel) ;
Benoît Artaud, pour les idées de son ;
Marion Druart, Annie Thi.
Outre remue et Horschamp, plusieurs sites relaient déjà l’information : Indymedia, passeurs, La mer gelée, Autres espaces
& les librairies
Buchladen, 3, rue Burq, 78018 Paris
Anima, 3, r Ravignan, 75018 Paris
Vendredi, 67, rue des Martyrs, 75009 Paris
Libralire, 116 rue Saint-Maur, 75011 Paris
Équipages, 64 rue de Bagnolet, 75020 Paris
Tschann, 125 bld du Montparnasse, 75006 Paris
Comme un roman, 27, Rue de Saintonge, 75003 Paris
Marissal Bücher, 42 rue Rambuteau, 75003 - Paris.
Tous les détails sont ici :