chronique n°7

Le roman prend une nouvelle orientation. De tous les personnages de l’intrigue initiale, ne reste plus que la figure centrale, celle de l’architecte qui conçoit et construit la maison.
Le lieu aussi a changé, d’imaginaire il est devenu réel, ou du moins il a rejoint un territoire véritable, une région qui existe, à l’est de Paris, aux confins de la Seine-et-Marne dans la plaine de la Bassée. Nous allons placer la maison dans le site pilote du projet d’espaces endigués (voir chronique précédente). Cet immense bassin bordé de digues se remplira d’eau, en période de crue de la Seine : il permettra de stocker 10 millions de mètres cubes d’eau. Pendant la phase de remplissage, à mesure que l’eau montera, la maison se détachera de sa fondation, se soulèvera du sol et flottera.
Notre projet (celui du roman) sera une très bonne manière de tester l’habitat insubmersible que nous concevons, qui se trouvera à dériver dans un espace clos, sans crainte d’être emporté par le flot.
Caroline, en proposant d’en faire la maison du gardien, m’a donné une idée. Il n’y aura pas de gardien pour ces casiers, c’est un dispositif qui ne nécessite pas de surveillance particulière. Mais il pourrait y avoir un occupant. Un naturaliste par exemple, qui travaillerait sur les zones humides. L’autre volet de l’ouvrage de rétention des crues est de restaurer l’écologie de la zone humide de la Bassée, qui a été détériorée par les usages et l’activité humaine.
Dans le cadre de cette mise en valeur écologique, la maison pourrait abriter un laboratoire-observatoire et un appartement. Notre maison, construite sur le site pilote, va devenir à la fois la maison du projet et une sorte de prototype expérimental de maison flottante. Tout est expérimental dans cette histoire ! Le roman, la retenue d’eau, le bâtiment...
Atelier du 17 décembre. Nous concevons aujourd’hui le laboratoire : c’est un espace de travail dédié au travail du chercheur. Il occupe tout l’étage de la maison. Au rez-de-chaussée viendra l’habitation, dont on s’occupera plus tard.
Quatre espaces sont définis à l’étage de la maison ronde : le premier dédié à la zoologie, le deuxième à la botanique, le troisième aux réserves (échantillons, prélèvements, etc.) et le quatrième au bureau.
J’ai en tête deux références : la première est la fonction de naturaliste incarnée par un homme comme Théodore Monod, que j’ai bien connu et qui disait lui-même qu’il était le dernier naturaliste.
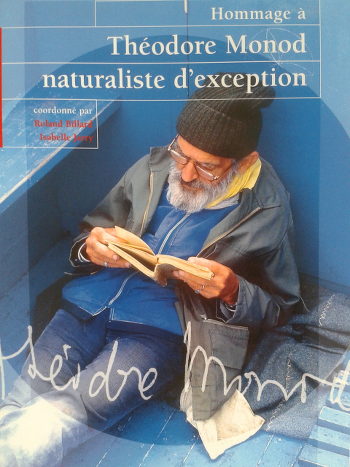
Qu’est-ce qu’un naturaliste ? C’est un savant qui s’intéresse à tous les domaines des sciences naturelles, on dit aujourd’hui sciences de la vie et de la terre.
Les naturalistes furent associés dès le XVIe siècle aux grandes expéditions dont l’objectif était de découvrir, inventorier et rapporter des échantillons de toutes les espèces animales, végétales et minérales rencontrées à travers le monde, les décrire, les classer, les étudier. Théodore Monod se considérait comme le dernier des naturalistes, d’une part parce qu’il avait été l’un des ultimes explorateurs à parcourir scientifiquement des terres inconnues (au Sahara), d’autre part parce qu’il avait vu, tout au long de sa carrière de chercheur, l’émergence de nouvelles disciplines (telles que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, l’informatique) qui supplantaient les sciences naturelles. Il pensait que la zoologie et la botanique, et en particulier la taxonomie et la systématique (ce qui permet de nommer et de classer les organismes vivants) allaient disparaître au profit de ces nouvelles sciences, fondées sur des outils techniques nouveaux et qui révolutionnaient toutes les disciplines des sciences du vivant.
Mais ce que Théodore n’avait pas anticipé, bien qu’il soit écologiste avant l’heure (il avait participé en 1922, à l’âge de 20 ans, à la création d’une société d’écologie), c’est que les disciplines chères à son cœur reviendraient en force à la faveur des préoccupations environnementales. À l’heure de la COP 21, les connaissances des naturalistes sont indispensables. Ils sont systématiquement associés à des missions scientifiques qui observent la biodiversité, les changements induits par la modification des écosystèmes, du réchauffement climatique, etc. On a besoin plus que jamais de faire des inventaires, de collecter les informations sur le terrain.
Non seulement les naturalistes professionnels sont revenus sur le devant de la scène dans les sciences de la vie, mais le public est associé à ces recherches et de très nombreux naturalistes amateurs participent à des programmes comme Vigie-Nature, qui s’appuie sur un grand nombre d’informateurs pour le comptage des papillons, des oiseaux des jardins, des bourdons, des escargots, etc. Les volontaires apprennent à reconnaître les espèces, à les compter, puis à entrer leurs observations dans une base de données. De la même manière, Vigie-Nature propose aux naturalistes confirmés de participer au suivi des populations de chauves-souris, de libellules, de plantes communes, etc. Le peintre Jean Dubuffet, dans ses lettres à Pierre Bettencourt, parle de manière extrêmement savoureuse et poétique de ses chasses aux papillons. On peut lire celles qu’il a envoyées à son ami entre 1949 et 1985 dans le recueil Poirer le papillon. C’est une lecture que je conseille à tout le monde. Nous ne manquerons pas de le mettre en bonne place dans la bibliothèque de notre maison flottante.
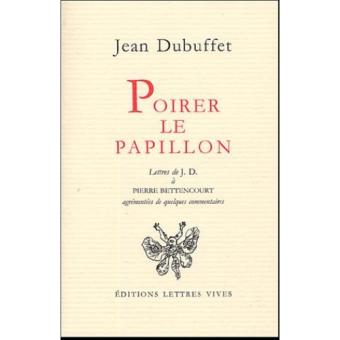
Théodore Monod, comme Jean Dubuffet, auraient été tout aussi surpris de voir l’importance qu’a prise aujourd’hui une activité qu’ils croyaient définitivement obsolète, perdue avec le siècle qui finissait. De nos jours, alors que de très nombreuses menaces pèsent sur la biodiversité, les naturalistes sont à nouveau les acteurs incontournables de toute réflexion sur la nature et les espèces vivantes.
Mon laboratoire « à l’ancienne » n’est donc pas une survivance du passé, mais bien une version moderne de la pratique scientifique, pour des naturalistes en quête de connaissances, récoltant les données sans lesquelles aucune étude de milieu n’est possible.
Ma deuxième référence de laboratoire est issue de mon séjour à la station de biologie marine de Roscoff, durant mes études, au début des années 80. Il suffisait de figurer parmi les premiers aux examens de botanique et de zoologie pour pouvoir accéder à l’unité de valeur (UV) du cursus de premier cycle de l’Université Paris 7.

Nous étions une vingtaine à séjourner à Roscoff et à y faire nos premiers pas en biologie marine : algologie, botanique des halophytes (plantes des milieux salins), ichtyologie, carcinologie, malacologie, etc. Nous arpentions la grève découverte par la marée, à la recherche de spécimens dont nous ignorions même l’existence, balanoglosses, annélides marins, cnidaires, échinodermes variés, coquillages, etc. Nous passions la matinée sur le bord de mer à faire des récoltes, sous la conduite de nos professeurs, et l’après-midi au laboratoire, dont les larges baies vitrées ouvraient sur la mer. Nous déposions nos trésors sur les paillasses carrelées de blanc, inondées de soleil les jours de beau temps.
Tout en classant nos algues et en les mettant à sécher entre des feuilles de journal, nous avions sous les yeux le vaste ciel changeant du bord de mer ; l’air du large entrait par les fenêtres ouvertes, notre stage prenait un air de vacances tardives.
Tout le petit peuple minuscule de la mer s’étalait sous nos yeux, multicolore, infiniment varié. On se baignait certains jours (on devait être en septembre, la température de l’eau était encore acceptable) et nous songions, tout en nous remuant dans les flots salés de l’Atlantique, aux millions de vies qui peuplaient l’océan, invisibles à nos yeux ignorants. Nous en avions prélevé une infinitésimale part, mais tout autour de nous cela foisonnait.

Deux ans plus tôt, l’Amoco Cadiz avait fait naufrage à 70 km à l’ouest, provoquant la pire marée noire de tous les temps (223 000 tonnes de pétrole répandues sur les plages bretonnes). Nous étions la première génération à prendre conscience de la vulnérabilité du milieu marin face à l’ampleur de telles pollutions.
Mais revenons à notre laboratoire... Notre maison est ronde et le laboratoire occupe tout l’étage supérieur : chaque pièce est donc en forme de quart de cercle. Les paillasses ou les tables de bureau sont installées le long de l’arrondi, vers l’extérieur, pour profiter de la lumière du jour qui entre par la paroi translucide, et pour occuper le côté « mansardé » de la pièce. On accède au labo depuis le rez-de-chaussée par un escalier central en colimaçon, qui débouche dans le bureau (nous avons préféré laisser entière la surface au sol des salles-laboratoires). Chaque pièce communique avec les autres par une porte située au milieu de ses cloisons latérales. La pièce dédiée aux archives, au stockage et aux réserves est garnie de placards le long de ses deux parties arrondies.
La superficie de chaque espace est d’environ 28m2, ce qui n’est pas mal. Mais je vous rappelle que le plafond n’est pas plat, notre maison a la forme d’une lentille, donc la hauteur sous plafond diminue lorsqu’on se rapproche de l’extérieur de la pièce.

Concevoir un laboratoire me conduit à penser à ce qui s’y fait. Quelle recherche conduit-on dans une zone humide ? Quelles expériences y pratique-t-on ? Des inventaires de faune et de flore, l’observation des habitats des oiseaux d’eau, de leurs déplacements, la manière dont les espèces réagissent à l’inondation, les modes de dissémination et de dispersion des espèces végétales, les équilibres écologiques entre les espèces, etc. etc. Des centaines de choses à faire.
Il suffit de se rendre sur le site du Muséum national d’Histoire naturelle pour remplir les journées de nos personnages. Et leurs nuits aussi, car les chauves-souris et les rapaces nocturnes s’observent à la nuit tombée.
Moi qui aime décrire la nature et la vie sauvage, je vais être comblée.
(à suivre...)