Jérémy Liron, une expérience du regard par Armand Dupuy
La dernière partie du livre est composée d’une série d’entretiens de Jérémy Liron.
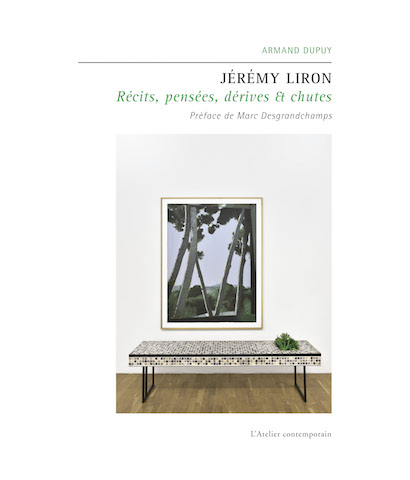
Armand Dupuy, Jérémy Liron et L’Atelier contemporain ont confié à remue.net un extrait de Jérémy Liron. Récits, pensées, dérives & chutes. On retrouve cet extrait aux pages 144-148. Merci à eux (SR).

Au pied des tableaux, à travers les tubes de couleurs pressés, les pots, les pinceaux, les barquettes, les assiettes cartonnées, les chiffons bleus roulés, tachés, traînent parfois des pages aux couleurs fanées, laissées négligemment dans la mêlée, montrant tel morceau d’architecture portant parfois giclures, coups de pinceaux, traces de semelles : même si ce peut être à partir d’images glanées dans les catalogues qu’il feuillette à l’atelier – « un jour un bouquin qui est là depuis des années, dit-il, tu l’attrapes, c’est le moment pour que tu en fasses quelque chose. » –, on sait que Liron monte souvent ses sujets à partir de ses propres photographies. L’appareil photographique est alors un objet de captation des matériaux, un outil de saisie des configurations qui ont interrompu l’oeil dans sa course, de certains arrangements de formes et de couleurs qui l’ont retenu. C’est une prise de note à la volée, à travers le pare-brise, parfois, ou le bras lancé par la portière, d’images qui pourront rester des mois, même des années, dans des dossiers avant d’être utilisées : « Je fais un paquet de photos, sur le moment, avec la vague idée que je vais en faire quelque chose mais parfois ça reste en plan des années, ça ne me dit plus rien. Parfois j’en ressors une qui me parle à nouveau mais autrement, il a fallu passer par d’autres choses pour que certaines potentialités se révèlent 88 ». Mais, parce que cette notation n’est jamais à même de restituer le mouvement du regard porté sur la chose, parce que cette dernière n’en est souvent plus qu’un aperçu décevant, vidé de ce qui l’avait requis, c’est d’abord en les manipulant sur Photoshop que Liron tâchait de trouver, de provoquer, d’explorer les potentialités de son matériau photographique. Il opérait ainsi les découpes, les torsions nécessaires, pour rapprocher l’objet non pas de ce qu’il était, mais de ce qu’il en avait vu. On peut observer des traces de ce genre d’opérations en étudiant attentivement le Paysage n° 63. Deux des traverses blanches du parapet de la terrasse de la Villa Noailles de Mallet-Stevens, à partir de laquelle s’élance le regard, ont été éliminées, laissant ainsi deux rubans d’arbres et de ciel disjoints sur le haut du paysage. Il ne s’agissait toutefois pas, je suppose, de gommer ces traverses et de donner l’illusion qu’elles ne furent jamais là, mais plutôt de tirer parti de leur disparition, de leur manque et d’insister sur la découpe qu’elles opéraient, pour architecturer un paysage neuf. Parce que si les traverses ne sont plus visibles, si les tronçons libérés ont été empilés les uns sur les autres sur la partie basse de l’image, leur imparfaite juxtaposition (les troncs, les feuillages ne coïncident pas tout à fait), la fine incision qui persiste à leur zone de contact, rendent le montage très sensible. Le tassement des bandes vers le bas laisse enfin apparaître, sur le haut du tableau, une marge noire, équivalente à l’épaisseur des deux traverses retranchées. Dans ce tableau, leur disparition n’est pas comblée, mais déplacée, mais reportée sur le haut du tableau, le noir matérialisant alors le manque d’image dans l’image, renforçant aussi la sensation de glissement des frondaisons et du ciel vers le bas.
J’avais rapproché cette pratique du montage à ce que faisait Philippe Cognée, il y a quelques années, en préparant ses tableaux [1]. S’il était également question, chez Cognée, d’explorations architecturales, ce dernier faisait usage, lui aussi, de la photographie pour monter ses sujets. On aurait dit qu’il lui fallait que le monde et l’objet perçus, convoités par l’oeil, subissent préalablement plusieurs transformations pour être véritablement saisis. Cela s’apparentait à une très lente digestion du motif. Cognée commençait par filmer, sous toutes les coutures, longuement, caméscope au poing, l’édifice auquel il souhaitait se confronter. De retour à l’atelier, en visionnant le film dans une sorte d’attention flottante, il mettait certaines images « à l’arrêt » en les photographiant directement sur l’écran de télévision. Quand les captures étaient développées (à titre d’exemple, 8 pellicules de 24 poses pour les trois tableaux du musée Guggenheim de Bilbao), il découpait méthodiquement chacune des photographies, isolait certains pans du bâti, puis les combinait par brassage en une nouvelle structure complexe et diffractée. Parce que chaque photographie extraite de son film semblait n’être qu’un résidu de mémoire insatisfaite, gardant trace de ce qui avait été filmé sans jamais rien montrer de l’édifice tel qu’il avait été vu, il fallait alors démanteler l’image, mettre en pièces l’objet dont elle avait charge, et le détruire. Parce que voir n’est pas simplement percevoir, n’est pas qu’une opération distraite du regard, ni même son contraire, une attention extrême : c’est un travail de remembrement, c’est un faire-monde.
Dès que l’un de ses assemblages abordait à quelque chose de sa perception, Cognée empoignait de nouveau l’appareil, photographiait la composition, éparpillait ses fragments, reprenait son travail d’agencement, de recherche, de patient montage. Photographiait de nouveau, recommençait inlassablement. L’effort de mise à distance par photographies successives, paradoxalement, était une tentative d’approche forcenée. Une série d’entraves dressées pour retrouver progressivement la vue perdue au moment même de la vue. Lorsque les possibilités semblaient épuisées, ou que le regard s’était épuisé lui-même dans les possibilités, Cognée n’avait plus qu’à choisir, parmi les nombreuses hypothèses, celles qui lui semblaient les plus justes. Les montages retenus étaient alors projetés sur les toiles de grands formats, les lignes des sujets grossièrement tracées au fusain. Cognée appliquait enfin l’encaustique dans les secteurs délimités, puis parachevait le travail au fer à repasser – opération quasi magique qui venait fondre et déformer les structures et leur donner leur tremblé caractéristique.
Comme si, une fois la perception approchée, il se trouvait contraint de la rendre à son flou, à son indétermination première, parce qu’elle en était originaire et qu’elle ne pouvait s’en trouver tout à fait détachée sans y perdre de sa véracité. Ce tremblé était sa justesse. Parce que nous ne cherchons pas l’exactitude dans les images, mais d’abord « notre sensation au monde [2] ». Il nous faut tout à la fois l’appréhender dans sa stabilité et sa fuite. C’est l’un des leitmotiv de Liron.
Aussi, sans doute ne peut-on pas prétendre avoir vu ce qu’on n’a pas préalablement détruit. Tant qu’il n’a pas été mis en pièces par l’image ou par la pensée, l’objet reste une surface imperméable, refusée, fermée sur le mystère qu’on pensait apercevoir derrière ses contours. Alors on démantèle, on cherche les rouages. On sait l’effet de ce travail maladif. On subit l’anesthésie consécutive, la perte du mystère – ce furent d’abord les jouets, puis les oiseaux – mais l’on n’a pas véritablement vu la chose si l’on n’a pas buté, en elle, sur notre impossibilité de la voir. Toutefois, détruire ne suffit pas. Il faut rassembler, relever les images, dire ou montrer ce qu’on a vu dans l’effondrement, noter le présage aperçu dans les tessons, les miettes éparpillées. Voir est toujours ce geste double de destruction et de reconstruction patiente. Un mélange de rage destructrice et de réparation. Les méthodes Cognée et Liron pourraient témoigner de ce processus.
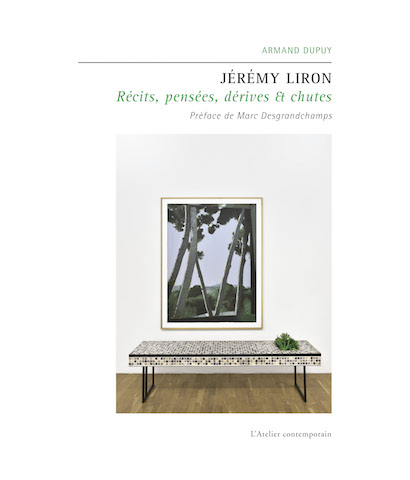
Sur remue.net, on peut également retrouver Jérémy Liron et Armand Dupuy.
Jérémy Liron. Récits, pensées, dérives & chutes d’Armand Dupuy à L’Atelier contemporain
[1] On peut se référer à l’ouvrage de Philippe Cognée et Olivier Weil, Bilbao, paru aux éditions joca seria, en 2003, qui présente l’élaboration des triptyques Bilbao et Beaubourg, livrant avec précision la méthode qu’utilisait alors Philippe Cognée pour ses réalisations.
[2] François Bon, Philippe Cognée, portrait de peintre-volcan, Somogy, 2014.