Ma solitude s’appelle Brando de Arno Bertina

On ne devrait pas lire les quatrièmes de couverture.
On le sait mais quoi, répétons : n’oublions pas de nous abstenir de retourner l’objet pour lire la quatrième (ce qui épongera ça de nervosité curieuse en moins ; ce qui nous épargnera de voir l’étiquette de prix, et ainsi nous fera dépenser sans compter, sauver la librairie indépendante, finir ruiné mais : heureux).
Pas lire la glose synoptique ajoutée au dos, donc.
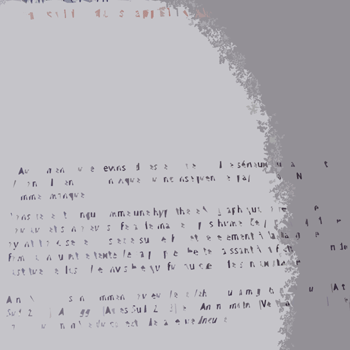
Non qu’il y ait dans le texte une pureté absolue, à ne pas déflorer surtout, le texte tel qu’on le découvre on le sait est déjà maculé de nos représentations, ne serait-ce que des raisons objectives (connaissance de l’œuvre, de l’éditeur) et subjectives qui nous ont fait aller vers (séduction de l’objet-livre, ou titre intrigant, comme « Ma solitude s’appelle Brando »). Mais la quatrième de couv, aussi professionnelle soit-elle (voire, le plus professionnelle soit-elle), nous dessert, lecteur, quand elle sert le texte.
Face à ce court roman, cette novella d’Arno Bertina, je n’ai lu la quatrième qu’une fois le livre fermé , m’en félicite, et vous conseille de faire de même.
Contentez-vous d’hypothèse biographique, le genre annoncé en exergue, hypothèse biographique qui ouvre et ne résoud rien.
Le livre nous plonge dans une biographie familiale ouverte, allègre traversée d’un siècle écoulé, un siècle compliqué :
« Mais avant cet engagement il y a le départ pour l’Afrique, et avant le départ pour l’Afrique il y a les vingt ans qui les trouvent, garçons et filles, avalant deux cent kilomètres à vélo dans la journée, en direction de Dax ou de Brive, à bouffer le paysage par tous les bouts, sur des routes si dures que même les gros boyaux d’alors s’y déchiraient et ça n’était même pas une péripétie – d’autres tourneraient casaque parce que c’est assez à raconter, déjà, mais ils ne mangent pas de ce pain-là. Il y a en eux un appétit capable d’inventer un corps à sa mesure. »
Le livre court à cette allure, tourne les sens (au propre et au figuré). Un des intérêts de cette vitesse (ou sensation de vitesse) produite par le texte, ramifié de digressions qui n’en sont pas mais sont des développements nouveaux de l’affaire (l’affaire-récit, l’affaire-texte), c’est non pas de nous tenir en haleine (si intrigue ou mystère il y a, ils ne seront pas résolus), mais de nous tenir en éveil, de fournir en éveil le lecteur en nous, de fournir en éveils les lecteurs en nous, de nourrir notre multiplicité. Les registres sont traversés, ouverts, hop
« (…)(Cette anecdote ne sous-entend pas que tous les officiers allemands étaient élégants.)
Des allemands qui assistèrent à son mariage quatre ans plus tard, depuis les fenêtres de la Kommandantur. Le 6 juin 1944 – on ne peut être plus sourd au grondement de l’Histoire. Mais pas un des frères : Henri avait obtenu un congé exceptionnel mais la nouvelle du débarquement était parvenu jusqu’en Gironde et il était reparti sur son vélo, tout fonctionnaire devant être à son poste en cas d’agression du territoire – il aura donc servi l’Etat Français plus longtemps que son chef, qui était en Allemagne avec Laval, Céline et quelques autres dès le 20 août. »
Hop on est déjà ailleurs, trois fois ailleurs au moins en six lignes, et minuscule et majuscule histoires se causent et se font signe ; le goût du commentaire, de la glose divagant n’est jamais muselé, empêché, corseté, mais l’appétit, le goût de vivre en somme, porte l’esprit ailleurs, à la vitesse où l’on pense : re-contexte historique parce que non plus ça ne s’arrête jamais tout ça, la grande Histoire broyeuse, et c’est ça qui entraîne les individus dont les destins ajoutés font la pierre.
Et de ne pas savoir où l’on est, si c’est fiction familiale trafiquée ou fiction familiale inventée, tant le statut du narrateur omniprésent sinue malicieux dans les pages, plus loin plus proche, à la malicieuse façon dont Échenoz, par exemple, mène sa focale biographique dans « Courir » ; et cette malice nous est complice, se et nous questionne (et s’en contente, encore, ne nous assène pas de conclusions légistes sur ses personnages) :
« Il retrouva sa femme à Alger, ou en France, et eu de temps après l’Armistice ils partirent pour Bamako où il restera longtemps en poste. C’est du Mali, d’ailleurs, qu’ils écriront pour annoncer l’adoption d’une orpheline, deux ou trois années plus tard. Il faut imaginer le silence de sa mère, la liste des non-dits qui s’allongeait, des reproches qu’on ne ferait pas. Mathilde hasarda une remarque grinçante devant sa mère (pourquoi adopter quand on envoie son fils, déjà, se faire éduquer ailleurs, par d’autres ?) en sachant pertinemment qu’elle ne lui dirait rien, à lui. Les deux femmes ont-elles au moins soupçonné quelque chose ? Sans doute pas, pas alors. »
Alors pour respecter ce pacte d’irrésolution décidée, et se laisser emporter puis surprendre, ne dévoiler aucun pot-aux-roses (et ne pas lire la quatrième), vous garantir que ce court livre se déplie au-delà des dimensions initiales (quelque 92 pages), que Marlon Brando y passe et porte sa part d’ombre-solitude, que les trouvailles sont en nombre et le récit, les récits, hypothétiques et constitués, en rester à cette belle phrase :
« mais j’ai besoin de penser que la vérité a deux visages quand elle n’en a pas trois, je m’arrête au bord d’en dire trop. »
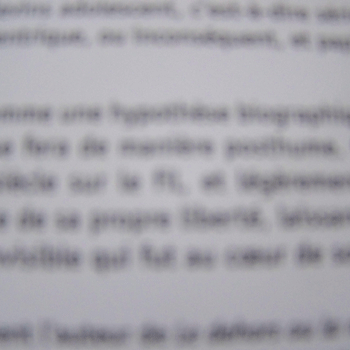
Ma solitude s’appelle Brando est publié chez Verticales, dont, faut-il le préciser,le travail éditorial est à saluer (et ceci même lorsqu’on se permet, pour raisons suscitées, de sauter le paratexte en couverture). Arno Bertina a publié plusieurs romans, chez Actes sud, Verticales, et a participé récemment à l’ouvrage collectif « Il me sera difficile de venir te voir »