« et j’ai vu que c’était un roman », Dominique Dussidour
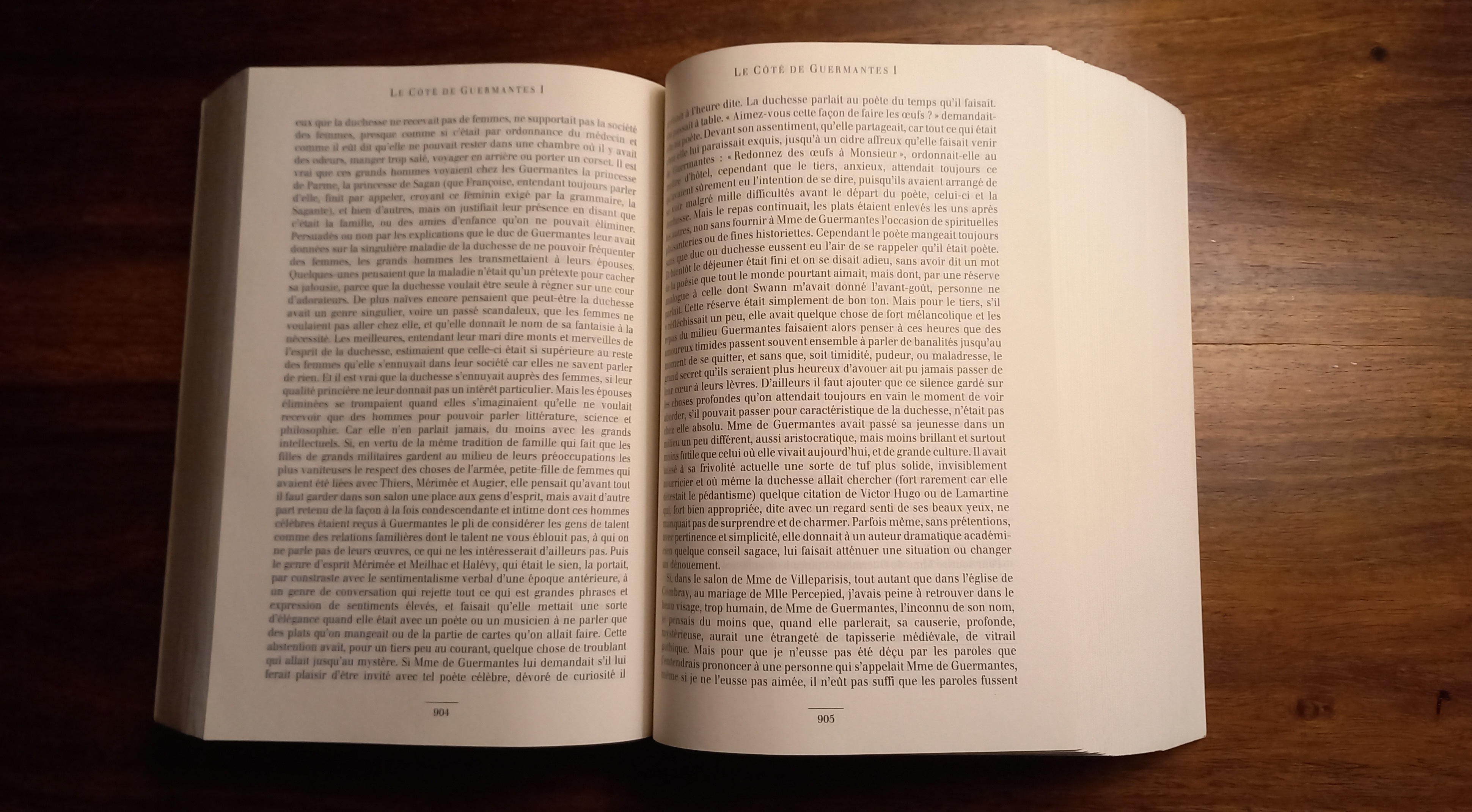
Dernier livre paru : S.L.E. Récits d’Algérie.
Dominique Dussidour sur remue.
 Une forme narrative s’est emparée du premier texte long que j’ai écrit. J’avais fait des études de philosophie et j’étais en lutte contre le verbe « être ». J’ai voulu le mettre à l’épreuve d’un discours non philosophique et observer ses variations d’intensité selon l’attribut dont il pouvait être suivi dans la structure grammaticale sujet/verbe être/attribut. J’ai choisi de le formuler ainsi : prénom masculin + verbe être + attribut. Par exemple : « A. est maçon », « B. est blond », « C. est triste ». J’ai écrit vingt-six séquences selon cette structure, une par lettre en suivant l’ordre alphabétique. Du fait que toutes ces séquences étaient racontées par une narratrice unique s’exprimant à la première personne, une forme générale est venue se superposer à la structure grammaticale et a relié les séquences, faisant passer le texte de l’énumération à la narration. Je ne m’en suis rendu compte qu’après, j’ai relu l’ensemble et j’ai vu que c’était un roman, Portrait de l’artiste en jeune femme.
Une forme narrative s’est emparée du premier texte long que j’ai écrit. J’avais fait des études de philosophie et j’étais en lutte contre le verbe « être ». J’ai voulu le mettre à l’épreuve d’un discours non philosophique et observer ses variations d’intensité selon l’attribut dont il pouvait être suivi dans la structure grammaticale sujet/verbe être/attribut. J’ai choisi de le formuler ainsi : prénom masculin + verbe être + attribut. Par exemple : « A. est maçon », « B. est blond », « C. est triste ». J’ai écrit vingt-six séquences selon cette structure, une par lettre en suivant l’ordre alphabétique. Du fait que toutes ces séquences étaient racontées par une narratrice unique s’exprimant à la première personne, une forme générale est venue se superposer à la structure grammaticale et a relié les séquences, faisant passer le texte de l’énumération à la narration. Je ne m’en suis rendu compte qu’après, j’ai relu l’ensemble et j’ai vu que c’était un roman, Portrait de l’artiste en jeune femme. Un roman se présente quelquefois d’une tout autre façon : quand un texte brut prend de court la narration. Sans avoir le projet précis d’un deuxième roman, j’ai écrit la première version des Mots de l’amour d’un seul jet, une précipitation de mots et de phrases qui se sont rassemblés sur le papier en quelques jours. Hésitant entre la curiosité et le rejet, je l’ai laissé de côté un bon moment. Et maintenant que faire ? Le texte m’apparaissait incompréhensible. Je suis partie à la recherche d’une histoire. Je suppose aujourd’hui qu’il y en avait plusieurs possibles, à l’époque j’ai seulement cherché à démêler ce qui était de l’ordre du dialogue, de la narration, de la description, à construire une histoire. Cette précipitation s’est renouvelée pour les monologues qui composent le chapitre III du Risque de l’histoire, « Détruire. Les soldats ». Dix voix inconnues ont pris la parole tour à tour, mon travail a été de déterminer à qui appartenaient ces voix, qui racontait quoi et à qui.
Un roman se présente quelquefois d’une tout autre façon : quand un texte brut prend de court la narration. Sans avoir le projet précis d’un deuxième roman, j’ai écrit la première version des Mots de l’amour d’un seul jet, une précipitation de mots et de phrases qui se sont rassemblés sur le papier en quelques jours. Hésitant entre la curiosité et le rejet, je l’ai laissé de côté un bon moment. Et maintenant que faire ? Le texte m’apparaissait incompréhensible. Je suis partie à la recherche d’une histoire. Je suppose aujourd’hui qu’il y en avait plusieurs possibles, à l’époque j’ai seulement cherché à démêler ce qui était de l’ordre du dialogue, de la narration, de la description, à construire une histoire. Cette précipitation s’est renouvelée pour les monologues qui composent le chapitre III du Risque de l’histoire, « Détruire. Les soldats ». Dix voix inconnues ont pris la parole tour à tour, mon travail a été de déterminer à qui appartenaient ces voix, qui racontait quoi et à qui.  En tant que lectrice j’attends du roman qu’il me fasse partager une perception et une vision d’un monde que je n’imaginais pas. Un bon roman c’est aussi un roman qui me donne l’impression d’avoir rencontré - plutôt que l’écrivain qui l’a écrit - tel ou tel de ses personnages : la Duclos dans Les Cent Vingt Journées de Sade, Darryl Louise dans Vineland de Thomas Pynchon… Les personnages féminins de Duras - par exemple Maria dans Dix heures et demie du soir en été -, il m’a semblé les reconnaître a posteriori, comme si je les avais toujours connus, avant même d’avoir lu ses romans. Réciproquement, j’ai quelquefois croisé dans la rue certains personnages de mes romans après que je les avais écrits.
En tant que lectrice j’attends du roman qu’il me fasse partager une perception et une vision d’un monde que je n’imaginais pas. Un bon roman c’est aussi un roman qui me donne l’impression d’avoir rencontré - plutôt que l’écrivain qui l’a écrit - tel ou tel de ses personnages : la Duclos dans Les Cent Vingt Journées de Sade, Darryl Louise dans Vineland de Thomas Pynchon… Les personnages féminins de Duras - par exemple Maria dans Dix heures et demie du soir en été -, il m’a semblé les reconnaître a posteriori, comme si je les avais toujours connus, avant même d’avoir lu ses romans. Réciproquement, j’ai quelquefois croisé dans la rue certains personnages de mes romans après que je les avais écrits. En tant qu’auteur je ne demande rien à un roman. Des mots, une phrase, une situation, une image commencent à se répéter de façon insistante, obsédante, hors de tout projet défini, à s’élever de la réalité comme des signaux de fumée envoyés par un monde inconnu et lointain. Je ne sais pas les déchiffrer, je ne sais pas ce qu’ils signifient, ce qu’ils désignent. Une seule façon de le savoir : suivre la piste, me diriger là-bas, dans la direction des signaux. Par exemple, mettre ces mots en diverses situations de langage ; récrire une phrase un nombre infini de fois jusqu’à ce qu’une deuxième phrase prenne la suite ; décrire une situation, une image, en varier les éléments, les retourner, voir ce qu’il y a autour, derrière… Quand j’écris nous travaillons en collaboration, le roman et moi. Et je me mets à l’écoute jusqu’à ce que j’entende la langue dans lequelle il se formule et comprenne de quelle façon la faire entendre.
En tant qu’auteur je ne demande rien à un roman. Des mots, une phrase, une situation, une image commencent à se répéter de façon insistante, obsédante, hors de tout projet défini, à s’élever de la réalité comme des signaux de fumée envoyés par un monde inconnu et lointain. Je ne sais pas les déchiffrer, je ne sais pas ce qu’ils signifient, ce qu’ils désignent. Une seule façon de le savoir : suivre la piste, me diriger là-bas, dans la direction des signaux. Par exemple, mettre ces mots en diverses situations de langage ; récrire une phrase un nombre infini de fois jusqu’à ce qu’une deuxième phrase prenne la suite ; décrire une situation, une image, en varier les éléments, les retourner, voir ce qu’il y a autour, derrière… Quand j’écris nous travaillons en collaboration, le roman et moi. Et je me mets à l’écoute jusqu’à ce que j’entende la langue dans lequelle il se formule et comprenne de quelle façon la faire entendre. L’expérience et le plaisir romanesques ont coloré chacun des textes que j’ai écrits et qui ne sont pas des romans, que ce soit des récits de source autobiographique comme Les Matins bleus et S.L.E. Récits d’Algérie, l’essai biographique que j’ai consacré au peintre Edvard Munch ou même le « chantier » que j’ai entrepris sur les romans de Sade. Ça veut dire quoi ? Que tout à coup le texte échappe au registre qui est à l’œuvre, prend la conduite du récit et avance soudain, en pleine phrase, le temps d’une page ou d’un chapitre, dans une direction que je n’avais pas imaginée. C’est arrivé dans S.L.E. Récits d’Algérie alors que je faisais le portrait d’un oncle qui avait été contrôleur des chemins de fer pendant la colonisation. Sans doute s’ennuyait-il à exercer à nouveau cette profession dans le récit alors qu’il l’avait déjà exercée toute sa vie dans la réalité, alors il a sauté dans la locomotive et a pris l’initiative de conduire le train jusqu’à Rome… Le récit lui a ouvert une possibilité d’existence que je n’avais pas envisagée.
L’expérience et le plaisir romanesques ont coloré chacun des textes que j’ai écrits et qui ne sont pas des romans, que ce soit des récits de source autobiographique comme Les Matins bleus et S.L.E. Récits d’Algérie, l’essai biographique que j’ai consacré au peintre Edvard Munch ou même le « chantier » que j’ai entrepris sur les romans de Sade. Ça veut dire quoi ? Que tout à coup le texte échappe au registre qui est à l’œuvre, prend la conduite du récit et avance soudain, en pleine phrase, le temps d’une page ou d’un chapitre, dans une direction que je n’avais pas imaginée. C’est arrivé dans S.L.E. Récits d’Algérie alors que je faisais le portrait d’un oncle qui avait été contrôleur des chemins de fer pendant la colonisation. Sans doute s’ennuyait-il à exercer à nouveau cette profession dans le récit alors qu’il l’avait déjà exercée toute sa vie dans la réalité, alors il a sauté dans la locomotive et a pris l’initiative de conduire le train jusqu’à Rome… Le récit lui a ouvert une possibilité d’existence que je n’avais pas envisagée. L’inverse ne s’est cependant jamais produit, je n’ai pas l’expérience d’un roman qui aurait eu le mouvement de devenir un récit. Je peux avoir le projet d’écrire un récit mais je ne peux pas vouloir écrire un roman, cette intention briderait le texte, le dirigerait, l’empêcherait de se construire librement.
L’inverse ne s’est cependant jamais produit, je n’ai pas l’expérience d’un roman qui aurait eu le mouvement de devenir un récit. Je peux avoir le projet d’écrire un récit mais je ne peux pas vouloir écrire un roman, cette intention briderait le texte, le dirigerait, l’empêcherait de se construire librement. Quel que soit le texte que j’écris, au début je me mets en position d’écoute, à la fois très passive et très attentive. J’interviens très peu. Peu à peu des matériaux – des mots, des phrases, un certain rythme – apparaissent et se fixent, sans ordre et sans intention. D’eux-mêmes, ils se renforcent et s’agglomèrent, ou s’effacent et disparaissent. La suite du travail consiste à former des séquences et à les organiser entre elles. La première séquence écrite est rarement celle par quoi commencera le texte définitif. Définir la succession des séquences et en déduire le cadre général est une étape importante, ainsi que, ensuite, le découpage en chapitres et en paragraphes. Quand je commence à percevoir une histoire possible dans le cas d’un roman, un déroulement possible dans le cas d’un récit – quitte à ne conserver finalement ni cette histoire ni ce déroulement -, je peux aller dans le sens de ce qui se formule. Longtemps j’ignore, avant de l’avoir écrit, où, quand et comment le roman ou le récit prendront fin. Mais s’ils finissent c’est bien qu’ils ont commencé, que le temps et le travail les ont traversés…
Quel que soit le texte que j’écris, au début je me mets en position d’écoute, à la fois très passive et très attentive. J’interviens très peu. Peu à peu des matériaux – des mots, des phrases, un certain rythme – apparaissent et se fixent, sans ordre et sans intention. D’eux-mêmes, ils se renforcent et s’agglomèrent, ou s’effacent et disparaissent. La suite du travail consiste à former des séquences et à les organiser entre elles. La première séquence écrite est rarement celle par quoi commencera le texte définitif. Définir la succession des séquences et en déduire le cadre général est une étape importante, ainsi que, ensuite, le découpage en chapitres et en paragraphes. Quand je commence à percevoir une histoire possible dans le cas d’un roman, un déroulement possible dans le cas d’un récit – quitte à ne conserver finalement ni cette histoire ni ce déroulement -, je peux aller dans le sens de ce qui se formule. Longtemps j’ignore, avant de l’avoir écrit, où, quand et comment le roman ou le récit prendront fin. Mais s’ils finissent c’est bien qu’ils ont commencé, que le temps et le travail les ont traversés…  Renoncer au roman serait renoncer à créer le monde, à donner une nouvelle version de son histoire, que cette histoire appartienne au présent, au passé ou au futur, qu’elle soit globale ou ne concerne qu’un fait apparemment mineur. La forme romanesque a tous les registres du langage à sa disposition, qu’on pense aux Slogans de Maria Soudaïeva traduits par Antoine Volodine ou aux créations consonantiques de Pierre Guyotat. Elle explore le domaine en partie commun des possibles et des impossibles, des univers réels, rêvés, imaginaires, de toutes les histoires réelles aussi bien que potentielles incluses à une certaine époque. On peut raconter une histoire qui se déroule dans un passé éloigné ou disparu, on ne peut pas l’écrire à une autre époque qu’au présent où nous vivons. Le fait d’écrire est nécessairement au présent. Même la recréation du passé, aussi documentée soit-elle, est au présent.
Renoncer au roman serait renoncer à créer le monde, à donner une nouvelle version de son histoire, que cette histoire appartienne au présent, au passé ou au futur, qu’elle soit globale ou ne concerne qu’un fait apparemment mineur. La forme romanesque a tous les registres du langage à sa disposition, qu’on pense aux Slogans de Maria Soudaïeva traduits par Antoine Volodine ou aux créations consonantiques de Pierre Guyotat. Elle explore le domaine en partie commun des possibles et des impossibles, des univers réels, rêvés, imaginaires, de toutes les histoires réelles aussi bien que potentielles incluses à une certaine époque. On peut raconter une histoire qui se déroule dans un passé éloigné ou disparu, on ne peut pas l’écrire à une autre époque qu’au présent où nous vivons. Le fait d’écrire est nécessairement au présent. Même la recréation du passé, aussi documentée soit-elle, est au présent. Il en va autrement de notre relation à l’espace. Le XXe siècle et maintenant le XXIe siècle ne cessent d’élargir l’espace dans lequel nous vivons. Dans la même journée on discute avec le serveur d’un café, le vendeur d’un kiosque à journaux, puis on ouvre le journal et on apprend ce qui se passe sur une île des Canaries, en Ukraine, dans la forêt amazonienne… on a des échanges avec des amis qui vivent en Grande-Bretagne ou au Caire, avec d’autres qui reviennent de Berlin, de Tanger, de Santiago du Chili… Comment recueillir ces entrelacements, ces circulations ? Comment considérer à la fois le monde dans sa globalité et la voix d’un individu placé ici ou là sans perdre ni l’un ni l’autre ?
Il en va autrement de notre relation à l’espace. Le XXe siècle et maintenant le XXIe siècle ne cessent d’élargir l’espace dans lequel nous vivons. Dans la même journée on discute avec le serveur d’un café, le vendeur d’un kiosque à journaux, puis on ouvre le journal et on apprend ce qui se passe sur une île des Canaries, en Ukraine, dans la forêt amazonienne… on a des échanges avec des amis qui vivent en Grande-Bretagne ou au Caire, avec d’autres qui reviennent de Berlin, de Tanger, de Santiago du Chili… Comment recueillir ces entrelacements, ces circulations ? Comment considérer à la fois le monde dans sa globalité et la voix d’un individu placé ici ou là sans perdre ni l’un ni l’autre ? Le roman va et vient sur une échelle à la fois géographique et historique, qui inclut la réalité plus ou moins commune à tous et la possibilité qu’il en soit tout autrement. Il organise, à chaque fois, une relation (au sens de « récit ») du monde et un regard singulier, il donne langage à cette rencontre, ou ce choc, entre eux. De ce point de vue, la forme romanesque ne peut être dépassée. Elle est protéiforme, elle s’adapte, se transforme. Comme chacun de nous. Le roman et nous, humains par le langage, avons ceci en commun : être des formes historiques à la fois totalement vouées au temps et totalement provisoires.
Le roman va et vient sur une échelle à la fois géographique et historique, qui inclut la réalité plus ou moins commune à tous et la possibilité qu’il en soit tout autrement. Il organise, à chaque fois, une relation (au sens de « récit ») du monde et un regard singulier, il donne langage à cette rencontre, ou ce choc, entre eux. De ce point de vue, la forme romanesque ne peut être dépassée. Elle est protéiforme, elle s’adapte, se transforme. Comme chacun de nous. Le roman et nous, humains par le langage, avons ceci en commun : être des formes historiques à la fois totalement vouées au temps et totalement provisoires.  Le livre que j’écris se nourrit d’abord de la documentation dont il a éventuellement besoin, ensuite plutôt de ce qu’il n’est pas. Par exemple de récits si c’est un roman, de romans si c’est un récit. Mais il se nourrit aussi, et d’abord, de ce que je vois, entends, surprends, comprends ou ne comprends pas – de ce que je ne comprends pas davantage que de ce que je comprends.
Le livre que j’écris se nourrit d’abord de la documentation dont il a éventuellement besoin, ensuite plutôt de ce qu’il n’est pas. Par exemple de récits si c’est un roman, de romans si c’est un récit. Mais il se nourrit aussi, et d’abord, de ce que je vois, entends, surprends, comprends ou ne comprends pas – de ce que je ne comprends pas davantage que de ce que je comprends.D.D.
25 février 2014