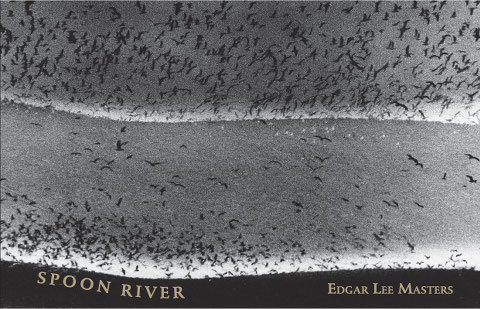Pauline Barrett & Époux
86 Pauline Barrett [Edgar Lee Masters, traduction Général Instin]
Presque une larve de femme après le bistouri !
Et presque une année pour recouvrer mes forces,
jusqu’à l’aube de nos dix ans de mariage
où j’ai retrouvé un peu de mon apparence.
Ensemble nous avons marché dans la forêt
sur un sentier silencieux de mousse et d’herbe.
Mais je ne pouvais te regarder dans les yeux 86b
comme tu ne pouvais me regarder dans les yeux
car notre douleur était telle — le gris dans tes cheveux
et moi, juste une larve de moi-même.
De quoi avons-nous parlé ? — du ciel et de l’eau,
de tout et de rien pour dissimuler nos pensées.
Puis ton offrande de roses sauvages,
placées sur la table en hommage à notre dîner.
Pauvre âme, comme tu luttais courageusement
pour faire revivre le bonheur passé !
Alors le désespoir m’a prise à la tombée de la nuit,
et tu m’as laissée seule dans la chambre un instant,
comme lorsque nous étions jeunes mariés, pauvre âme.
J’ai regardé le miroir et quelque chose a dit :
« Mieux vaut être mort entier que mort à moitié —
ne pas dénigrer la vie, ne pas tromper l’amour. »
Et je l’ai fait en regardant le miroir —
chère âme, as-tu jamais compris ?
86b Époux Barrett [Laurence Werner David]
 Depuis que je suis en âge d’aider les adultes aux travaux de la ferme, j’entends derrière une cloison un couple qui chuchote.
Depuis que je suis en âge d’aider les adultes aux travaux de la ferme, j’entends derrière une cloison un couple qui chuchote.  Certaines nuits d’insomnies je quitte la maison et m’isole dans la forêt qui entoure la ferme.
Certaines nuits d’insomnies je quitte la maison et m’isole dans la forêt qui entoure la ferme.  J’écarte les feuilles giflées par la pluie, je repousse les branches et marche sur les grosses racines luisantes.
J’écarte les feuilles giflées par la pluie, je repousse les branches et marche sur les grosses racines luisantes.  Je débusque la lumière verte, presque noire, dans ce lieu absent de chants d’oiseaux. Les sentiers sont tellement enchevêtrés que même les passages que je connais et que j’escalade depuis mon enfance deviennent incertains.
Je débusque la lumière verte, presque noire, dans ce lieu absent de chants d’oiseaux. Les sentiers sont tellement enchevêtrés que même les passages que je connais et que j’escalade depuis mon enfance deviennent incertains.  Je suis au pied de la masse arborescente.
Je suis au pied de la masse arborescente.  Je ne vois plus la ferme. Physiquement je pourrais encore la deviner mais ce n’est plus la nôtre.
Je ne vois plus la ferme. Physiquement je pourrais encore la deviner mais ce n’est plus la nôtre.  Les voix continuent à bourdonner.
Les voix continuent à bourdonner.  Elles se préparent à fuir, je le sais.
Elles se préparent à fuir, je le sais.  Une nuit, l’homme dit nettement : « On peut continuer à aimer et avoir perdu confiance en l’Autre. » À chaque fois que je rapporte à ma jeune fiancée les propos de l’homme ou de la femme, son rire rend ma mémoire informe, mes oreilles étourdies et froides.
Une nuit, l’homme dit nettement : « On peut continuer à aimer et avoir perdu confiance en l’Autre. » À chaque fois que je rapporte à ma jeune fiancée les propos de l’homme ou de la femme, son rire rend ma mémoire informe, mes oreilles étourdies et froides.  J’attends que ma fiancée apparaisse sous la voûte de l’entrée. 86
J’attends que ma fiancée apparaisse sous la voûte de l’entrée. 86  Elle passe et s’efface du côté des établis comme un éclair, l’air plus léger quand, parfois, elle me voit.
Elle passe et s’efface du côté des établis comme un éclair, l’air plus léger quand, parfois, elle me voit.  Je ne suis pas sûre de connaître quoi que ce soit d’une fille ni de pouvoir en pénétrer un seul secret.
Je ne suis pas sûre de connaître quoi que ce soit d’une fille ni de pouvoir en pénétrer un seul secret.  Le dimanche le soleil tombe dans la forêt. Une joie excessive m’envahit.
Le dimanche le soleil tombe dans la forêt. Une joie excessive m’envahit.  Nos échanges concrets me plaisent.
Nos échanges concrets me plaisent. Elle aime dessiner sur le papier des volatiles de plus en plus nombreux comme de petits faucons violemment dispersés au centre du ciel. La laine de sa manche se déplace par bref à-coups sur le papier glacé. Ma paralysie gagne ma nuque. « C’est un projet d’enseigne pour une petite entreprise de la ville », me dit-elle. Elle a quinze ans. Elle ôte son manteau. Nos bras se frôlent. Le beige et le noir de nos vêtements s’attirent, puis s’éloignent. Un instant ses doigts s’interrompent d’écrire sur le papier. Je tombe dans un gouffre dont la chaleur originelle deviendra un jour l’énigme de ténèbres puissantes. Pour l’instant le bout de ses doigts flirte avec ma peau intacte et je veux que ce soit encore plus profondément qu’ils chevillent tout mon corps, s’y enfouissent.
Elle aime dessiner sur le papier des volatiles de plus en plus nombreux comme de petits faucons violemment dispersés au centre du ciel. La laine de sa manche se déplace par bref à-coups sur le papier glacé. Ma paralysie gagne ma nuque. « C’est un projet d’enseigne pour une petite entreprise de la ville », me dit-elle. Elle a quinze ans. Elle ôte son manteau. Nos bras se frôlent. Le beige et le noir de nos vêtements s’attirent, puis s’éloignent. Un instant ses doigts s’interrompent d’écrire sur le papier. Je tombe dans un gouffre dont la chaleur originelle deviendra un jour l’énigme de ténèbres puissantes. Pour l’instant le bout de ses doigts flirte avec ma peau intacte et je veux que ce soit encore plus profondément qu’ils chevillent tout mon corps, s’y enfouissent.
 Les semaines qui suivent, quand je quitte la ferme, je n’entends plus aucune voix bruire derrière les murs de notre bâtisse--- Des voix ?
Les semaines qui suivent, quand je quitte la ferme, je n’entends plus aucune voix bruire derrière les murs de notre bâtisse--- Des voix ?
 Oui.
Oui.
 D’abord celle de Mère ; puis, qui lui fait écho, celle de son nouvel amant.
D’abord celle de Mère ; puis, qui lui fait écho, celle de son nouvel amant.
 Les odeurs, les rituels, mes rêveries d’enfant solitaire, les retours le soir de Mère dans notre ferme, les sensations que j’ai gagnées dans ma petite retraite organisée s’effacent à mesure que Pauline habite notre ferme.
Les odeurs, les rituels, mes rêveries d’enfant solitaire, les retours le soir de Mère dans notre ferme, les sensations que j’ai gagnées dans ma petite retraite organisée s’effacent à mesure que Pauline habite notre ferme.
 Ma fiancée cherche la clarté des rayons du soleil, les champs ouverts, l’odeur de ce qui est sec, les envols impatients et circulaires des oiseaux. Nous courons vers les berges. Nous tombons dans l’abîme d’un buisson pour y ôter nos tee-shirts, détacher nos ceintures ; nos hanches et nos dos chavirent contre la terre lézardée d’un magnifique après-midi. Ces petits abris dérobés sont le but d’un élan qui ne cesse plus.
Ma fiancée cherche la clarté des rayons du soleil, les champs ouverts, l’odeur de ce qui est sec, les envols impatients et circulaires des oiseaux. Nous courons vers les berges. Nous tombons dans l’abîme d’un buisson pour y ôter nos tee-shirts, détacher nos ceintures ; nos hanches et nos dos chavirent contre la terre lézardée d’un magnifique après-midi. Ces petits abris dérobés sont le but d’un élan qui ne cesse plus.
 Excepté dans l’amour, excepté quand elle parle, Pauline est une jeune fille pressée. Pressé de vieillir, de connaître des villes étrangères, de posséder un métier.
Excepté dans l’amour, excepté quand elle parle, Pauline est une jeune fille pressée. Pressé de vieillir, de connaître des villes étrangères, de posséder un métier.
 Nous rôdons aux abords de la forêt, rarement au cœur de la ferme.
Nous rôdons aux abords de la forêt, rarement au cœur de la ferme.
 Elle se livre peu. Son visage, la sensation de la chaleur dans nos cheveux mêlés, les odeurs d’herbes, de terre des champs après la pluie dense et brève : rien d’autre.
Elle se livre peu. Son visage, la sensation de la chaleur dans nos cheveux mêlés, les odeurs d’herbes, de terre des champs après la pluie dense et brève : rien d’autre.
 Chaleur et clarté se dissolvent.
Chaleur et clarté se dissolvent.
 J’ai peur que la forêt et la ferme se replient dans un même souvenir opaque.
J’ai peur que la forêt et la ferme se replient dans un même souvenir opaque.
 Quand je m’engouffre dans l’allée forestière, une tristesse pénètre dans ma poitrine, la certitude que je risque l’évanouissement en atteignant, seul, la ferme. Je froisse l’intérieur de ma chemise pour qu’un peu d’odeur de ma fiancée persiste.
Quand je m’engouffre dans l’allée forestière, une tristesse pénètre dans ma poitrine, la certitude que je risque l’évanouissement en atteignant, seul, la ferme. Je froisse l’intérieur de ma chemise pour qu’un peu d’odeur de ma fiancée persiste.
 Ma clé résiste à entrer dans la serrure. Je gravite longtemps autour de la porte d’accès à notre ferme.
Ma clé résiste à entrer dans la serrure. Je gravite longtemps autour de la porte d’accès à notre ferme.
 Mère arrive en même temps que la nuit obture d’un seul coup les formes oblongues des arbres de la forêt. Elle se tourne vers moi. Apprivoise mon regard.
Mère arrive en même temps que la nuit obture d’un seul coup les formes oblongues des arbres de la forêt. Elle se tourne vers moi. Apprivoise mon regard.
 « En ce moment, dit-elle, je ne suis sûre de rien, mon fils. Pardonne-moi. »
« En ce moment, dit-elle, je ne suis sûre de rien, mon fils. Pardonne-moi. »
 Le soleil éclate dans la cour.
Le soleil éclate dans la cour.
 Peu avant midi, je dis à ma fiancée de m’y rejoindre.
Peu avant midi, je dis à ma fiancée de m’y rejoindre.
 Elle vient.
Elle vient.
 Dégagée de son étreinte, je marche sur le trottoir. Je l’emmène là-bas, derrière la colline, après le carrefour.
Dégagée de son étreinte, je marche sur le trottoir. Je l’emmène là-bas, derrière la colline, après le carrefour.
 Elle me suit, étonnée.
Elle me suit, étonnée.
 Nous marchons côte à côte.
Nous marchons côte à côte.
 La vie de Mère semble être la seule chose qui mobilise l’attention de Pauline.
La vie de Mère semble être la seule chose qui mobilise l’attention de Pauline.
 Mère, son nouvel amant et moi avons tous les trois quitté la ferme au début de l’été.
Mère, son nouvel amant et moi avons tous les trois quitté la ferme au début de l’été.
 Ma fiancée n’a jamais rien su de notre départ ni de la destination que nous prenions.
Ma fiancée n’a jamais rien su de notre départ ni de la destination que nous prenions.
 Dans mon journal ce jour-là, j’ai consigné rageusement que la réapparition de la vie sexuelle de Mère m’avait privé de la contemplation de mon premier amour.
Dans mon journal ce jour-là, j’ai consigné rageusement que la réapparition de la vie sexuelle de Mère m’avait privé de la contemplation de mon premier amour.
 En vérité, c’est de nos corps que j’aurais voulu parler. De mon pressentiment que le mien ne pourrait jamais plus être foudroyé par un corps adolescent.
En vérité, c’est de nos corps que j’aurais voulu parler. De mon pressentiment que le mien ne pourrait jamais plus être foudroyé par un corps adolescent.
voir la suite du dossier Spoon River [prolongations]