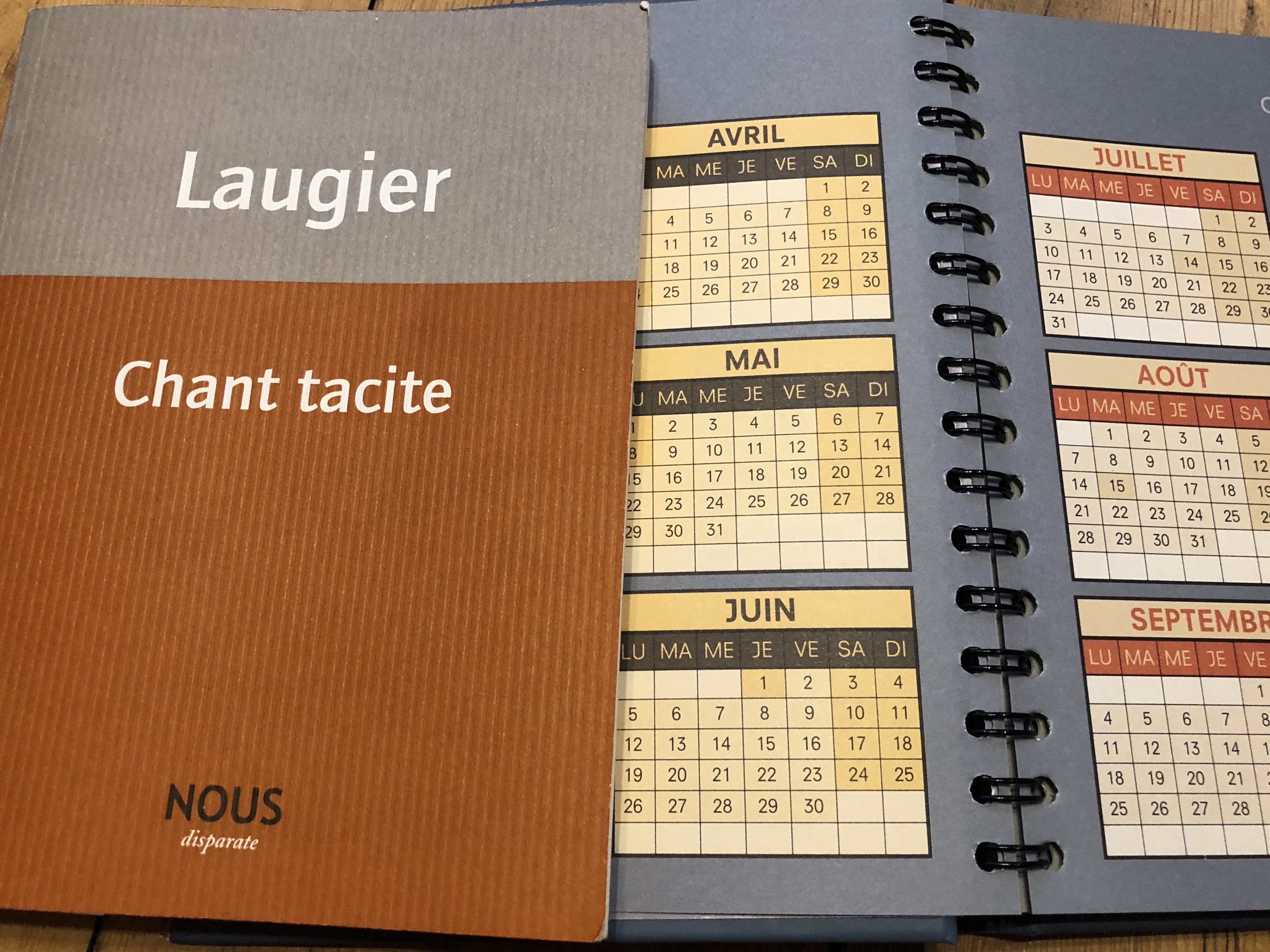Dominique Rabaté | Le prosaïque et le pensif
Le prosaïque et le pensif
Pas une méthode, un chemin peut-être, un cheminement.
Non, ici pas de théorème, il me semble, à la façon de Jean-Patrice Courtois.
Un cheminement qui suit l’ordre des jours mais rien ne dit l’année exacte. Une année pleine qui ne s’inaugure pas avec le calendrier commun depuis son début au premier janvier. Celle-ci commence le 20 août, anniversaire de quoi ? Elle s’interrompra le 19 août, suspendue au mot « dehors ».
Une suite donc mais sans règle du jeu explicite, ni sans doute de règle imposée à la manière de l’Oulipo. Un pari plutôt, celui de s’ouvrir sur « la suffocation du sentiment d’existence » (19 septembre), cette suffocation qui semble liée à « l’infracassable de cela venu sur nous / avec quoi / nous vieillirons » (20 septembre).
Un dehors qui saisit des images, des réminiscences, des souvenirs de choses vues et de lectures, quelque chose dirait-on comme un deuil et un ravissement.
L’infracassable : le noyau résistant de ce qui ne saura être décomposé, par chance et par malheur, ce qui résiste, non pas l’écume des jours mais le résidu décanté, ce qui dure d’une impression (comme on le dit d’une image enfin fixée). L’infracassable comme chez Jacques Dupin ?
Rien de pittoresque dans ce dehors que dessine allusivement le nom d’une ville italienne ou d’une région allemande. Le paysage – mais ce n’est pas le mot, celui de cadre ne convient pas plus – peut se confondre avec une image, une photographie, un souvenir. Découpe presque abstraite d’un moment du jour, d’un geste ou d’une action allusive.
Réduction de la circonstance à la date, à une encoche du calendrier, soumise à la répétition étale des jours qui défilent, mais où s’accroche ce qui dure encore. Date épurée, qui évoque certes le changement des saisons mais sans rien d’une météorologie de l’âme romantique.
Date qui semble parfois l’épitaphe d’un passage personnel dont si peu nous est communiqué. Une épitaphe à la manière dont T. S. Eliot dit que tout poème est une épitaphe, le monument fugace d’un temps lui-même transitoire, dans les échos tissés de poème en poème.
Le 4 avril : « le prosaïque et le pensif / sont l’un l’autre réversibles / la phrase qui les contient éclaire l’opération de division ».
Risquons la glose : Chant tacite tente l’accord désemparé (la rupture en miroir) du tout venant du dehors, qu’on nommera donc avec Emmanuel Laugier le prosaïque : chevaux, outils de jardinage, morceau de ville, trace de lumière. Mais d’un saut, loin de toute médiation sensible ou sensuelle, c’est le « pensif » qui se donne à la fois dans la continuité et dans l’écart le plus grand, les deux renversés ou reversés l’un sur l’autre, dans l’écriture qui les rend proches mais pour en montrer la distance, l’écartement, la division. Disons même avec le texte « l’opération » c’est-à-dire le travail réfléchi qui les tient dans une coordination heurtée, qui les met ensemble pour ouvrir leur différence.
Prosaïque par le heurt volontaire de la syntaxe et du rythme brisé. Ici l’attaque sur l’octosyllabe s’amenuise aussitôt pour laisser place à une phrase plus discursive et savante. La substantivation des adjectifs les érige en qualités abstraites.
Le pensif, ce n’est pas tout à fait la pensée. La qualité semble s’être objectivée dans le dehors même, en nous rendant spontanément pensif. Peut-être est-ce là que s’exerce déjà l’opération que produit le carnet, l’écriture quotidienne comme exercice.
Le lieu de cette alliance et de cette division du prosaïque et du pensif, il me semble que c’est, chez Emmanuel Laugier, le crâne (comme l’indiquait nettement le titre du recueil de 2014 : Crâniennes), espace d’imagination morte et renaissante, à la Beckett, boîte noire de l’enregistrement des impressions, partie du corps qui annonce sa mortalité. Le mot revient souvent dans Chant tacite. Grotte personnelle qui résonne ou que traverse une impression, caisse de résonnance portative, mot commun qui désigne encore le siège de la pensivité.
Du dehors au carnet, nulle barrière. Jusqu’à cette légère plaisanterie de premier avril, dans une simple phrase nominale : « un poisson aux écailles ardoise foncé passe dans le carnet », poisson réel ou dessiné qui traverse et vient habiter naturellement sur la page. On notera que le carnet n’est pas propriété, pas de possessif ici. Le carnet,c’est l’autre acteur majeur avec le dehors, c’est leur rencontre, presque sans médiation parfois, qui semble faire naître le poème.
Des impressions plutôt que des sensations. Sans cesse le saut du prosaïque à la pensivité déjoue ce qui reviendrait à un corps qui se laisse aller à une rêverie matérielle, à un abandon des sens. Le « sentiment d’exister » est ici suffocation, je l’ai déjà rappelé, que la découpe des phrases restitue et congédie, en la mettant à distance de soi.
De là sans doute, Jean-Claude Pinson l’a noté, l’aspect austère de Chant tacite, son manque (et même son refus) de séduction immédiate ou de captation, son allure elliptique et heurtée, l’allusivité frappante de tous les contextes. En même temps que, dans la répétition des jours, se créent des rimes, des images qui reviennent, et comme le murmure d’une musique qui tisse ensemble les fragments des impressions, des petites suites de journées qui pensent aux mêmes objets, aux mêmes souvenirs.
Chant tacite : le titre frappe, il résonne longuement, il garde son mystère. J’y entends moins l’oxymore (le chant qui serait silence) que l’accord implicite, comme on le dit d’un accord tacite. Complicité qui se passe de la formulation, de l’explicitation, accord qui n’exclut pas les mots mais qui ne demande pas leur ratification. Peut-être ce que traduit ce moment du 30 mars : « le rythme s’ouvre en chant tacite / son dessin s’enfonce dans les veines lentes / et vraies », double action produite dans le mouvement que dit la voix pronominale, comme sans agent.
Je sais que c’est aussi « le chant écrasé dans la gorge » (29 mars), le poids de l’histoire terrible de l’Europe qui traverse le livre,de l’Allemagne ou des souvenirs de Shoah à la figure de Mandelstam (nom auquel je mets pour ma part encore la majuscule, comprenant sans l’admettre vraiment cette coquetterie de notre époque qui devient presque un tic ou un marqueur de poésie).
Je lis aussi à la date du 14 janvier : « le chant / tacite / est un résidu de frayeurs / et de rage », chant arraché et mutique, « infracassable chant » poursuit le texte au 15 janvier. Là, encore la tension se maintient, si le chant est un résidu et qu’il est ce qui reste aussi, ce qui dure, ce qui revient le lendemain dans le carnet.
Ce qui dure dans l’abrasement pensif des circonstances. Dans le dernier poème, on lit : « à l’endroit où voir se refuse / s’ouvre un chant tacite ». Là advient le volume des voix que consigne le carnet ; là revient l’injonction d’imaginer encore, pour prolonger le mouvement pour « conduire ailleurs » « l’immense travail d’approche du matériau », vers un « ici » qui est le lieu du texte en train de se faire et son dehors toujours rouvert.