Marseille c’est tout le monde
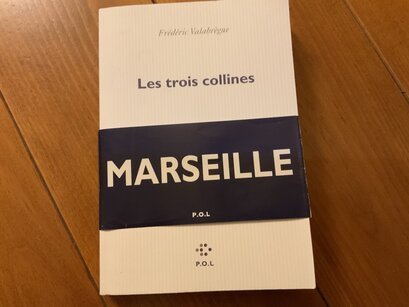
Marseille, Frédéric Valabrègue y vit depuis toujours.
Il en arpente les rues, en respire l’air venté ou vicié, et, surtout, il saisit les nuances de cette ville à la fois nerveuse et nonchalante. C’est aussi ma ville, et même si je n’y vis plus, elle reste ma ville, celle où j’ai grandi où j’ai vécu et travaillé, où ma personnalité s’est formée, où mes sensations se sont aiguisées. Chaque fois qu’un roman de Valabrègue raconte Marseille, je m’y reconnais.
« Les trois collines », son dernier livre, en fait carrément un personnage, l’héroïne du livre, si tant est qu’on puisse parler de héros dans cette non-fable et cette non-fiction.
Extrêmement documenté, sans pour autant être un essai, « Les trois collines » est un livre amoureux de sa ville et des marseillaises et marseillais. Féroce contre la municipalité dirigée par Jean-Claude Gaudin pendant vingt-cinq ans, le livre raconte le morcellement organisé au fil du temps - et ce depuis la gouvernance de Gaston Defferre -, d’une ville certes faite de bric et de broc, un ensemble de villages (des pêcheurs aux fermiers, c’est pas rien quand même !), mais où l’espace, c’est à dire le vide, les ouvertures sur la mer et les collines formaient une architecture équilibrée.
Or, ces brèches qui permettaient de respirer amplement (ah l’odeur âcre ou douce de la mer) dans l’urbanisation galopante ont été petit à petit dévorées par un urbanisme sans foi ni loi. « La friche c’est le moment du sauvage où tout se régénère et il faut cet espace-là dans un cerveau humain pour qu’il s’oxygène ». Frédéric Valabrègue parle de « la double mensuration du temps et de l’espace ». Magnifique formulation de notre condition humaine.
Mais voilà que tout se détraque, se bazarde et nous avec, à partir du boulevard de la Corderie dans le quartier d’Endoume où l’auteur vit, et où un immeuble de standing bâti par la société Vinci (qui possède la moitié du parc immobilier de la ville), se dresse désormais, hideux et démesuré dans la configuration du quartier, construit sur des restes archéologiques balayés d’un coup de pelleteuse, en passant par le réaménagement de la Plaine qui a dressé les habitants contre son maire (qu’il avaient pourtant réélu), pour culminer avec la catastrophe rue d’Aubagne.
Le 5 novembre 2018, Marseille et les marseillais faisaient irruption sur le devant de la scène nationale, avec l’effondrement de deux immeubles rue d’Aubagne dans le quartier Noailles, en plein centre-ville. Huit morts, et des centaines de personnes relogées en catastrophe.
Des élus, propriétaires d’immeubles menacés d’écroulement, sommés de démissionner, la révélation d’un rapport commandé par la ville en 2015 qui faisait état d’une situation alarmante avec « un parc privé indigne et dégradé d’une rare ampleur », le rapport parlait de 42 400 appartements non conformes et dangereux.
Si je parle d’amour pour sa ville, c’est que « Les trois collines » n’est pas un livre militant. Depuis « La ville sans nom », son premier roman, Frédéric Valabrègue attache ses pas d’écriture à la connaissance de Marseille, plus complexe qu’il n’y paraît dans sa légende pittoresque.
De quartier en quartier, il raconte le coeur galopant d’une ville où, malgré les épreuves, malgré l’impéritie politique, on fait contre mauvaise fortune bon coeur, avec ce goût du farniente, ce culte du dehors, cette tolérance venue du métissage qui a fait la ville, et qu’on caricature à tout bout de champ.
Les marseillais ne sont pas des gobi (ces petits poissons d’ailleurs en danger de disparition), et l’écrivain oppose au folklorisme généralisé de la cité phocéenne (et encore en 2013 où on fit se distinguer Marseille capitale européenne par une transhumance grotesque) un parcours artistique et intellectuel qu’on a toujours sous-estimé et mis au ban : Walter Benjamin, Louise Michel, Nadar, Jonas Mekas, le Marquis de Sade, René Allio, font partie de ces artistes qui ont déambulé dans Marseille et l’ont décrite, photographiée, peinte, célébrée.
« Les trois collines » est aussi un hommage à la promenade, loisir marseillais par excellence. Ces trois collines, Endoume, Bompard, Le Roucas blanc, sont « trois rochers blancs, cailloux desséchés par la soif que le travail des maçons rocailleurs et des jardiniers a recouverts d’une toison » - mais on en compterait bien d’autres au-dessus de la cité méditerranéenne -, dont la population a évolué au fil des aménagements urbains si bien que désormais des secteurs entiers du Roucas sont privatisés, interdisant aux piétons chemins, traverses, escaliers, qui permettaient de passer d’une colline à l’autre (revoir les films de René Allio, notamment « L’heure exquise » ) - comme quoi la ville n’appartient pas à tout le monde, et l’argent et le mépris sont plus dévastateurs que la pègre.
Frédéric Valabrègue se place en observateur amusé qui défait les clichés, rapporte le parler coloré de ses voisins, leur intelligence souvent ignorée tout comme leur aveuglement envers ses édiles qui en a pris un coup avec les « affaires » de la Plaine et l’épouvante de la rue d’Aubagne et qui, enfin dessillé, portera au pouvoir quelques mois plus tard le Printemps marseillais.
Il se place aussi en citoyen énervé (usage marseillais qui redonne tout son sens, violent, à l’origine du mot, retirer les nerfs d’un corps), qui ne se soumet pas.
Il fallait ce livre pour que la colère ne s’éteigne pas tout à fait, que l’espérance d’un vivre-ensemble se fasse entendre, que le fun marseillais, qui s’accommode à la fois de la légende ancienne, du look contemporain, de la branchitude bobo et de l’omniprésent soleil ne recouvre pas les blessures à vif d’une population dont on dresse l’une contre l’autre les groupes et les classes sociales. Marseille, ville qui dit, à travers désastres et vitalité, la vérité d’une politique néolibérale qui brise ses membres les plus vulnérables, exténue une qualité de vie au profit de quelques vues ciblées, sépare et ghettoise, ignore la parole citoyenne, sécurise des minorités qui font des voix majoritaires, traque des populations entières dites minoritaires, et dresse les uns contre les autres, ce qui fait dire à l’écrivain page 131« Pitié pour les hommes, pitié pour leurs bassesses », parce que comme partout ça travaille à une « purification ethnique par l’argent ».
C’est dit, c’est clair et net et ça fait du bien de le lire. Ça ne fera pas un best-seller sur les tables des libraires, ça n’aura pas voix au chapitre sur toutes les radios et télés de France, ça n’est pas vendeur bien que ce soit drôle, beau, puissant, féroce, amoureux.
Mais c’est Marseille et Marseille c’est tout le monde.
Frédéric Valabrègue, Les trois collines
Editions P.O.L
https://remue.net/claudine-galea