Dominique Viart | François Bon, éclats de réalité
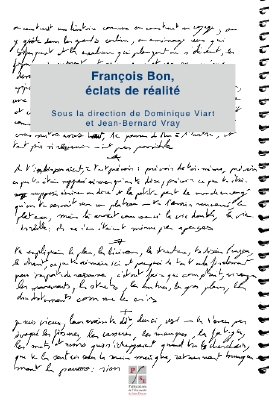
François Bon, éclats de réalité est le recueil des actes du colloque qui s’est tenu à Saint-Étienne sous la direction de Dominique Viart et Jean-Bernard Vray.
Nous l’avons présenté ici.
Nous remercions Dominique Viart de nous avoir confié les premières pages de sa communication.
François Bon [1].
On sait désormais combien ces livres ont marqué profondément ce qu’il faut bien, déjà, appeler « l’histoire » de la littérature contemporaine. Trente ans bientôt, ce n’est pas rien, et l’on connaît, depuis, tous les ouvrages qui se réclament de cette ouverture, de cette liberté-là. On n’en fera pas ici l’inventaire, ayant peu de goût pour l’ancienne critique des sources et les recherches d’influences, quand bien même elles sont, de Laurent Mauvignier à Philippe Vasset, de Thierry Beinstingel à Martine Sonnet, revendiquées par d’autres écrivains et parfois même au sein de leurs propres textes. Nous souhaitons plutôt, au-delà de l’effet produit, en revenir à l’œuvre–même, afin de mieux comprendre ce qui s’y est joué. Afin aussi de l’arracher peut-être à ce portrait trop figé que la doxa critique en dessine parfois.
Car François Bon n’est pas « l’écrivain de l’usine », du « monde du travail » ni « la voix des exclus ». Lui-même ne se reconnaît guère dans une telle définition, qu’il récuse : « je n’aime pas ce qu’on me renvoie en permanence sur l’écriture des déshérités, des marges ou tout ce vocabulaire de l’écriture sur : j’écris ce que j’ai constaté, j’écris ce qui était en moi et que je traversais [2] ». Et, du reste, quiconque fréquente intimement ses livres sait bien à quel point non seulement ils débordent de telles circonscriptions, mais les invalident même par l’extraordinaire croisement d’exigences et d’interrogations qui les travaillent. Car François Bon n’écrit pas sur : il écrit avec : avec la littérature et avec les voix qui disent la sécheresse du monde, avec la musique et l’image, avec les livres et les écrans, les claviers. Et il écrit, comme il aime à le dire lui-même, de. Écrire de soi, « avec de soi » comme il dit, avec de l’autre, écrire avec de la langue. « De », c’est depuis, aussi bien qu’au sujet de, selon l’ancienne préposition latine. Et « avec », c’est dans le grand compagnonnage des livres et des hommes.
Alors certes, il y va bien d’une certaine écriture du réel, laquelle répond à une véritable urgence, face à un réel devenu plus âpre, moins certain de ses lendemains. Quelles que soient les exigences que la littérature pouvait avoir envers elle-même, il n’était plus possible qu’elle continuât de se détourner d’un certain nombre de réalités. Mais si on l’interroge sur cette « fonction » assignée à sa littérature, François Bon refuse ce terme de « fonction » et renvoie à la formule de Beckett : « Comment c’est », dont on ne sait si elle interroge ou énonce, mais qui ne nomme pas. Aussi ne saurait-on réduire ce travail à la matière qu’il brasse souvent, qu’il s’agisse comme dans les premiers livres d’un matériau social malaxé par des voix, ou dans les récits suivants, d’un matériau existentiel dont le fracas s’éprouve aux syntaxes heurtées des Ateliers d’écriture. « L’idée du document est une fausse piste : c’est comment un texte prend emprise ; autonomie, lumière et puissance, qui seul compte [3]. » L’écrivain, et c’est heureux, n’en a pas fini avec la langue, avec la phrase et la grammaire (dont François Bon souligne, quelques lignes plus loin du même entretien, toute l’importance pour lui) : « Constituer le réel comme représentation suppose de disloquer aussi la syntaxe issue des représentations préexistantes. » Il n’en a pas fini avec la littérature. Pas plus qu’avec l’interrogation qui, selon lui, la fonde, et qu’il rappelle volontiers : « Qu’est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes ? »
Aussi est-ce une œuvre inquiète de sa forme qui nous est donnée à lire. Et dont le mouvement montre que jamais elle ne se tient quitte de ce que l’on croirait être accompli. Elle a dû inventer son dispositif pour faire advenir le réel dans un espace de texte qui ne sacrifiât pas à ces illusions mimétiques dénoncées avec violence par des auteurs majeurs que François Bon salue : Beckett, Claude Simon ou Nathalie Sarraute. Elle a dû échapper à ce que Philippe Hamon appelle le « discours contraint » du réalisme, et à l’idéologie latente dont ces pratiques peuvent parfois être porteuses. Mais elle saisit au contraire des quotidiens inaccessibles à la littérature que Georges Perec, auquel François Bon voue grande fidélité, repère sous le nom d’« infra-ordinaire ». Et, s’agissant d’usine : des rituels, des règles, des ethos que seule une syntaxe défaite, avec son vrac, son chaos, sa complexité désordonnée, pouvait approcher.
Car ce que François Bon apporte à l’écriture du réel, c’est bien d’abord cela : une phrase pétrie de littérature et de réel brut, traversée de voix où les mots entrent en conflagration avec les choses. Des voix que l’on entend dans Limite, dans Décor ciment, dans Crime de Buzon dans Calvaire des chiens, diversement diffractées, avec leurs résonances de Bible, du Quijote, d’Artaud, d’Aubigné, de Rabelais, de Rimbaud, avec des phrases violemment hostiles à tout « pittoresque », à toute « parlure » qui viendraient les enfermer dans l’espace socialement circonscrit de leur altérité. Leur puissance finit au contraire par faire éclater la forme romanesque et met en question le genre comme tel : c’est dans Parking, ce livre qui, après s’être réfléchi, rejoue son projet en divisant la parole, non pas selon quelque exigence d’incarnation mais sous la poussée des Tragiques grecs, plusieurs fois relus ; c’est dans Impatience avec un « dispositif noir » qui fait du théâtre une tribune où le monde vient se dire tel qu’il fait violence aux individus.
La tension qui se manifeste entre le réel et ses représentations ne cesse ainsi de relancer le travail. Et si, dans Impatience, l’écrivain semble congédier le roman, il y revient finalement quelques années plus tard sous les espèces d’une autre définition : « […] le territoire arpenté, les visages et les voix, les produire est ce roman », écrit-il aux premières pages de Daewoo qui veut « faire face à l’effacement ». « Produire », lit-on et non pas « reproduire » : flexion sémantique à laquelle la critique s’est souvent heurtée, et trompée. Car « produire » est pratique de fiction, quand bien même cette fiction vise à faire advenir le réel. Dans un mot que François Bon m’envoyait en mars 2004, je relis cette phrase : « J’en bave avec mon Daewoo. Un gros bouquin qui me fait maintenant l’effet de Calvaire des chiens : besoin de fiction pour aller extorquer le réel, le décortiquer ou lui racler la peau, et quand on est au bout, la fiction lui tourne le dos et on n’a plus l’accroche ». Le roman est dans ce battement-là. Il ne cesse de s’y débattre et de s’y réinventer, comme le montre encore, tout récemment, L’Incendie du Hilton.
Ainsi jamais l’œuvre ne s’installe. Jamais elle ne recompose à l’identique l’architecture déjà dressée. Mais elle se déporte, sonde d’autres marges : les siennes comme celles du monde. Et c’est par le récit qu’elle poursuit ce qui lui paraît échapper au roman, accueillant des fragments d’autrui, des bribes de soi, ré-arrimant dans l’expérience une disponibilité autre à ce que l’Histoire socio-économique alors a mis « en bascule ». C’était toute une vie et Prison, issus d’Ateliers d’écriture n’en racontent pas les épisodes ni les avancées, mais retiennent dans la grande déperdition des expériences, les brisures qui les déchirent et la violence que c’est, pour l’écrivain qui les anime, d’en lire la trame dans des phrases désaccordées. Temps machine, Paysage fer sont, par le verbe et par lui seulement, des explorations, historiques et spatiales tout à la fois, d’un univers industriel en déshérence quand Mécanique en livre une version plus intime, familiale et endeuillée, qu’une infinie pudeur décale sur quelques objets, voitures et photographies, lesquels disent en creux ce que la phrase n’exhibera pas.
Cette entreprise littéraire est ainsi faite d’approches et de détours. Approche au plus près des mots difficiles à venir dans les Ateliers – de Sang gris à La Douceur dans l’abîme –, approche des voix et des visages ; mais détour s’il s’agit de s’ouvrir le cœur, selon un geste qui ne se porte à la scène, dans Quatre avec le mort par exemple, qu’à la condition de ne surtout pas se donner comme explicitement autobiographique. Un détour qui a bien compris que l’on ne peut jamais parler de soi dans le face-à-face d’un miroir de papier, mais qu’il y faut des partenaires, des accompagnements, des sollicitations autres, et qui offre accueil à qui veut arracher sa vie à la réclusion des silences : c’est tout le programme déployé dans Tous les mots sont adultes que d’ainsi permettre aux mots de venir, dans leur difficulté même.
Détour encore, peut-être, que de faire le portrait d’une génération, sinon de plusieurs, en se portant à l’écoute des musiques qui nourrissaient leurs désirs et leurs rêves : Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin : ces biographies sont des biographies plurielles dans l’entrelacs desquelles se racontent des trajets, certes singuliers, mythifiés souvent, mais que l’écriture ici re-socialise, rend à leurs contextes plus complexes que les hagiographies usuelles ne l’avouent. Et elles découvrent au lecteur l’autre face d’une époque et d’une culture : celle des adolescents qui vivent ces musiques, se façonnent à leur aune – et se heurtent à l’illusion que parfois elles suscitent.
Détour aussi que de traiter de littérature en écrivant sur Rabelais, en le republiant, pour montrer combien cette œuvre est d’abord affaire de langue ; en écrivant sur Koltès, pour montrer combien ce théâtre est affaire de poésie, de rythme et de scansion. François Bon sait comment entendre les œuvres là où on ne les attend pas. Et lui-même ainsi échappe à toute saisie, répondant Mémoires de Saint-Simon à qui l’interroge sur le monde actuel, Balzac à qui lui parle de modernité, Internet à qui vante ses livres. Tous les lieux où quelque chose peut advenir des intensités qui composent l’individu lui sont bons à explorer : la musique avec Kasper Töplitz ou Dominique Pifarelli, la photographie avec Jérôme Schlomoff ou Antoine Stéphani, le cinéma avec Fabrice Cazeneuve ou Stéphane Gatti, le théâtre avec Charles Tordjman ou Gilles Bouillon.
Et encore ne faudrait-il pas limiter cette liste aux seuls domaines de l’art, verbal, théâtral, musical, photographique, filmique ou plastique : car cet ingénieur est d’une curiosité sans faille, qui le fait dialoguer avec des urbanistes, des philosophes, des sociologues, des géographes. La littérature ne lui est pas une tour d’ivoire ni une chambre close : il partage avec Pierre Bergounioux, avec Pascal Quignard, et bien d’autres écrivains actuels, un souci de comprendre et de savoir qui l’entraîne vers tous ces autres domaines de la pensée. Domaines auxquels bien sûr il convient d’ajouter celui qui devient pour lui, aujourd’hui, le lieu majeur : Internet et ses inventions avérées ou possibles : lieu d’un autre régime de la communication et de la circulation des œuvres, craint par beaucoup mais par lui vivement souhaité.
Il fut l’un des premiers à s’y aventurer, en 1997. Alors, en effet, que ce n’était encore qu’une aventure, une « nouvelle frontière ». Mais les chemins qu’il y a tracés perdurent avec bonheur : remue.net, fondé en 2001, est désormais l’un des meilleurs sites critiques de la littérature contemporaine. Son propre site Tierslivre.net, créé en 2005, atteste d’une richesse irrécusable, espace de découverte et de débats, de prises de position et d’inventions : espace, en un mot, de vie littéraire nouée à une vie d’homme. De cet engagement témoigne aussi un livre : Tumulte écrit jour après jour sur la toile avant que d’être transféré au papier, mais avec une déperdition très nette de tout ce qui, autour, faisait « rhizome ». Car c’est bien là, sans doute, ce que poursuit aujourd’hui François Bon, l’élaboration de ce que nous pourrions nommer, reprenant à Gilles Deleuze son mot, une littérature « rhizomatique », où les fils des uns s’entrelacent à ceux des autres.
Car, si Internet désormais est un combat, face aux puissances de l’argent qui se l’approprient, face à une économie mondialisée de la culture, au détriment peut-être de ceux-là même qui la font ; François Bon le répète : il convient de ne pas déserter le champ de bataille mais de s’y porter au contraire, avec armes et imaginations, avec résolution et fermeté, pour opposer aux modèles subis des modèles choisis, contrer l’exploitation par le partage. Lui même y contribue en créant l’une des premières maisons d’édition numérique, publie.net, qui ne le cède en rien sur le plan de l’exigence éditoriale à bien des maisons de papier plus anciennement installées : le catalogue déjà réuni témoigne fortement de la vivacité de la création et de la réflexion contemporaines.
Illustration de couverture : Manuscrit de François Bon.