Notes pour le roman, par Bertrand Leclair
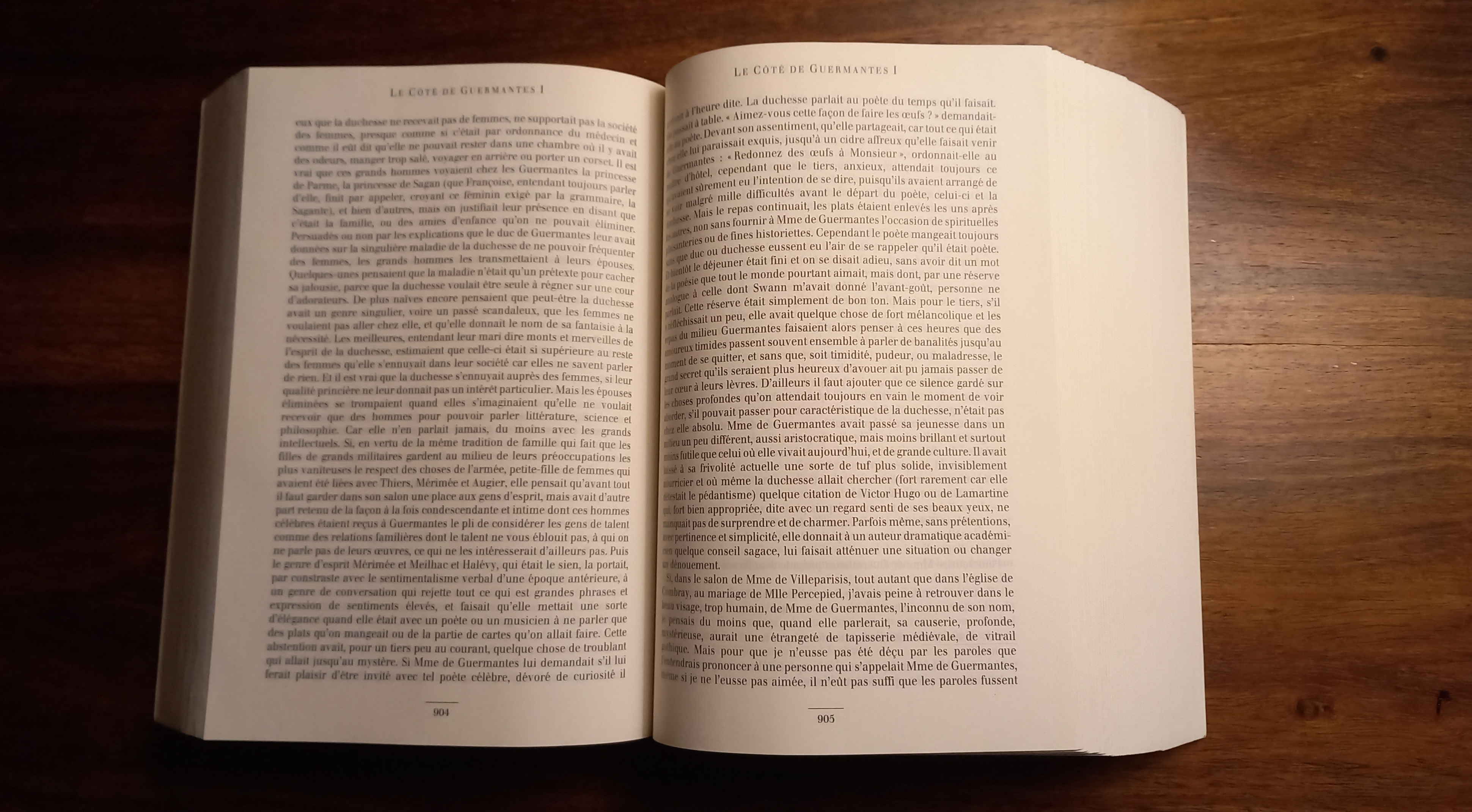
Bertrand Leclair sur le site d’Actes Sud
sur le site de France Culture
sur remue.
Dernier livre paru : Le vertige danois de Paul Gauguin, éditions Actes Sud, collection « un endroit où aller ».
À propos de ce roman, écouter un entretien de Bertrand Leclair avec Sylvie Tanette (février 2014).
 1. Le roman est-il un genre, ou bien le mélange des genres, l’espace même où circuler à sa guise entre les genres ? S’il se constitue formellement de techniques précises, le roman est d’abord, est avant tout un espace de liberté : un espace de liberté où chercher l’insaisissable vérité de notre être au monde, l’éprouver par instants magiques, qu’on lise ou qu’on écrive ; un espace de liberté d’autant plus important qu’il se joue aujourd’hui comme hier non pas dans une langue savante ou enseignée, mais dans la langue vernaculaire : cela reste vrai depuis l’apparition du terme, ouvrant dès Le Roman d’Alexandre (1120), la langue de tous à la possibilité du fait littéraire jusqu’alors réservée aux locuteurs savants - « On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne / Et on vous regarde / On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret » (Michaux).
1. Le roman est-il un genre, ou bien le mélange des genres, l’espace même où circuler à sa guise entre les genres ? S’il se constitue formellement de techniques précises, le roman est d’abord, est avant tout un espace de liberté : un espace de liberté où chercher l’insaisissable vérité de notre être au monde, l’éprouver par instants magiques, qu’on lise ou qu’on écrive ; un espace de liberté d’autant plus important qu’il se joue aujourd’hui comme hier non pas dans une langue savante ou enseignée, mais dans la langue vernaculaire : cela reste vrai depuis l’apparition du terme, ouvrant dès Le Roman d’Alexandre (1120), la langue de tous à la possibilité du fait littéraire jusqu’alors réservée aux locuteurs savants - « On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne / Et on vous regarde / On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret » (Michaux).  2. La liberté, ce que l’on en fait ou non, est une chose complexe, qui ne va pas sans effroi. La liberté est nécessairement à prendre, même une fois conquise, en littérature comme dans la vie : les genres n’ont d’intérêt que par le jeu auquel ils ouvrent, quand la Différence Sexuelle, alias la D.S. ainsi que la désigne Hélène Cixous et je consens à toutes les offrandes, ouvre un champ des possibles qui restera toujours à explorer, à interroger, à vivre, à jouer, déjouer, rejouer, voire sur-jouer et chaque fois à nouveaux frais, pour peu que l’on n’ait pas peur de s’y livrer.
2. La liberté, ce que l’on en fait ou non, est une chose complexe, qui ne va pas sans effroi. La liberté est nécessairement à prendre, même une fois conquise, en littérature comme dans la vie : les genres n’ont d’intérêt que par le jeu auquel ils ouvrent, quand la Différence Sexuelle, alias la D.S. ainsi que la désigne Hélène Cixous et je consens à toutes les offrandes, ouvre un champ des possibles qui restera toujours à explorer, à interroger, à vivre, à jouer, déjouer, rejouer, voire sur-jouer et chaque fois à nouveaux frais, pour peu que l’on n’ait pas peur de s’y livrer.  Là encore, dans la vie comme dans les livres, ou, plus précisément, dans la vie politique comme dans les suppléments littéraires, c’est cette peur du chaos où mènerait la liberté qui est étonnante, lorsqu’elle semble tenailler tous ceux que l’on pourrait appeler en détachant les syllabes « les paniqués du genre », ceux qui redoutent donc que cette différence puisse subitement s’abolir, la D.S. s’évanouir, par on ne sait quel coup de baguette magique ministérielle - ce qui démontrerait dès lors que l’érection des genres en fortins n’était rien d’autre que factice, n’avait aucune base solide ; ce qui démontrerait dès lors exactement ce contre quoi les adversaires des gender studies prétendent s’élever.
Là encore, dans la vie comme dans les livres, ou, plus précisément, dans la vie politique comme dans les suppléments littéraires, c’est cette peur du chaos où mènerait la liberté qui est étonnante, lorsqu’elle semble tenailler tous ceux que l’on pourrait appeler en détachant les syllabes « les paniqués du genre », ceux qui redoutent donc que cette différence puisse subitement s’abolir, la D.S. s’évanouir, par on ne sait quel coup de baguette magique ministérielle - ce qui démontrerait dès lors que l’érection des genres en fortins n’était rien d’autre que factice, n’avait aucune base solide ; ce qui démontrerait dès lors exactement ce contre quoi les adversaires des gender studies prétendent s’élever.  On n’est pas si loin de pareils paradoxes dans certains discours littéraires, aujourd’hui, lorsqu’on entend des auteurs ou des critiques dire du ton le plus docte que l’art français du roman se serait perdu dans les sables de la vague théorique du XXe siècle, ou qu’il serait en danger d’être contaminé par l’autofiction et sa fâcheuse tendance à bousculer les genres (et ce sont toujours les femmes écrivains qui sont alors citées sinon dénoncées, comme si l’autofiction était leur spécialité nécessairement sexuée...).
On n’est pas si loin de pareils paradoxes dans certains discours littéraires, aujourd’hui, lorsqu’on entend des auteurs ou des critiques dire du ton le plus docte que l’art français du roman se serait perdu dans les sables de la vague théorique du XXe siècle, ou qu’il serait en danger d’être contaminé par l’autofiction et sa fâcheuse tendance à bousculer les genres (et ce sont toujours les femmes écrivains qui sont alors citées sinon dénoncées, comme si l’autofiction était leur spécialité nécessairement sexuée...).  Les uns comme les autres, l’envie vous vient de les rassurer, quitte à rappeler le cri du cœur de l’avant-dernier pape en exercice : « N’ayez pas peur ! » N’ayez pas peur de la liberté, la D.S. ne risque en rien de s’évanouir, elle qui n’est pas là d’être jamais comblée, pas plus que ne le sera jamais la différence entre l’usage utilitariste de la langue et sa puissance poétique - quand c’est l’espace de cette différence que le roman vient mettre en mouvement de mille manières mais toujours par le biais, j’y reviendrai, d’un jeu très sérieux.
Les uns comme les autres, l’envie vous vient de les rassurer, quitte à rappeler le cri du cœur de l’avant-dernier pape en exercice : « N’ayez pas peur ! » N’ayez pas peur de la liberté, la D.S. ne risque en rien de s’évanouir, elle qui n’est pas là d’être jamais comblée, pas plus que ne le sera jamais la différence entre l’usage utilitariste de la langue et sa puissance poétique - quand c’est l’espace de cette différence que le roman vient mettre en mouvement de mille manières mais toujours par le biais, j’y reviendrai, d’un jeu très sérieux.  3. S’émanciper des genres codifiés : comme les autres arts, la littérature s’y est employée depuis trois siècles, non sans ferrailler, et le triomphe actuel du roman est le fruit de cette émancipation. Ce triomphe somme toute récent au regard du temps long de l’histoire littéraire correspond à l’émergence progressive d’un immense terrain de jeu sur la ruine des idéaux classiques qui permettaient une classification en genres aussi codifiés que l’était la société aristocratique. En contrepartie, le roman moderne ne dispose d’aucune définition claire, le romancier n’est d’ailleurs à sa place nulle part, sinon à la confluence, à la lisière, aux frontières des différents genres historiques, les racines de l’art moderne du roman puisant autant à l’épopée qu’à la sotie, à la confession qu’au panégyrique, au pamphlet qu’au sermon. Fruit d’un joyeux bordel en somme, le roman moderne est le sublime bâtard de l’histoire littéraire, le sang-mêlé, le trans-poétique, il peut intégrer tous les matériaux sans exception, nobles ou vulgaires, et même les plus composites, aussi bien le savoir de l’inconscient que l’insu de nos bonnes consciences - il peut le faire parce qu’il est le brouillage en actes de la notion de genre comme définition même du genre dominant qu’il prétend être, non sans arrogance, aujourd’hui, sur la scène littéraire et plus encore sur la scène commerciale (ces deux scènes, est-ce utile de le préciser, ne concordant pas si souvent que les « prescripteurs » voudraient désormais nous le faire croire).
3. S’émanciper des genres codifiés : comme les autres arts, la littérature s’y est employée depuis trois siècles, non sans ferrailler, et le triomphe actuel du roman est le fruit de cette émancipation. Ce triomphe somme toute récent au regard du temps long de l’histoire littéraire correspond à l’émergence progressive d’un immense terrain de jeu sur la ruine des idéaux classiques qui permettaient une classification en genres aussi codifiés que l’était la société aristocratique. En contrepartie, le roman moderne ne dispose d’aucune définition claire, le romancier n’est d’ailleurs à sa place nulle part, sinon à la confluence, à la lisière, aux frontières des différents genres historiques, les racines de l’art moderne du roman puisant autant à l’épopée qu’à la sotie, à la confession qu’au panégyrique, au pamphlet qu’au sermon. Fruit d’un joyeux bordel en somme, le roman moderne est le sublime bâtard de l’histoire littéraire, le sang-mêlé, le trans-poétique, il peut intégrer tous les matériaux sans exception, nobles ou vulgaires, et même les plus composites, aussi bien le savoir de l’inconscient que l’insu de nos bonnes consciences - il peut le faire parce qu’il est le brouillage en actes de la notion de genre comme définition même du genre dominant qu’il prétend être, non sans arrogance, aujourd’hui, sur la scène littéraire et plus encore sur la scène commerciale (ces deux scènes, est-ce utile de le préciser, ne concordant pas si souvent que les « prescripteurs » voudraient désormais nous le faire croire).  4. Trop de « romans » arrivent déjà morts en librairie de baigner dans le formol des conventions, trop de romans sont de véritables leurres littéraires pour que l’on puisse se dispenser de rappeler quelques évidences qui n’en sont pas pour tout le monde. Bien des romans n’ont rien à voir avec une quelconque quête littéraire, qui n’en sont pas moins des romans, comment les appeler autrement, et parfois rudement bien fichus techniquement, de beaux produits de pur divertissement. Je précise de « pur » divertissement, parce que le roman a par nature une fonction de divertissement, et c’est bien ce qui implique de poser d’emblée sinon sa finalité, du moins son enjeu, quitte à friser ici la caricature : le roman de pur divertissement est celui qui ne vise à rien d’autre qu’à divertir les lecteurs pour les soulager un instant des pesanteurs de leurs existences et les aider ce faisant à s’y conformer ; le roman porté par une ambition littéraire ne vise à divertir le lecteur de tout ce qui l’entrave au quotidien des jours que dans le but de l’inviter à une expérience poétique, à son partage.
4. Trop de « romans » arrivent déjà morts en librairie de baigner dans le formol des conventions, trop de romans sont de véritables leurres littéraires pour que l’on puisse se dispenser de rappeler quelques évidences qui n’en sont pas pour tout le monde. Bien des romans n’ont rien à voir avec une quelconque quête littéraire, qui n’en sont pas moins des romans, comment les appeler autrement, et parfois rudement bien fichus techniquement, de beaux produits de pur divertissement. Je précise de « pur » divertissement, parce que le roman a par nature une fonction de divertissement, et c’est bien ce qui implique de poser d’emblée sinon sa finalité, du moins son enjeu, quitte à friser ici la caricature : le roman de pur divertissement est celui qui ne vise à rien d’autre qu’à divertir les lecteurs pour les soulager un instant des pesanteurs de leurs existences et les aider ce faisant à s’y conformer ; le roman porté par une ambition littéraire ne vise à divertir le lecteur de tout ce qui l’entrave au quotidien des jours que dans le but de l’inviter à une expérience poétique, à son partage.  Romans ou non, par quoi valent les œuvres qui ne se réduisent pas au divertissement, sinon par la poésie, par la brèche qu’elles ouvrent dans la langue commune à une verticalité de l’être au monde, au sentiment partagé d’y être, enfin, au monde, et de s’y tenir nulle part ailleurs que dans la langue, solidement campé sur ses deux jambes, serait-ce un instant ?
Romans ou non, par quoi valent les œuvres qui ne se réduisent pas au divertissement, sinon par la poésie, par la brèche qu’elles ouvrent dans la langue commune à une verticalité de l’être au monde, au sentiment partagé d’y être, enfin, au monde, et de s’y tenir nulle part ailleurs que dans la langue, solidement campé sur ses deux jambes, serait-ce un instant ?  Instrument de connaissance, le roman en terme d’art littéraire n’a certes pas pour ambition d’atteindre je ne sais quelle « réalité augmentée », et s’il s’agit d’augmenter quelque chose, ou plutôt de décaler, de desceller, c’est d’abord notre perception de la réalité et notre capacité à y laisser revenir ce fichu réel qui nous hante, qui hante notre réalité commune - car enfin, ainsi que le demandait André Breton, « la médiocrité de notre univers ne dépendrait-elle pas de notre pouvoir d’énonciation ? ».
Instrument de connaissance, le roman en terme d’art littéraire n’a certes pas pour ambition d’atteindre je ne sais quelle « réalité augmentée », et s’il s’agit d’augmenter quelque chose, ou plutôt de décaler, de desceller, c’est d’abord notre perception de la réalité et notre capacité à y laisser revenir ce fichu réel qui nous hante, qui hante notre réalité commune - car enfin, ainsi que le demandait André Breton, « la médiocrité de notre univers ne dépendrait-elle pas de notre pouvoir d’énonciation ? ».  5. Rappelons tout de même que, parmi les auteurs majeurs de notre temps, plusieurs ont renoncé à la notion même de roman pour caractériser leur travail sans pour autant revendiquer la poésie comme étiquette - je songe à Pierre Guyotat, dont l’œuvre, jusque dans ses dimensions tragiques et comiques, relève bien plus de l’épopée que du roman et qui s’écrit d’ailleurs, depuis Progénitures, au moyen du verset ; je songe à Hélène Cixous qui n’emploie pas ce terme de « roman », lui substituant sur la couverture de nombre de ses livres celui de « fiction ». Ce sont là des œuvres que l’on peut dire radicales, mais uniquement en cela qu’elles attendent du lecteur qu’il entre immédiatement en partage du poétique : qu’il soit dès le seuil du livre dans une disponibilité, une liberté et une croyance indispensables à ce partage poétique. Il m’a toujours semblé faux de dire de ces œuvres qu’elles sont intrinsèquement « difficiles » - ce qui est vrai, c’est que cette disponibilité immédiate qu’elles réclament n’est pas donnée à tous et à chacun : parce qu’elle se joue dans la langue commune où elle entre en flagrante contradiction avec les conditions sociales et politiques qui sont faites à l’écrasante majorité des individus et avec la nécessité où chacun se trouve de « tenir sa langue » dans les limites de la communication bienséante sinon servile, transparence exigée à tous les étages.
5. Rappelons tout de même que, parmi les auteurs majeurs de notre temps, plusieurs ont renoncé à la notion même de roman pour caractériser leur travail sans pour autant revendiquer la poésie comme étiquette - je songe à Pierre Guyotat, dont l’œuvre, jusque dans ses dimensions tragiques et comiques, relève bien plus de l’épopée que du roman et qui s’écrit d’ailleurs, depuis Progénitures, au moyen du verset ; je songe à Hélène Cixous qui n’emploie pas ce terme de « roman », lui substituant sur la couverture de nombre de ses livres celui de « fiction ». Ce sont là des œuvres que l’on peut dire radicales, mais uniquement en cela qu’elles attendent du lecteur qu’il entre immédiatement en partage du poétique : qu’il soit dès le seuil du livre dans une disponibilité, une liberté et une croyance indispensables à ce partage poétique. Il m’a toujours semblé faux de dire de ces œuvres qu’elles sont intrinsèquement « difficiles » - ce qui est vrai, c’est que cette disponibilité immédiate qu’elles réclament n’est pas donnée à tous et à chacun : parce qu’elle se joue dans la langue commune où elle entre en flagrante contradiction avec les conditions sociales et politiques qui sont faites à l’écrasante majorité des individus et avec la nécessité où chacun se trouve de « tenir sa langue » dans les limites de la communication bienséante sinon servile, transparence exigée à tous les étages.  A contrario, que peut-on reprocher aux maîtres du pur divertissement romanesque, sinon, au nom d’un délassement qui ne doit surtout ni dérouter ni blesser, de colmater les brèches à grand renfort de stéréotypes susceptibles de rassurer un instant le lecteur dans l’adéquation à son confort ordinaire, de participer à l’anesthésie générale des consciences à la façon exactement de toute l’industrie du spectacle ?
A contrario, que peut-on reprocher aux maîtres du pur divertissement romanesque, sinon, au nom d’un délassement qui ne doit surtout ni dérouter ni blesser, de colmater les brèches à grand renfort de stéréotypes susceptibles de rassurer un instant le lecteur dans l’adéquation à son confort ordinaire, de participer à l’anesthésie générale des consciences à la façon exactement de toute l’industrie du spectacle ?  Au plan théorique, le roman de pur divertissement et le roman littéraire s’opposent pied à pied, ils sont le contraire exactement l’un de l’autre. Toute la difficulté, c’est que cette opposition est de fait purement théorique : peut-être pourrait-on caractériser ainsi des cas extrêmes, Marc Lévy d’un côté (j’avance son nom sans l’avoir jamais lu), Marcel Proust de l’autre, mais un monde entier se déploie entre ces deux extrêmes, et il est évidemment impensable de décréter qu’une frontière existe quelque part à la surface miroitante du langage romanesque, d’autant que chaque lecteur la placerait à un endroit différent.
Au plan théorique, le roman de pur divertissement et le roman littéraire s’opposent pied à pied, ils sont le contraire exactement l’un de l’autre. Toute la difficulté, c’est que cette opposition est de fait purement théorique : peut-être pourrait-on caractériser ainsi des cas extrêmes, Marc Lévy d’un côté (j’avance son nom sans l’avoir jamais lu), Marcel Proust de l’autre, mais un monde entier se déploie entre ces deux extrêmes, et il est évidemment impensable de décréter qu’une frontière existe quelque part à la surface miroitante du langage romanesque, d’autant que chaque lecteur la placerait à un endroit différent.  6. Ce qui est posé là, c’est donc que le roman n’est pas une fin, c’est un moyen, ou un véhicule, ce qu’il a été depuis ses origines (on pourrait jouer sur les mots : un véhicule à transporter de la métaphore et donc du jeu, de la liberté dans la langue vernaculaire, c’est-à-dire, étymologiquement, dans la langue des esclaves - le latin verna désignant « l’esclave né dans la maison »).
6. Ce qui est posé là, c’est donc que le roman n’est pas une fin, c’est un moyen, ou un véhicule, ce qu’il a été depuis ses origines (on pourrait jouer sur les mots : un véhicule à transporter de la métaphore et donc du jeu, de la liberté dans la langue vernaculaire, c’est-à-dire, étymologiquement, dans la langue des esclaves - le latin verna désignant « l’esclave né dans la maison »).  Quelle que soit la réussite ou non du geste, ce qui est une autre question, il me semble que, dès lors que l’on se projette du côté de « l’art littéraire », c’est à la verticalité poétique que l’on vise, que l’on prenne pour y atteindre la voie de la poésie, du roman mais aussi bien de l’essai, en référence à Montaigne, Nietzsche ou Bataille et jusqu’à Christian Prigent aujourd’hui.
Quelle que soit la réussite ou non du geste, ce qui est une autre question, il me semble que, dès lors que l’on se projette du côté de « l’art littéraire », c’est à la verticalité poétique que l’on vise, que l’on prenne pour y atteindre la voie de la poésie, du roman mais aussi bien de l’essai, en référence à Montaigne, Nietzsche ou Bataille et jusqu’à Christian Prigent aujourd’hui.  La spécificité du roman, dès lors, peut s’appréhender ainsi : là où la poésie invite immédiatement à la verticalité et à son partage, là où l’essai tente d’y mener en l’approchant au théâtre des idées (autrement dit : par la théorie), le roman ouvre un terrain de jeu pour y entraîner le lecteur - encore faut-il ici entendre ce terme de jeu en son sens le plus fort : ouvert au tragique autant qu’à la joie, aux vraies larmes de l’enfance autant qu’à son rire, le jeu a la puissance potentielle de nous rendre à nous-mêmes en suspendant le temps socialisé des identités normatives, nous rendre à notre insu à l’enfance du monde et de la langue, et il faut une fois de plus citer Schiller affirmant que le jeu est « l’humanité même de l’homme » : « L’homme est seulement un être humain quand il joue », et ce dans la mesure où le joueur opère une « suspension » de l’expérience et de la temporalité ordinaires pour habiter le pur présent du jeu. Le joueur est au monde (du jeu), il l’est tellement qu’il l’est à son insu, dans une présence accomplie.
La spécificité du roman, dès lors, peut s’appréhender ainsi : là où la poésie invite immédiatement à la verticalité et à son partage, là où l’essai tente d’y mener en l’approchant au théâtre des idées (autrement dit : par la théorie), le roman ouvre un terrain de jeu pour y entraîner le lecteur - encore faut-il ici entendre ce terme de jeu en son sens le plus fort : ouvert au tragique autant qu’à la joie, aux vraies larmes de l’enfance autant qu’à son rire, le jeu a la puissance potentielle de nous rendre à nous-mêmes en suspendant le temps socialisé des identités normatives, nous rendre à notre insu à l’enfance du monde et de la langue, et il faut une fois de plus citer Schiller affirmant que le jeu est « l’humanité même de l’homme » : « L’homme est seulement un être humain quand il joue », et ce dans la mesure où le joueur opère une « suspension » de l’expérience et de la temporalité ordinaires pour habiter le pur présent du jeu. Le joueur est au monde (du jeu), il l’est tellement qu’il l’est à son insu, dans une présence accomplie.  Comme le jeu, le geste artistique est toujours une invitation à retrouver la toute-puissance mais aussi bien l’immédiateté de l’enfance - enfance de l’art, enfance du monde, magie de l’instant de grâce où l’homme est lui-même, entièrement, à son insu. Picasso, on le sait, n’a cessé d’y insister : « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant » ; « Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant ».
Comme le jeu, le geste artistique est toujours une invitation à retrouver la toute-puissance mais aussi bien l’immédiateté de l’enfance - enfance de l’art, enfance du monde, magie de l’instant de grâce où l’homme est lui-même, entièrement, à son insu. Picasso, on le sait, n’a cessé d’y insister : « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant » ; « Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant ».  Le roman est un moyen pour l’auteur d’abord et pour le lecteur ensuite de retrouver le chemin de traverse d’un temps qui n’a pas encore été socialisé par les sirènes d’usines et les relevés bancaires, les post de facebook et les « j’aime » élevés à la dignité des valeurs marchandes - et de retrouver ce chemin, cette voie, nulle part ailleurs que dans la langue à l’usage d’ordinaire si conventionnel et sclérosé, d’abord et avant tout utilitariste.
Le roman est un moyen pour l’auteur d’abord et pour le lecteur ensuite de retrouver le chemin de traverse d’un temps qui n’a pas encore été socialisé par les sirènes d’usines et les relevés bancaires, les post de facebook et les « j’aime » élevés à la dignité des valeurs marchandes - et de retrouver ce chemin, cette voie, nulle part ailleurs que dans la langue à l’usage d’ordinaire si conventionnel et sclérosé, d’abord et avant tout utilitariste.  Si de nos jours le roman triomphe, fort de sa capacité à restaurer du jeu, à nous prendre au jeu pour nous rendre au monde, c’est par défaut, et c’est bien là quelque chose qui devrait nous rendre terriblement humbles, lecteurs, auteurs, critiques de romans : c’est bien parce que l’individu enfermé dans des limites de plus en plus étroites dispose d’un accès de plus en plus restreint à la poésie, voué qu’il est à une solitude existentielle encore renforcée par l’univers de la communication qui prétend l’en soulager, cet univers qui est le nôtre où la langue est réduite à la communication à proportion de la réduction de l’être à sa valeur économique - un univers où l’on traite les livres exactement comme l’on traite les hommes, y compris lorsqu’on valorise les œuvres en tant qu’objets de consommation, ce qui reste une façon de les mépriser radicalement en tant qu’œuvres d’art.
Si de nos jours le roman triomphe, fort de sa capacité à restaurer du jeu, à nous prendre au jeu pour nous rendre au monde, c’est par défaut, et c’est bien là quelque chose qui devrait nous rendre terriblement humbles, lecteurs, auteurs, critiques de romans : c’est bien parce que l’individu enfermé dans des limites de plus en plus étroites dispose d’un accès de plus en plus restreint à la poésie, voué qu’il est à une solitude existentielle encore renforcée par l’univers de la communication qui prétend l’en soulager, cet univers qui est le nôtre où la langue est réduite à la communication à proportion de la réduction de l’être à sa valeur économique - un univers où l’on traite les livres exactement comme l’on traite les hommes, y compris lorsqu’on valorise les œuvres en tant qu’objets de consommation, ce qui reste une façon de les mépriser radicalement en tant qu’œuvres d’art.  Ce constat vaut pour tous, et pour l’auteur tout d’abord, qui n’échappe pas plus que quiconque à la difficulté croissante de ne pas se réduire à une surface sociale, à un potentiel économique, lui qui chaque matin fait son petit tour d’internet pour voir où nous en sommes et où lui-même s’en trouve : exactement comme autrefois le bourgeois faisait son tour du quartier jusqu’au kiosque en passant par la boulangerie ou la marchande de fleurs. Comment écrire ainsi ? Comment viser à écrire avec la foi d’un petit enfant lorsqu’on est rivé à son existence sociale, économiquement dépendant, intellectuellement asphyxié ? En empruntant la voie du roman, peut-être, pour y chercher du jeu, comme l’on dit qu’un mécanisme a du jeu, et rouvrir des brèches à la verticalité poétique, puisqu’on sait qu’elle existe, pourtant, on a beau certains jours peiner à y croire on ne peut pas complètement l’oublier (« Mais bah ! une minute où on touche le ciel qui fuit après ; en revanche ce rêve entrevu est quelque chose de plus puissant que toute matière », Paul Gauguin).
Ce constat vaut pour tous, et pour l’auteur tout d’abord, qui n’échappe pas plus que quiconque à la difficulté croissante de ne pas se réduire à une surface sociale, à un potentiel économique, lui qui chaque matin fait son petit tour d’internet pour voir où nous en sommes et où lui-même s’en trouve : exactement comme autrefois le bourgeois faisait son tour du quartier jusqu’au kiosque en passant par la boulangerie ou la marchande de fleurs. Comment écrire ainsi ? Comment viser à écrire avec la foi d’un petit enfant lorsqu’on est rivé à son existence sociale, économiquement dépendant, intellectuellement asphyxié ? En empruntant la voie du roman, peut-être, pour y chercher du jeu, comme l’on dit qu’un mécanisme a du jeu, et rouvrir des brèches à la verticalité poétique, puisqu’on sait qu’elle existe, pourtant, on a beau certains jours peiner à y croire on ne peut pas complètement l’oublier (« Mais bah ! une minute où on touche le ciel qui fuit après ; en revanche ce rêve entrevu est quelque chose de plus puissant que toute matière », Paul Gauguin).  Encore faut-il y croire soi-même, évidemment, au jeu que l’on veut ouvrir sous la forme d’un roman. Encore faut-il se mettre en jeu soi-même, et réellement. Ce n’est pas le plus simple.
Encore faut-il y croire soi-même, évidemment, au jeu que l’on veut ouvrir sous la forme d’un roman. Encore faut-il se mettre en jeu soi-même, et réellement. Ce n’est pas le plus simple.  Cela est vrai pour le lecteur aussi - et c’est la dimension politique du roman en tant que moyen de libérer tout autre chose que sa propre fiction. Je me contente ici de citer une formule étonnante et discutable mais percutante et belle d’Albert Camus, arrachée à ses carnets (au temps où il écrit L’Homme révolté : peu avant, donc, la querelle avec Sartre) : « Sens de mon œuvre : tant d’hommes sont privés de la grâce. Comment vivre sans la grâce ? Il faut bien s’y mettre et faire ce que le Christianisme n’a jamais fait : s’occuper des damnés. »
Cela est vrai pour le lecteur aussi - et c’est la dimension politique du roman en tant que moyen de libérer tout autre chose que sa propre fiction. Je me contente ici de citer une formule étonnante et discutable mais percutante et belle d’Albert Camus, arrachée à ses carnets (au temps où il écrit L’Homme révolté : peu avant, donc, la querelle avec Sartre) : « Sens de mon œuvre : tant d’hommes sont privés de la grâce. Comment vivre sans la grâce ? Il faut bien s’y mettre et faire ce que le Christianisme n’a jamais fait : s’occuper des damnés. »  Nous pouvons bien dormir sur nos deux oreilles, nous savons bien que nous ne sommes pas sortis de ce temps des damnés.
Nous pouvons bien dormir sur nos deux oreilles, nous savons bien que nous ne sommes pas sortis de ce temps des damnés.  7. Fort du pacte avec le lecteur qu’implique toute fiction, le roman propose ce qui ressemble d’abord à un ailleurs, un dehors qui peut passer pour rassurant de disposer d’un cadre dont le lecteur pense maîtriser l’usage (ne lui suffit-il pas de faire un pas au-dehors de la page pour retrouver l’univers rassurant de son quotidien ?), quand bien même ce jeu a l’ambition tout au contraire de déborder dès que faire se peut du cadre initialement fixé : de devenir existentiel, de contaminer la réalité tout entière. Le roman propose un ailleurs apparemment innocent, un très enfantin « on dirait que » pour y faire surgir enfin de l’autre débarrassé de son armure sociale - trouver de l’autre en soi et chez son lecteur, trouver de l’autre dépouillé des carapaces ordinaires d’être pris au jeu, de l’autre susceptible de réaliser l’échange véritable qu’est le geste littéraire (pas plus que la caresse, la poésie n’appartient ni à celui qui la donne, ni à celui qui la reçoit, elle n’appartient à personne : elle est, dans l’instant de l’échange. Quand il advient, l’art est toujours de l’ordre de l’échange - en littérature, le romancier comme le poète est celui qui le propose, le lecteur celui qui le réalise : qui lui donne corps de réalité).
7. Fort du pacte avec le lecteur qu’implique toute fiction, le roman propose ce qui ressemble d’abord à un ailleurs, un dehors qui peut passer pour rassurant de disposer d’un cadre dont le lecteur pense maîtriser l’usage (ne lui suffit-il pas de faire un pas au-dehors de la page pour retrouver l’univers rassurant de son quotidien ?), quand bien même ce jeu a l’ambition tout au contraire de déborder dès que faire se peut du cadre initialement fixé : de devenir existentiel, de contaminer la réalité tout entière. Le roman propose un ailleurs apparemment innocent, un très enfantin « on dirait que » pour y faire surgir enfin de l’autre débarrassé de son armure sociale - trouver de l’autre en soi et chez son lecteur, trouver de l’autre dépouillé des carapaces ordinaires d’être pris au jeu, de l’autre susceptible de réaliser l’échange véritable qu’est le geste littéraire (pas plus que la caresse, la poésie n’appartient ni à celui qui la donne, ni à celui qui la reçoit, elle n’appartient à personne : elle est, dans l’instant de l’échange. Quand il advient, l’art est toujours de l’ordre de l’échange - en littérature, le romancier comme le poète est celui qui le propose, le lecteur celui qui le réalise : qui lui donne corps de réalité).  L’espace du jeu ouvre en somme un passage - pour l’auteur tout d’abord, parce que lui-même a besoin de se remettre à croire, non pas à la vérité des personnages, mais à la vérité et à la puissance du jeu qu’il propose, croire à la possibilité que ce jeu le mènera lui le premier à partager la chance de cette sorte si particulière et précieuse d’état de grâce que peut provoquer l’instant poétique, croire qu’il est possible de rendre aux mots leur pleine puissance, qu’il est possible de retrouver l’univers magique où les mots et les choses ne sont plus séparés : où les mots sont les choses, et voyez comme je jongle le monde.
L’espace du jeu ouvre en somme un passage - pour l’auteur tout d’abord, parce que lui-même a besoin de se remettre à croire, non pas à la vérité des personnages, mais à la vérité et à la puissance du jeu qu’il propose, croire à la possibilité que ce jeu le mènera lui le premier à partager la chance de cette sorte si particulière et précieuse d’état de grâce que peut provoquer l’instant poétique, croire qu’il est possible de rendre aux mots leur pleine puissance, qu’il est possible de retrouver l’univers magique où les mots et les choses ne sont plus séparés : où les mots sont les choses, et voyez comme je jongle le monde.  Comme l’enfant qui en oublie sa faim, ses chagrins et ses terreurs, le joueur se dépouille peu à peu de tout ce qui, au quotidien des jours, le protège de la verticalité, c’est-à-dire aussi du tragique. Le jeu suspend le temps ordinaire et ordonné, le temps social, éloigne la peur où nous mène l’ignorance quant à l’avenir et donc l’angoisse, et ce faisant nous libère non seulement de nos identités sociales, mais aussi de nos masques si sérieux et éprouvants de grandes personnes. D’autres masques surgissent sous le masque, il n’y a pas « le vrai » visage qui reviendrait sous le masque, il n’y a qu’un autre masque, et encore un, et si un jour une vérité du visage devait advenir, ce serait dans la fusion de tous ces masques successifs - c’est en cela que le roman est de fait une sorte de carnaval, très particulier d’être un carnaval intime. Les masques se succèdent, les rôles se renversent, des écailles tombent, des paroles naissent, ça alors, on n’y aurait jamais songé en temps normal, parfois c’est une vraie déroute, un carnage d’idées reçues, mais salutaire.
Comme l’enfant qui en oublie sa faim, ses chagrins et ses terreurs, le joueur se dépouille peu à peu de tout ce qui, au quotidien des jours, le protège de la verticalité, c’est-à-dire aussi du tragique. Le jeu suspend le temps ordinaire et ordonné, le temps social, éloigne la peur où nous mène l’ignorance quant à l’avenir et donc l’angoisse, et ce faisant nous libère non seulement de nos identités sociales, mais aussi de nos masques si sérieux et éprouvants de grandes personnes. D’autres masques surgissent sous le masque, il n’y a pas « le vrai » visage qui reviendrait sous le masque, il n’y a qu’un autre masque, et encore un, et si un jour une vérité du visage devait advenir, ce serait dans la fusion de tous ces masques successifs - c’est en cela que le roman est de fait une sorte de carnaval, très particulier d’être un carnaval intime. Les masques se succèdent, les rôles se renversent, des écailles tombent, des paroles naissent, ça alors, on n’y aurait jamais songé en temps normal, parfois c’est une vraie déroute, un carnage d’idées reçues, mais salutaire.  8. C’est uniquement par cette dimension du jeu qu’intervient la question d’une technique romanesque. Il y avait autrefois, du temps que la poésie était socialisée, des techniques poétiques (et l’on pouvait jouer chez Molière aux Trissotin et Vadius, ergotant sur la médiocrité des vers de l’un et de l’autre), mais il n’y a pas, il n’y a jamais eu de technique littéraire : il n’y a pas de technique pour atteindre à la verticalité dans la langue, il n’y en a pas plus que pour atteindre à l’amour dans la vie - sinon à se garder de ce qui en protège au quotidien des jours.
8. C’est uniquement par cette dimension du jeu qu’intervient la question d’une technique romanesque. Il y avait autrefois, du temps que la poésie était socialisée, des techniques poétiques (et l’on pouvait jouer chez Molière aux Trissotin et Vadius, ergotant sur la médiocrité des vers de l’un et de l’autre), mais il n’y a pas, il n’y a jamais eu de technique littéraire : il n’y a pas de technique pour atteindre à la verticalité dans la langue, il n’y en a pas plus que pour atteindre à l’amour dans la vie - sinon à se garder de ce qui en protège au quotidien des jours.  Il existe une multitude de techniques romanesques, et à vrai dire il en existe presque autant de variantes qu’il existe de romans, chacun ne pouvant sauf à se perdre dans le sable des redites stériles qu’inventer les règles d’un jeu chaque fois nouveau. Affaires de construction, de rythme et de vitesse, enchâssement des voix et des niveaux de discours, ellipses, éclairages, tonalités, jeux de la narration par l’intermédiaire d’une multitude d’outils (le monologue intérieur ou le si extraordinaire discours indirect libre, pour ne citer qu’eux), etc. Cela s’apprend, ou plutôt se construit peu à peu, on apprend à faire confiance, aussi, confiance à ce qui se joue et s’invente dans la langue à notre insu, et pour ce faire à chacun ses outils et ses talismans, mais cela n’a pas tant d’importance : mieux vaut un roman bancal qui ouvre l’espace poétique qu’un roman rudement bien fichu qui le ferme. En revanche, et pour conclure sur la difficulté d’écrire un roman aujourd’hui (qui n’est ni plus ni moins grande qu’hier), un roman ne peut espérer échapper au temps dans lequel il s’écrit (à l’aveuglement de ce temps, c’est-à-dire et très littéralement à tout ce qui dans un temps donné passe pour évidences) qu’à porter, serait-ce à son insu, une pensée réellement littéraire d’avoir été déjà habitée, modelée, par d’autres en d’autres temps avant de se prolonger dans le nôtre. Rien de plus apitoyant, aujourd’hui, que ces romanciers qui prétendent que notre époque s’est libérée d’on ne sait quel terrorisme théorique, ou théorisme, et prétendent jeter aux orties tous les enjeux théoriques passés, recourant comme si de rien n’était au bon vieux narrateur omniscient, par exemple. Pour tenter de sortir de « l’ère du soupçon » par le haut, et non pas le bas, il est nécessaire d’intérioriser les problématiques du XXe siècle, au contraire : non pas pour se plier à des leçons caduques, mais pour en jouer à nouveaux frais. Prétendre en revenir au jeu romanesque d’antan, c’est tout simplement proposer un jeu mille fois joué déjà, un jeu sans surprise aucune, fait d’avance, soporifique et anesthésiant.
Il existe une multitude de techniques romanesques, et à vrai dire il en existe presque autant de variantes qu’il existe de romans, chacun ne pouvant sauf à se perdre dans le sable des redites stériles qu’inventer les règles d’un jeu chaque fois nouveau. Affaires de construction, de rythme et de vitesse, enchâssement des voix et des niveaux de discours, ellipses, éclairages, tonalités, jeux de la narration par l’intermédiaire d’une multitude d’outils (le monologue intérieur ou le si extraordinaire discours indirect libre, pour ne citer qu’eux), etc. Cela s’apprend, ou plutôt se construit peu à peu, on apprend à faire confiance, aussi, confiance à ce qui se joue et s’invente dans la langue à notre insu, et pour ce faire à chacun ses outils et ses talismans, mais cela n’a pas tant d’importance : mieux vaut un roman bancal qui ouvre l’espace poétique qu’un roman rudement bien fichu qui le ferme. En revanche, et pour conclure sur la difficulté d’écrire un roman aujourd’hui (qui n’est ni plus ni moins grande qu’hier), un roman ne peut espérer échapper au temps dans lequel il s’écrit (à l’aveuglement de ce temps, c’est-à-dire et très littéralement à tout ce qui dans un temps donné passe pour évidences) qu’à porter, serait-ce à son insu, une pensée réellement littéraire d’avoir été déjà habitée, modelée, par d’autres en d’autres temps avant de se prolonger dans le nôtre. Rien de plus apitoyant, aujourd’hui, que ces romanciers qui prétendent que notre époque s’est libérée d’on ne sait quel terrorisme théorique, ou théorisme, et prétendent jeter aux orties tous les enjeux théoriques passés, recourant comme si de rien n’était au bon vieux narrateur omniscient, par exemple. Pour tenter de sortir de « l’ère du soupçon » par le haut, et non pas le bas, il est nécessaire d’intérioriser les problématiques du XXe siècle, au contraire : non pas pour se plier à des leçons caduques, mais pour en jouer à nouveaux frais. Prétendre en revenir au jeu romanesque d’antan, c’est tout simplement proposer un jeu mille fois joué déjà, un jeu sans surprise aucune, fait d’avance, soporifique et anesthésiant. Intérioriser du mieux que l’on peut tous les enjeux majeurs du passé pour renouveler la partie, cela implique sans doute, aujourd’hui, d’admettre qu’il faut du temps, qu’il faut explorer et emprunter des parcours de long terme avant d’envisager atteindre à la possibilité du grand roman, à la splendeur en somme du grand jeu. En matière d’écriture romanesque, l’œuvre de Philip Roth me semble en cela exemplaire d’une capacité à appréhender le monde qui n’a cessé de s’élargir : élaboré à partir d’une voix singulière portant un récit ancré dans l’autobiographique via la fiction d’une séance de psychanalyse, et au bout du compte très proche de ce que l’on nomme désormais l’auto-fiction (Portnoy et son complexe), le roman selon Roth s’est peu à peu développé en préservant toujours ce noyau narratif pour y agréger des voix de plus en plus disparates et éloignées, jusqu’à prendre en charge peu ou prou l’histoire de l’Amérique tout entière, dans La Tache par exemple.
Intérioriser du mieux que l’on peut tous les enjeux majeurs du passé pour renouveler la partie, cela implique sans doute, aujourd’hui, d’admettre qu’il faut du temps, qu’il faut explorer et emprunter des parcours de long terme avant d’envisager atteindre à la possibilité du grand roman, à la splendeur en somme du grand jeu. En matière d’écriture romanesque, l’œuvre de Philip Roth me semble en cela exemplaire d’une capacité à appréhender le monde qui n’a cessé de s’élargir : élaboré à partir d’une voix singulière portant un récit ancré dans l’autobiographique via la fiction d’une séance de psychanalyse, et au bout du compte très proche de ce que l’on nomme désormais l’auto-fiction (Portnoy et son complexe), le roman selon Roth s’est peu à peu développé en préservant toujours ce noyau narratif pour y agréger des voix de plus en plus disparates et éloignées, jusqu’à prendre en charge peu ou prou l’histoire de l’Amérique tout entière, dans La Tache par exemple. C’est ce que l’on pourrait appeler ouvrir le jeu : parvenir à restituer l’illusion d’atteindre l’horizon - l’horizon du roman, un avenir.
C’est ce que l’on pourrait appeler ouvrir le jeu : parvenir à restituer l’illusion d’atteindre l’horizon - l’horizon du roman, un avenir.B.L.
1er mars 2014