La plume et la caméra
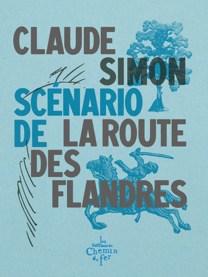
Claude Simon, Scénario de La route des Flandres
Postface de Mireille Calle-Gruber
Éditions du Chemin de fer, 2023
par Gérard Cartier.
À défaut du film, il nous reste donc le scénario. C’est un genre littéraire. Les auteurs du Nouveau Roman y ont beaucoup contribué. On sait que Robbe-Grillet a publié les ciné-romans de ses films, à commencer par L’année dernière à Marienbad ; il en est de même de Marguerite Duras. Quant à Claude Simon, rappelons que Le Jardin des plantes se termine sur un scénario « imaginaire » de La Route des Flandres, très différent de celui qui est aujourd’hui publié – dont l’écrivain, bien qu’il l’ait très soigneusement travaillé, n’entendait pas faire une œuvre littéraire. Dans sa longue postface, Mireille Calle-Gruber loue « un scénario à l’écriture somptueuse, d’une facture inédite, qui puise à la littérature le saisissement émerveillé des descriptions de tableaux vivants ainsi que la puissance onirique d’images visionnaires… ». Peut-être évoque-t-elle l’écriture du scénario dans son champ propre, celui du cinéma, plutôt que dans celui de la littérature : ce découpage, essentiellement descriptif et utilitaire, comme il se doit, ne peut évidemment pas rivaliser avec la prose somptueuse de La Route des Flandres. Il n’est pas sans intérêt pour autant, en ce qu’il met en évidence les difficultés qu’a dû affronter l’écrivain et les solutions qu’il a retenues pour transposer l’entrelacs de récits du roman et donner à son foisonnement un équivalent visuel et sonore.
Son travail mériterait une analyse détaillée. Je me contenterai ici de comparer les extraits des deux textes relatifs à une même scène – par exemple, emblématique, la mort du capitaine De Reixach dans une embuscade. La longue coulée verbale du roman :
…un moment j’ai pu le voir ainsi le bras levé brandissant cette arme inutile et dérisoire dans un geste héréditaire de statue équestre que lui avaient probablement transmis des générations de sabreurs, silhouette obscure dans le contre-jour qui le décolorait comme si son cheval et lui avaient été coulés tout ensemble dans une seule et même matière, un métal gris, le soleil miroitant un instant sur la lame nue puis le tout – homme cheval et sabre – s’écroulant d’une pièce sur le côté comme un cavalier de plomb commençant à fondre par les pieds et s’inclinant lentement d’abord puis de plus en plus vite sur le flanc, le sabre toujours tenu à bout de bras… [1]
devient cette brève notation du scénario, alors que la caméra vient de quitter un cavalier en costume de dragons 1940 pour suivre son ombre sur le bas-côté :
Brusquement une rafale de coups de feu : on voit l’ombre du cavalier lever le bras, brandissant un sabre, puis le cheval et le cavalier s’écroulent, rejoignant l’ombre (plan très bref, juste le temps de l’impression rétinienne). [2]
plan aussitôt suivi par une séquence dans laquelle la caméra, remontant du bas-côté, montre un cavalier en bicorne à plumes avançant dans le sens opposé au précédent, incarnation des « générations de sabreurs » dont est issu De Reixach. Pour restituer l’atmosphère onirique de la scène, Claude Simon a prévu de filmer non l’action, mais son ombre sur le talus. Dans le projet de film, il a plusieurs fois recours à de tels procédés de dissolution partielle de la réalité, usant pour ce faire de tous les moyens techniques à sa disposition : très gros plans, vues partielles, vues lointaines, découplages de l’image et du son, etc. Les modifications de point de vue de la caméra, tantôt extérieure à l’action (elle équivaut alors au narrateur), tantôt incarnant un personnage (« l’œil-caméra »), contribuent aussi, en troublant la perception, à s’affranchir du réalisme.
L’aspect le plus intéressant du scénario, à mon sens, est relatif à la fragmentation et au montage des scènes. Claude Simon y reprend l’une des figures de style les plus marquantes de La Route des Flandres, le glissement d’une situation à une autre sans solution de continuité : une scène commencée dans un lieu et une époque se poursuit dans un autre lieu et une autre époque, tantôt inchangée dans sa finalité, tantôt visant à une tout autre fin, comme remémorée, surgie à l’esprit en raison d’une similitude de mouvement ou de paroles, sans que le lecteur ne perçoive le moment où le récit a basculé de l’une à l’autre. Ainsi d’une page célèbre de La Route des Flandres montrant Georges prisonnier s’échapper à quatre pattes dans les taillis en haletant et se métamorphoser en une bête en rut qui tient sous lui une femme aux reins creusés [3], vision puissante qui rassemble les deux grands thèmes du roman (scène évidemment absente du projet de film). Ce procédé littéraire est transposable tel quel au cinéma – en témoigne, dans les extraits donnés plus haut, la transformation du cavalier de juin 40 en son ancêtre du XVIIIe siècle. Un procédé similaire, mais spécifique au cinéma, plusieurs fois utilisé dans le scénario, consiste à recouvrir partiellement une scène par la bande son de la suivante, simultanéité impossible en littérature, en dépit de certaines tentatives (par exemple dans Le Jardin des plantes).
Pour transformer un roman à la structure aussi complexe que La Route des Flandres en un film d’une heure et demie, il faut tailler sévèrement dans ses pages, n’en retenir que les épisodes majeurs, ceux qui participent au mouvement d’ensemble. De ce point de vue, autant que les scènes retenues, il serait instructif d’identifier celles qui ont été écartées du scénario : elles diraient quelque chose du travail du romancier qui échappe au cinéaste. L’adaptation cinémaÂtograÂphique conduit donc nécessairement à un appauvrissement du récit, que le flux d’images aurait sans doute en partie compensé, mais que le lecteur, réduit à ce canevas, ne peut que ressentir. En outre, de par sa nature même, la lecture en est plus malaisée [4] et plus désincarnée que celle d’un roman ou d’une pièce de théâtre. Cette impression de sécheresse, parfois même de schématisme, je la crois inhérente à la lecture d’un scénario – je veux dire d’un texte découpé en plans dans le seul objectif de guider le cinéaste. Je n’avais rien ressenti de tel à la lecture de La Séparation, la pièce tirée de L’Herbe, qui d’être concentrée m’avait au contraire paru gagner en force.
La publication du scénario de La Route des Flandres réjouira certainement les simonologues ; elle intéressera les simonistes, dont je suis, qui y trouveront des indications utiles sur la construction et les procédés d’écriture du roman, ainsi que les amateurs de technique cinématographique ; mais je doute que les lecteurs non avertis de l’œuvre romanesque de Claude Simon s’y plaisent beaucoup. Quoi qu’il en soit, remercions par avance Mireille Calle-Gruber de poursuivre son travail d’exhumation d’inédits et d’introuvables de Claude Simon. On attend par exemple avec impatience la republication de l’Album d’un amateur (éd. Rommerskirchen, 1988), qui outre la qualité des photographies prises par l’écrivain, souvent en lien avec ses romans, est enrichi de beaux textes, par exemple sur Proust et Dostoïevski. On aimerait aussi disposer d’un recueil de ses principaux articles et entretiens – le pendant simonien du Roi vient quand il veut de Pierre Michon. Et est-ce flatter une chimère que d’espérer la republication de ses deux premiers romans, Le Tricheur (1945) et La Corde raide (1947), aujourd’hui introuvables, que Claude Simon n’a pas voulu faire rééditer, sans pour autant les vouer aux gémonies, puisqu’ils figurent sur la liste de ses œuvres dans tous les volumes publiés de son vivant (ce qui n’est pas le cas des deux suivants, Gulliver et Le Sacre du printemps, qu’on arrive d’ailleurs encore à trouver d’occasion) ?
[1] La Route des Flandres, Œuvres, t. I, La Pléiade, p. 199.
[2] Scénario de La Route des Flandres, Générique, plan 1, p. 11.
[3] La Route des Flandres, op. cit., p. 396.
[4] Qu’il parcoure le roman ou le scénario, le lecteur tourne le film dans sa tête. Mais le romancier lui laisse une assez grande liberté pour déployer les paysages et faire évoluer les personnages dans l’espace. Dans le scénario, d’une grande minutie, cette liberté n’existe pas ; le lecteur doit se plier à une imagination extérieure qui lui dicte chaque point de vue, chaque mouvement. S’ils sont imparfaitement décrits, ce qui est inévitable, l’imagination du lecteur peut parfois contredire celle de l’auteur. Ces petites déstabilisations, assez nombreuses, troublent la lecture.