Ecritures démiurgiques 4
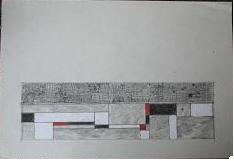
François Rastier, sémanticien, linguiste, est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, où il anime l’équipe Sémantique des textes. Il est l’un des principaux théoriciens de la linguistique de corpus, qui consiste pour l’essentiel à recentrer la linguistique sur de réelles productions langagières (orales et écrites) et non pas sur de seules constructions théoriques.
Sa revue, Texto !, en ligne depuis 1996, est une référence pour qui s’intéresse au sens des textes littéraires, entre autres à la portée et aux limites des ontologies.
Cet article a été publié dans Visio, en 2002, v. 6, n°4. Il est édité ici en cinq parties réparties en quatre semaines. Ont déjà paru Les textes combinatoires, La créature peut-elle créer ?, De la distance et donner vie Cette semaine, cinquième et denière partie, Puissance et volonté. Le dessin qui illustre cet article est de Xavier Krebs. Pour discuter de ce texte avec l’auteur, vous pouvez vous adresser à moi qui transmettrai.
5. Epilogue : Puissance et Volonté
Comment le créateur et la création se sont-ils séparés ? Pourquoi avons-nous pu opposer l’auteur sans œuvre du body art à l’œuvre sans auteur de la création virtuelle ?
Les théories classiques du processus de création ont toutes développé la division aristotélicienne entre les trois moments de l’action : dynamis (puissance), energeia (actualisation) et ergon (réalisation). La dynamis, en latin potentia, était conçue comme un éventail de possibilités, comme en témoigne encore le mot potentialité ; elle était un attribut de l’Etre, premier Moteur.
Elle connut une refonte avec l’édification du concept philosophique de Sujet, notamment par la théorie kantienne. Le sujet transcendantal partage maintes qualités de l’Etre, notamment son caractère anhistorique et conditionnant. Le dieu des Lumières étant un dieu sans incarnation, sa place devient libre pour un sujet démiurge qui excède tout kantisme. Jusqu’à Hegel, le passage de la dynamis à l’ergon était conçu comme un accomplissement, voire une perfection, comme en témoigne le mot entéléchie, forgé par Aristote et que Leibniz emploie encore en ce sens. Il était plus parfait d’être en acte qu’en puissance - et par exemple la preuve ontologique de saint Anselme est basée sur cette différence : Dieu existe en acte, car il est parfait. Dans ce dispositif, l’actualisation de la puissance dans l’acte restreint cependant les possibilités ouvertes, puisqu’elle convertit l’infini de la puissance en un acte nécessairement fini.
La contradiction entre l’absolu de la puissance et la perfection de l’acte éclate cependant dès lors que la puissance réside dans un sujet transcendantal. Comme ce sujet, inconditionné et conditionnant, partage certaines caractéristiques de l’Etre, il pourra être divinisé dans des systèmes post-kantiens ou la toute-puissance divine va se mirer dans la volonté-de-puissance humaine, potestas autocratique. Schelling, dans les Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté humaine, opère ainsi un tournant décisif : « En dernière et suprême instance, l’Etre n’est autre que la Volonté. La Volonté est l’Etre originel (Ur-sein) et s’appliquent à elle tous ses prédicats : l’absence de fondement (Grundlosichkeit), indépendance du temps, auto-assentiment (Selbstbejahung) » (Sämtliche Werke, 1860, VII, p. 350).
Apparent dès la Renaissance, quand Jules-César Scaliger nommait l’artiste alter deus, le thème du démiurge peut alors trouver son fondement métaphysique dans l’exaltation de la Volonté. De fait, le thème psychotique de la toute-puissance s’empare des créateurs : « tout ce qui advient, je le veux » (Novalis, fragment 1730). L’exaltation de la Volonté sera ensuite radicalisée par Schopenhauer puis Nietzsche.
Cependant, par sa radicalité même, la toute-puissance reste sans produit à sa mesure, et ne s’accomplit pas dans l’action, car le moi du créateur se trouve irrémédiablement séparé des choses. La séparation entre le Monde et l’Esprit, esquissée par la phénoménologie kantienne, radicalisée par la phénoménologie hégélienne dans la théorie de l’aliénation, retentit sur le rapport entre l’artiste et son oeuvre, comme en témoigne la section de la Phénoménologie de l’Esprit intitulée L’esprit devenu étranger à lui-même : la Culture. Le concept de Culture va ainsi se trouver étrangement menacé de dévalorisation, au moment même ou se forme l’esthétique moderne.
Définir la culture comme aliénation conduira à découpler non seulement l’art de la beauté, mais encore de la culture même : pour garder une vigueur et témoigner de la puissance du créateur, il devra revêtir un contenu anti-culturel. Du moins la dérision de la tradition culturelle, devenue poncif, aboutit-t-elle à des programmes de naturalisation, et Nietzsche s’écrie : « Quand aurons-nous complètement dédivinisé la nature ? Quand pourrons-nous commencer à nous naturaliser, nous les hommes » (Le Gai Savoir, § 853).
La fin de toute distance critique conduit Nietzsche à légitimer Pygmalion (Zur Genealogie der Moral, III, 6) et à rêver d’un art uniquement pour artistes. L’autocontemplation artistique devient certes la seule possibilité d’échapper à l’aliénation, mais au risque de la psychose.
Pour éviter le déchirement de l’altérité, l’artiste voudrait devenir sa propre oeuvre. Sinon, l’œuvre ne peut être qu’inachevée, sans quoi elle s’éloignerait trop de la puissance sacrale qui lui donne naissance.
Soit elle est dévaluée, soit elle dévalue, par sa perfection, son créateur ; ne pouvant alors vivre son action que comme une stigmatisation, une passion crucifiante, il parvient à cette conclusion insondable : la création ne peut avoir lieu que comme (auto-)destruction. Qu’elle reste une perte, non un accomplissement, cela signe non seulement le drame de toute action, mais l’éloignement du « métier » artistique.
En instaurant une séparation irrémédiable entre l’esprit et le monde, la théorie de l’aliénation exaspère l’opposition du principe de plaisir et du principe de réalité. Le Moi et la Réalité devenus irréconciliables, l’aliénation sanctionne l’impossibilité du couplage du sujet et de son entour : en résultent le sentiment de la toute-puissance, l’agressivité, le masochisme, puisque la volonté de puissance ne s’exerce plus que sur le soi. Elle brode alors le thème paulinien de l’abjection sublime, qui dépouillé de quelques attendus théologiques, ira du satanisme romantique jusqu’à Artaud. Seules des oeuvres infernales peuvent témoigner de l’artiste déifié ; des œuvres inachevées, de sa perfection, etc.
Ultimement, on pourra célébrer des auteurs sans œuvre (Mallarmé, Rimbaud, etc.), ou, à l’inverse, des œuvres sans auteur, comme les œuvres aléatoires.
L’œuvre ne peut plus témoigner de la Volonté essentielle de son créateur que par antinomie. La problématique de l’aliénation résulte en effet d’une dialectique antinomiste qui traduit l’opposition entre l’esprit interne et la matière externe. Hors de la théologie négative qui lui a donné naissance, elle conduit à l’inversion des valeurs, non seulement morales, mais esthétiques. Par exemple, seule la laideur de l’œuvre pourra dire la beauté de son créateur : la relève hégélienne n’est ici qu’un leurre, et l’on ne peut dépasser la beauté que dans l’insignifiance, comme on ne peut dépasser le bien et le mal que dans le crime absolu.
L’essentialisation d’un Moi tout-puissant renverse la théorie de l’action créatrice en bouleversant les rapports entre poétique et ontologie.
Alors que pour l’aristotélisme, la poiesis se définissait comme passage du non-être à l’Etre (d’ou l’idée d’accomplissement dans l’entéléchie), l’absolutisation de l’Etre comme Volonté peut induire à penser que la production fait passer de l’Etre au Non-être. En effet, si l’on reconnaît la potentia comme inconditionnée, l’œuvre doit également devenir inconditionnée, par son originalité absolue.
La théorie de l’aliénation a encore une conséquence cruciale sur la distinction entre l’œuvre et le simple produit. Pour les anciens, la différence ontologique entre praxis et poiesis redoublait une différence sociale, puisque les esclaves étaient spécialisés dans les activités pratiques. Elle est demeurée très stable, et l’on a toujours distingué les artistes des artisans, au point que les déclarations d’artistes se prétendant artisans restent un poncif de modestie affectée. Nous sommes devant une aporie esthétique : soit l’œuvre ne peut être créée, soit elle vient au jour sous la forme dégradée et dérisoire d’un produit. Dès que l’artiste devient démiurge, tous ses produits accèdent au statut oeuvres. La frontière ontologique entre oeuvre et produit ainsi effacée, le ready made fait du produit une oeuvre, quand le pop art transforme l’œuvre en produit.
Parallèlement, le ready made fait un objet unique d’un produit de série, et le pop art multiplie indéfiniment un modèle par des techniques comme la sérigraphie. Ainsi, plus encore que la Marilyn de Warhol, sa boîte de soupe Campbell reste emblématique, car ce chef d’œuvre du pop art représente précisément un ready made. Le débat sur la reproductibilité de l’œuvre d’art devient ainsi insoluble, car les frontières entre unité et multiplicité, oeuvre et produit, s’abolissent.
Combinatoires ou aléatoires, on conçoit cependant des œuvres autoreproductibles. Objectivant la volonté qui leur a donné naissance, elles paraissent inconditionnées, elles créent leur propre univers par l’infinité des parcours en leur sein. Elles réalisent, en l’inversant, la prophétie de Nietzsche définissant « le monde comme oeuvre d’art qui s’engendre elle-même » (Le Gai Savoir, § 796). Immersives, elle nous font pénétrer dans leur univers ; interactives, elle illustrent notre (bonne) volonté de puissance.
Une reconception du statut de l’art s’imposerait, pour critiquer son exaltation obscurément religieuse, de Schelling - qui en fait l’égal de l’histoire humaine - jusqu’à Heidegger. Il faudrait reconsidérer le processus de la création artistique dans le cadre d’une praxéologie qui ne place pas la source de l’action dans une Volonté assimilée à l’Etre. Or une praxéologie déliée d’un ontologie reste d’autant plus difficile à concevoir que la différence même entre théorie et pratique tient aussi à des critères ontologiques. Alors que la séparation psychotique du Moi et du Monde conduisit certains courants tardifs de l’idéalisme allemand à l’apologie de la violence théorique voire politique, cette séparation n’a aucun fondement scientifique, et traduit son inadaptation par d’inévitables rémanences dualistes au sein de l’idéalisme absolu comme du matérialisme réducteur.
Le concept biologique de couplage, élaboré depuis Üexküll, permet de reconsidérer cette séparation : en effet l’action n’est qu’un aspect, certes essentiel, du couplage de tout organisme avec son environnement.
Ce concept non seulement inverse celui d’aliénation, mais encore en supprime le substrat dualiste : en effet, d’une part le sujet ne préexiste pas au couplage, sinon par la clôture organisationnelle de l’organisme ; d’autre part, la séparation entre le Sujet et le Monde n’est aucunement posée a priori, ni renforcée par l’idéalisation qui fait correspondre le Sujet à une instance de l’Esprit. Aussi, les sujets et les objets se construisent mutuellement dans le couplage propre à l’environnement humain, éminemment socialisé, sémiotisé, culturalisé. Il est non seulement peuplé d’artefacts, qui font l’objet eux aussi d’une adaptation, et notamment des artefacts sémiotiques que sont les langues, les langages et les oeuvres, mais comprend une zone sans substrat perceptif immédiat, la zone distale, qui contient le monde imaginaire des sociétés (arts, sciences et religions). L’art, moyen de couplage avec la zone distale, ne se réduit pas à une représentation de la zone proximale, celle du « réel empirique », pas plus qu’il ne suscite les émotions liées à cette zone : il en problématise certes la perception, en créant des expériences et des sentiments nouveaux, mais surtout, il crée la zone distale et y donne accès.
Pour Hegel, l’art appartenait à la religion, et une religiosité diffuse enfume encore les conceptions contemporaines de l’art. Si l’art peut certes créer de la transcendance, s’il peut assumer la fonction d’une idole, cela ne justifie pas qu’on l’idôlatrise sans chercher à le comprendre.
Suivons donc un principe d’immanence radicale : l’art consiste en ses formes et dans les systèmes de signes, il est fait de ses oeuvres.
La zone distale contiendrait, en termes leibniziens, des mondes possibles, c’est-à-dire des mondes en puissance ou virtuels. Pour peu que l’on s’en tienne à un monisme sémiotique, pour lequel l’existence du sujet comme de l’objet se confond avec l’interprétation, non pas du monde ou de l’Esprit, mais des signes et des performances sémiotiques, ces mondes logiquement possibles sont de fait, dès lors qu’ils sont énoncés, des mondes tout aussi réels que les autres. Ainsi l’art virtuel, dans la mesure ou il abandonne les préjugés ontologiques, peut-il déployer une inlassable et réjouissante activité « ontogonique » de création de mondes.
En instaurant sa propre légalité formelle, l’œuvre d’art semble se représenter elle-même, mais comment décrire le mouvement de ses formes ?
Alors que la position hégélienne marque la faillite de la logique dialectique à penser l’évolution des formes naturelles, une théorie générale des formes naturelles et culturelles, sans faire de l’art un phénomène d’exception vaguement religieux et / ou sulfureux, pourrait prêter toute l’attention nécessaire à ses formes et à ses métamorphoses, alors même que son absolutisation avait injustement déprécié toute réflexion technique.
N.B. : Ce petit essai trouve sa source dans une intervention à une table-ronde organisée par le ministère de la Culture, au salon Imagina de Monte Carlo, en janvier 2000. Dans son élaboration ultérieure, j’ai tiré profit des interventions de Jean-Louis Boissier et de Bruno Bachimont, comme des observations ou suggestions de Louis Hébert, Sémir Badir, Mathieu Valette, Pascal Beucler, Florent Aziosmanoff, Eveline Bourion.
François Rastier