Un météore
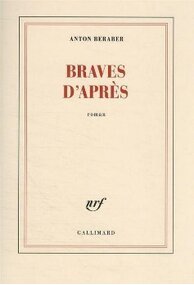
Une lecture de Braves d’après d’Anton Beraber (Gallimard, 2022), par Gérard Cartier
Les amateurs de romans à intrigue seront déçus. Il n’y a pas véritablement de récit. Après la mort du grand-père qui l’a élevé, un jeune homme tardif portant le nom étrange de Retour (retour au passé, aux temps de misère dont les Braves d’avant se sont laborieusement arrachés ?) découvre dans l’atelier du défunt, enveloppé dans un chiffon graisseux, un carnet à l’enseigne des Aerolíneas Argentinas. Les notes consignées là, avec grand tourment semble-t-il, évoquent un très vieux fait-divers. Au cours d’une partie de chasse, le 12 décembre 1966 (l’imagination ne suffit pas à circonvenir le lecteur ; il faut aussi lui communiquer l’illusion du réel : l’ancrer dans la géographie – j’y viendrai –, et l’installer dans le temps : rien de tel pour cela qu’une date), au cours d’une chasse aux canards aux environs de Maule, Yvelines, un ouvrier polonais a été criblé de petit plomb au visage et en est resté borgne. Le coupable présumé est l’arrière-grand-père de Retour, Maurice, dont la main a tracé sur le carnet, dans une prose obsessionnelle, un plaidoyer en défense tardif et maladroit. Accident, crime, ou machination fomentée par des envieux qui, on le sait, abondent dans les campagnes ? L’histoire est traitée de façon assez lâche, et même cavalière : Beraber n’y revient que de loin en loin, comme par remords, instillant un fait nouveau qui en modifie la compréhension, ne relançant la machine narrative que pour l’abandonner à nouveau – construction désinvolte qui m’a parfois fait penser à La Connaissance de la douleur de Gadda. On l’a compris, crime ou accident, l’histoire importe peu. Ce bref roman tient par autre chose. Et d’abord par le récit des choses.
La ferme familiale est située en contrebas d’une forêt traversée par l’autoroute de Normandie, à l’orée d’un village des Yvelines qui n’est désigné que par une initiale, B., au centre d’une constellation de toponymes qui permettent de le situer, surtout si l’on habite à deux pas – réalité géographique sans doute contaminée par d’autres paysages des alentours. Le récit ne sort d’ailleurs guère de la ferme du grand-père, qui va inexorablement à sa ruine, assaillie d’un côté par les convoitises du siècle (les lotissements dévorent peu à peu l’ancien parcellaire agricole), et de l’autre par la forêt, domaine des vieilles terreurs, où vivent bêtes et esprits, dont l’obscure menace est mal contenue par un mur de clôture qui s’éboule inexorablement – même l’autoroute A13 qui bruit sur la crête de la forêt semble ressortir au mythe. La propriété est en déshérence ; les bâtiments cèdent au temps, tuiles fendues, tôles qui battent au vent, et sont remplis d’un fatras proliférant de machines agricoles et d’objets incongrus qui font la joie de Beraber – et du lecteur avec lui. Le jardin lui-même est à l’abandon ; les courges pourries y voisinent avec une fosse à chiens et des manteaux enterrés…
Le principal protagoniste du roman est Retour, le jeune homme grand-orphelin, qui vit enfermé dans cette thébaïde et qui, lorsqu’il n’enquête pas sur l’accident de chasse, s’abandonne à la paresse ou à des bouffées incontrôlées d’émotions. À peine s’intéresse-t-il assez au monde pour l’épier à la jumelle. De lui, on saura peu de choses : qu’il a échoué à s’enfuir et qu’il suit de vagues études d’économie par correspondance. Son caractère velléitaire, son aquoibonisme en font la proie consentante d’un promoteur qui, le grand-père disparu, lorgne sur la propriété. Retour incarne une figure assez rare dans notre littérature, celle du renonçant. C’est une créature météoritique (Furetière : « C’est, selon les Philosophes, un mixte inconstant, muable, imparfait, qui paraît en l’air, & qui est formé de la matière des éléments, qui n’est pas transformée ; mais altérée… »), un précipité d’émotions et de souvenirs. J’ai ici une hésitation. Quoique l’auteur ne vise pas au réalisme, – son héros échappe d’ailleurs à toute détermination sociale –, celui-ci est affligé d’une personnalité trop flottante pour postuler à une véritable existence. Mais si la trame du roman est lâche, si ce héros paradoxal est en proie aux forces naturelles plus qu’à la raison, c’est peut-être aussi pour Beraber affaire de nécessité : le roman est à l’image de cette ferme à l’abandon habitée par un capharnaüm d’objets incongrus et de présences disparues – elle en est la forme subliminale.
Qu’on me pardonne un truisme – rarement vérifié : un roman vaut d’abord par l’écriture. Or, il y a dans Braves d’après des pages de pure littérature, libérées de tout souci d’intrigue romanesque ou de vérité psychologique, des pages d’une force d’expression, d’une amplitude de registre (après avoir inséré une citation latine, ressuscité l’imparfait du subjonctif ou forgé un néologisme audacieux, l’auteur n’hésite pas à recourir à un mot de patois ou à une trivialité) et d’une invention dans les images – d’une invention tout court – qui étonnent et enchantent. Dans le spectre des écritures qui comptent aujourd’hui, qui ne sont pas si nombreuses, Anton Beraber se situe quelque part entre Pierre Michon et Eugène Savitzkaya, l’un pour l’exigence, l’autre pour la fantaisie. Démonstration :
Le beau, dans l’idée du grand-père, devait toucher à ces plantes d’un autre âge qu’il achetait bien plus que de besoin, les choux amers, les rhubarbes à gros fils, les artichauts tout juste séparés du chardon dans la phylogénèse, rosissant sur la coupure, dégueulasses évidemment : botanique d’avant le Déluge dont l’hostilité affichée ne se consommait qu’au prix d’un bouillissement interminable, pas tant pour les cuire que pour y décourager une tendance génétique à la pétrification. La forêt, prise encore dans le bloc de nuit, déposait sur le tube des baromètres une haleine brunâtre et remplissait les collecteurs à pluie de loriots morts. Le beau, dans l’idée du grand-père, c’était ramasser au sol une poire à cinq heures du matin, à l’ongle retirer les œils et mordre dans la chair dure, acide, presque pas de jus, des poires de nature morte, de tombeau égyptien que Retour n’osait cracher de peur qu’une dent ne parte avec.
Quel écrivain ne serait jaloux de ces poires « de tombeau égyptien » ?