36- André des ombres, de Marie Cosnay.
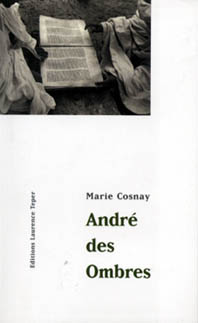
La généalogie est la querelle de Marie Cosnay, et cela dès son premier livre dont le titre, Que s’est-il passé [1], est emblématique, programmatique.
Non pas qu’il s’agisse pour elle, au terme d’une enquête, d’éclaircir des chaînes de raisons, de mettre en ordre ou d’aligner des faits et des dates, on s’en doute.
Le souci est autre : la question qui la travaille et souvent la blesse, comme il arrive aussi à chacun de nous pour peu que nous demeurions inquiets, inquiets de l’altérité, celle des autres, comme peut-être aussi la nôtre…, c’est d’interroger justement la part d’énigme où tout destin et tout être semblent s’abîmer.
Et sa méthode, sa pratique plutôt, c’est de tenter cette approche d’une manière qui jamais ne dénature l’énigme, qui, au contraire, la fasse briller comme telle.
Il faut à l’entreprise, d’une part la compassion, celle que l’héritage grec enseigne à Cosnay, s’il est vrai, comme le montre la dernière partie du livre, que l’enquête que poursuit la narratrice d’André des ombres, titre explicite, coïncide avec une descente aux Enfers, et, d’autre part, la « ferme demeurance », comme le dit Hölderlin, de qui, fidèle aux « lois du temps », ne transigera pas avec je ne sais quelle nécessité de bon sens.
Témoin, ce que dit la narratrice, dans la dernière partie du livre, et à propos de Virginie, figure essentielle du récit, première femme de son arrière grand-père André le taiseux, qui abandonne en 1914, on ne sait pourquoi ni comment, en pleine guerre, et leur fils sans prénom connu de nous, et son mari soldat, abandon qui marque le commencement de tout :
Je ne rêve plus. J’appelle. Virginie vient à l’appel. Nous devons descendre, nous passerons les morts, toutes les miennes, toutes les nôtres. Nous y sommes. Elle a gardé ses gants blancs. Cela se passe de nuit, je veille, rien ne m’effrayera, dis-je, après cela rien ne m’effrayera plus. Le chien aux multiples têtes gronde et je suis au milieu de mon âge. C’est encore un secret. Il ne faut pas parler trop haut, au cas où l’on serait entendue révélant le milieu, l’axe — médian, l’âge et ce qu’il faut parcourir encore. Virginie, elle, sait ce que veut dire laisser, revenir, nager dans les éthers et les catastrophes. Nous sommes venues pleines du désir de convaincre. Ceux d’en bas sont les ombres, ils nous écoutent, ce que je veux c’est les tâter des doigts. [2]
La narratrice d’André des Ombres écrit :
Dans chaque histoire on découvre l’accroc. Parfois il est de fortune. Parfois il bée, on tente de ravauder les plis qu’il eut, l’une à l’autre les lèvres de la plaie on tente de joindre, il faut dans un accéléré oublier le temps d’oubli, resserrer, sauter à pieds joints par-dessus la scène, à l’endroit le plus faible ou le plus crevassé sauter et prenant l’élan et prenant le souffle retenir ce qui fut, ce qui bée. [3]
Elle donne là, et les caractéristiques de la matière qu’elle travaille, ce qu’elle nomme ici l’accroc dans le tissu du réel et de l’histoire – individuelle ou collective – tissu que l’on voudrait ravauder sans pour autant le priver de ce qui bée, où se loge ce que je nommais l’énigme ; et puis aussi elle dit comment elle écrit, sa marche personnelle, le rythme de cette marche, ce que dit très clairement ici accéléré : sauts, arrêts, reprises, ressassements interminables des mêmes faits et des mêmes postures mystérieuses. Enfin, reprise du souffle.
Par moments, longues plages de rêveries méditatives, le temps arrêté, la poésie à l’œuvre.
C’est ce que j’aime dans cette écriture : brusquerie, violence, et tendresse confondues.
Voyez cet exemple.
André, après la guerre, ayant retrouvé son fils abandonné, mais non sa femme, part avec l’enfant pour travailler en Ethiopie chez un cousin imprimeur. La réalité, pour la narratrice, c’est d’abord un amoncellement de documents hétéroclites qu’elle a retrouvés et posés, en un muet désordre, sur un bureau. Impossible d’y voir rien. Et puis : je ferme mes yeux qui n’y voient pas, et la sympathie fait son œuvre.
Quelque chose qui semblait voué à la perte est sauvé.
(…) feuillets, quelques photos, fusains, ceux d’Auguste, cartes postales, Port-Saïd, Djibouti, acte de vente de l’esclave Dalix à Port-Louis, dessin minutieux de presse style Stanhope, chameaux, armes et recueil de lettres d’un autre du Harar, faisant ici commerce, après la Meuse Londres et Chypre, liste de matériel de précisions, photo de la machine cylindrique d’Alauze, dessins de la linotype, photo unique d’Albertine, posant et posée à gauche de la photo, regard évaporé, tourné sens opposé au regard d’André, et je ferme mes yeux qui n’y voient pas, découragée, saisie de peur car C’est le moment à tout instant, le cœur défaille, le pied se met à parler, le ventre se couvre de paupières, je salue avec cette même peur dont parlait ou ne parlait pas André mais dont il est possible de parler à sa place, la peur est accomplie, le ciel est rayé de fils de plumages, je regarde au miroir ce qui reste des plumages, la peur je la porte comme le trésor d’André tête haute sur la mer Rouge battant la poupe, le regard droit, probe, la main dans celle de l’autre lui-même petit plus que lui, regard sur ce qui n’est plus mais fend pourtant la coque, ni liquide, plus liquide, ni flots ni masses ni blocs, regard droit. [4]
André l’arrière grand-père n’est pas le seul héros du livre .
C’est en fait toute une histoire, toute la généalogie, donc, d’une famille, depuis la fin du 19ème siècle jusqu’au présent où la narratrice écrit, fouillant cette mémoire trouée, tronquée, dont la dramaturgie se met peu à peu en place, gardant – sauvant – ses zones d’ombre.
Avec en perspective, comme de juste, l’Histoire elle-même, celle de ces siècles dont la violence réitérée fait dire à Agamben, qu’elle nous oblige désormais à « voir le monde depuis une situation extrême, qui est devenue la règle ».
Le livre de Cosnay est en effet habité, animé, par l’écho de cette violence, celle du destin d’une famille, avec ses silences, ses hontes, ses amours et séparations, ses tendresses, ses malédictions.
Mais j’y entends aussi, outre la compassion, l’écho d’une déploration, celle de la force qui s’abat sur les hommes, les transforme en objets, comme l’écrit Simone Weil dans L’Iliade ou le poème de la force.
Voyez ce que dit Cosnay :
(…) et c’est ainsi quand foncent les bêtes, fauves et sangliers vous les prenez de face — avec le sentiment brutal de tout ce qui a tardé jusque-là, et l’odeur dans le nez qui devient groin ou tout ce que vous voulez pourvu que le nez n’y suffise plus. C’est par n’importe quelle fenêtre. Celle du ciel de Lorraine tavelé des fracas d’obus comme les sols de leurs trous et impacts (...). Par n’importe quelle fenêtre, la mort peut venir. Aujourd’hui je veux le sang. Et si le corps ne s’entaille, qu’il étouffe. Sous une forêt légendaire de pins envoyés, jetés après qu’ils ont été déracinés, balancés sur les masses rampantes au fond de fosses d’où baïonnettes se hissent, bouts, hauts de casque, où bouches se closent, gorges s’étranglent. [5]
Certes, ce genre de livres, éclatés et construits par fragments, demande beaucoup au lecteur. Monsieur Jourdain s’y agacerait, il y serait perdu peut-être, ne sachant comment abandonner toute sa science en littérature et ses convictions raisonnables ; lui ne lit que du conforme [6].
Qu’il médite ce que dit Ingeborg Bachmann dans ses Leçons de Francfort :
(…) pour l’écrivain il existe avant tout des questions qui semblent externes à la littérature ; elles semblent l’être, parce que lorsqu’on les traduit purement et simplement dans le langage, on prend conscience qu’elles sont secondaires par rapport aux problèmes littéraires avec lesquels on nous familiarise. Parfois, nous ne les remarquons même pas. Ce sont des questions destructrices, terribles dans leur simplicité ; et dans l’œuvre ou elles ne se sont pas fait jour, rien non plus ne s’est fait jour.
[1] André des ombres est paru chez Laurence Teper en décembre.
Que s’est-il passé est paru chez Cheyne éditeur en 2003.
Cosnay a aussi publié, à Cheyne, Adèle, la scène perdue (2005), chez Verdier, Villa chagrin (2006), et, chez Laurence Teper, Déplacements (2007).
A paraître ce printemps, chez Cheyne éditeur, Trois meurtres.
[2] André des ombres, p. 148.
[3] Ibidem, p. 159.
[4] Ibidem, p.70-71.
[5] Ibidem, p. 16.
[6] Notez que la couverture n’indique aucune référence à aucun genre littéraire : ni roman, ni récit. Rien. C’est un texte. « Fresque » pourrait convenir...