« il m’a tendu sa première phrase », Anne Weber
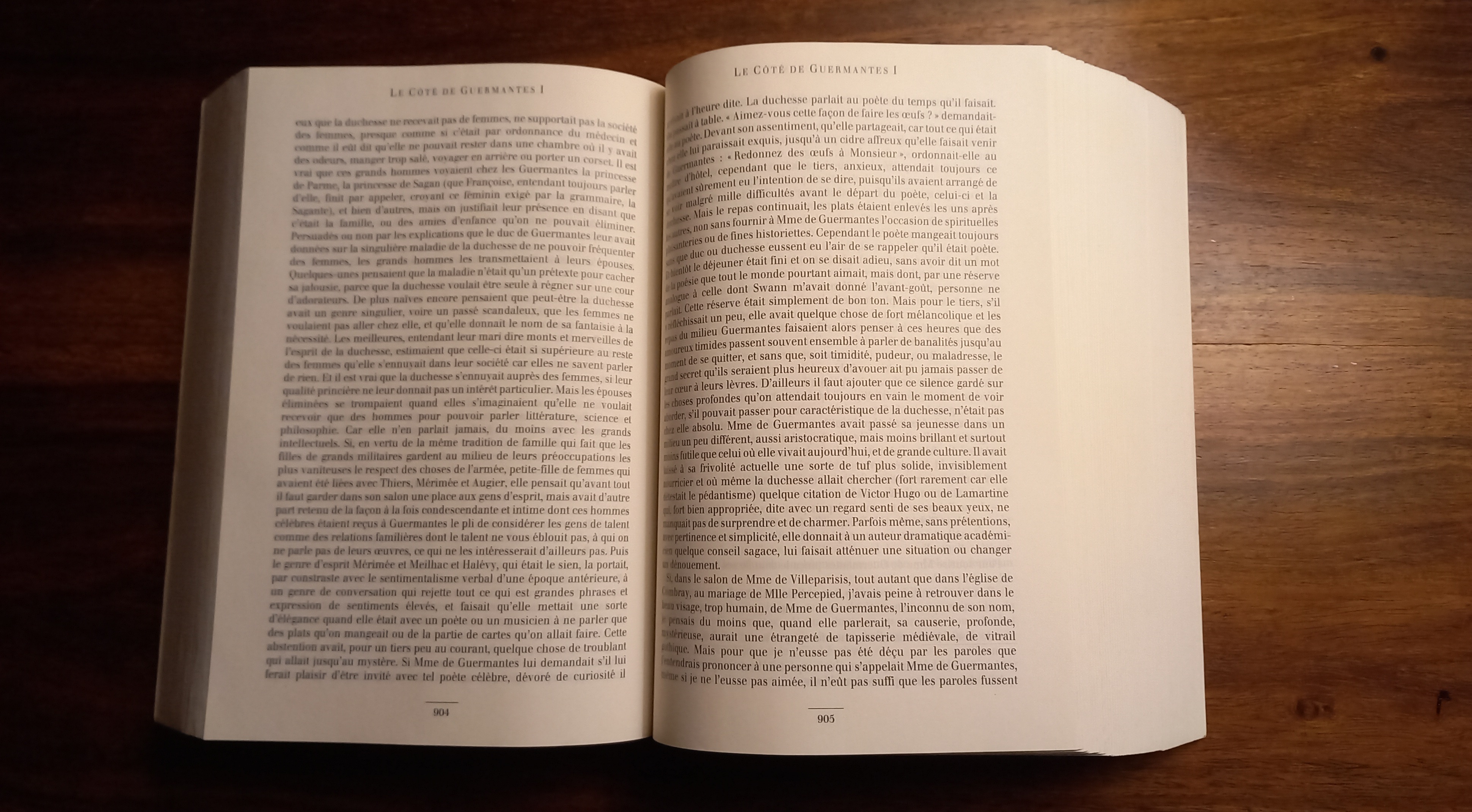
Dernier livre paru : Vallée des merveilles (Le Seuil, 2012) et sa version en allemand, Tal der Herrlichkeiten (S. Fischer Verlag, 2012), d’Anne Weber également puisqu’elle écrit chacun de ses livres dans les deux langues, et d’abord en allemand.
 Le roman — celui qu’on appelle si plaisamment en français le roman-roman — est l’objet de mon mépris et de ma fascination. Mépris, quand, encore et encore, il est le réceptacle choisi — par commodité, par bêtise, par manque d’imagination — pour déposer une histoire, un plot, une petite pelote de relations humaines tristement semblable à la plupart de celles qui l’ont précédée dans ce même format. J’ai l’impression alors d’assister à une pièce de théâtre calamiteuse et interminable, et dont les décors seuls changeraient imperceptiblement — apparition d’un lave-linge, d’un téléphone portable, d’internet : avec quelques années de retard, nous voilà obligés de revivre tout le progrès technologique. La belle affaire ! — Bien sûr, il y a des moyens formels de moderniser le récipient, de Döblin et Dos Passos jusqu’à nos jours. Reste qu’on est de plus en plus à l’étroit dans cette boîte qui pourrait bien avoir les dimensions d’un cercueil, aussi vaste qu’elle paraisse au premier coup d’œil. Quelqu’un peut-il me donner une bonne raison de nous entasser tous là-dedans, alors qu’il y a encore tant de place dehors ? Il reste à écrire des Mémoires de l’avenir et celles des chats de gouttière, la nouvelle-ciel et le poème-terre (et la pomme de terre en a assez d’être invariablement écrasée ou débitée en bâtonnets, elle est également candidate à fournir une nouvelle forme littéraire), il y a le Compte à rebours, le Conte de diablesse et le Journal d’un mort, il y a la petite Bulle de paroles qui ne demande qu’à gonfler, sans parler de la Tragédie bourgeoise pour marionnettes dont la case est presque vide encore. Alors pourquoi, pour l’amour des livres, se cantonner au sempiternel roman ?
Le roman — celui qu’on appelle si plaisamment en français le roman-roman — est l’objet de mon mépris et de ma fascination. Mépris, quand, encore et encore, il est le réceptacle choisi — par commodité, par bêtise, par manque d’imagination — pour déposer une histoire, un plot, une petite pelote de relations humaines tristement semblable à la plupart de celles qui l’ont précédée dans ce même format. J’ai l’impression alors d’assister à une pièce de théâtre calamiteuse et interminable, et dont les décors seuls changeraient imperceptiblement — apparition d’un lave-linge, d’un téléphone portable, d’internet : avec quelques années de retard, nous voilà obligés de revivre tout le progrès technologique. La belle affaire ! — Bien sûr, il y a des moyens formels de moderniser le récipient, de Döblin et Dos Passos jusqu’à nos jours. Reste qu’on est de plus en plus à l’étroit dans cette boîte qui pourrait bien avoir les dimensions d’un cercueil, aussi vaste qu’elle paraisse au premier coup d’œil. Quelqu’un peut-il me donner une bonne raison de nous entasser tous là-dedans, alors qu’il y a encore tant de place dehors ? Il reste à écrire des Mémoires de l’avenir et celles des chats de gouttière, la nouvelle-ciel et le poème-terre (et la pomme de terre en a assez d’être invariablement écrasée ou débitée en bâtonnets, elle est également candidate à fournir une nouvelle forme littéraire), il y a le Compte à rebours, le Conte de diablesse et le Journal d’un mort, il y a la petite Bulle de paroles qui ne demande qu’à gonfler, sans parler de la Tragédie bourgeoise pour marionnettes dont la case est presque vide encore. Alors pourquoi, pour l’amour des livres, se cantonner au sempiternel roman ? Le roman est l’objet de ma fascination. Et, surtout : il est à l’origine de ma consolation. Je voue en effet au roman une reconnaissance suprême. Quand j’en avais assez de mes journées redondantes, que j’étais fatiguée d’aimer et même de vivre, que le ciel était morne et si bas qu’il pesait de tout son poids sur mon front plissé, j’y ai trouvé refuge. Et j’y ai été accueillie avec une hospitalité sans faille et une inextinguible chaleur humaine. Le roman est généreux, il m’a tendu sa première phrase, tantôt une courte patte ferme, tantôt une longue main fine, et il m’a entraînée. Il a eu pitié de moi. Il m’a vue sur le bord du chemin, et il a bien compris que j’en pouvais plus, de ce monde-ci et de ses habitudes. Un quart d’heure après, je me suis retrouvée ailleurs, dans un autre univers qui, j’en conviens, était rarement plus consolant ni meilleur, mais qui toujours, toujours, toujours, avait cet avantage incomparable : je n’y étais pas.
Le roman est l’objet de ma fascination. Et, surtout : il est à l’origine de ma consolation. Je voue en effet au roman une reconnaissance suprême. Quand j’en avais assez de mes journées redondantes, que j’étais fatiguée d’aimer et même de vivre, que le ciel était morne et si bas qu’il pesait de tout son poids sur mon front plissé, j’y ai trouvé refuge. Et j’y ai été accueillie avec une hospitalité sans faille et une inextinguible chaleur humaine. Le roman est généreux, il m’a tendu sa première phrase, tantôt une courte patte ferme, tantôt une longue main fine, et il m’a entraînée. Il a eu pitié de moi. Il m’a vue sur le bord du chemin, et il a bien compris que j’en pouvais plus, de ce monde-ci et de ses habitudes. Un quart d’heure après, je me suis retrouvée ailleurs, dans un autre univers qui, j’en conviens, était rarement plus consolant ni meilleur, mais qui toujours, toujours, toujours, avait cet avantage incomparable : je n’y étais pas. On me rétorquera que le roman-roman est dépassé, que maintenant il y a Pynchon et Arno Schmidt. Très bien, très bien. Je suis admirative. Quel brio, quelle inventivité ! Mais plus personne pour vous faire oublier qui vous êtes et où vous êtes, plus personne de secourable pour vous arracher à vous-même. Je le regrette.
On me rétorquera que le roman-roman est dépassé, que maintenant il y a Pynchon et Arno Schmidt. Très bien, très bien. Je suis admirative. Quel brio, quelle inventivité ! Mais plus personne pour vous faire oublier qui vous êtes et où vous êtes, plus personne de secourable pour vous arracher à vous-même. Je le regrette.A.W.
6 février 2014