Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz
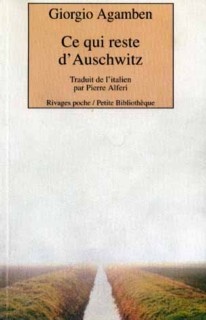
On ne sort pas indemne de ce livre de Giorgio Agamben écrit en 1998 et paru en 2003 pour l’édition de Rivages/poche dans une traduction de Pierre Alferi.
Car il traite de la question des camps d’un point de vue "philosophique" qui montre la vanité des quelques repères à quoi la conscience occidentale se raccroche pour tenter de penser ce qu’elle nomme l’inhumain, croyant par là trouver un abri, une distance, qui lui garantiraient, à elle du moins qui vient après, quelque chose comme une impunité.
Mais "philosopher" au sens d’Agamben, c’est précisément accepter de voir "le monde depuis une situation extrême, qui est devenue la règle" et qui l’est encore, s’il est vrai que les camps ont inventé un monde, et donc une origine, qui perdure.
Quel est donc le crime spécifique d’Auschwitz ? C’est d’avoir créé "un lieu où l’état d’exception coïncide parfaitement avec la règle, où la situation extrême devient le paradigme même du quotidien".
Or, concernant ce réel-là, ni les règles du droit, ni la morale - sentiment de la faute, honte - ni les références culturelles, comme celles de la tragédie grecque, ou son dépassement nietzschéen, ni même l’interprétation de l’événement comme "amor fati", ne réussiront à dire ce qui est au-delà de tout témoignage, quand le seul qui pourrait parler, celui à qui on a ôté jusqu’à la dignité de sa propre mort, et que tous nomment "le musulman", celui qui a "en charge la gestion des fours crématoires et des chambres à gaz", ne le peut plus.
Toute une première partie du livre développe ces analyses.
La dernière partie, "L’archive et le témoignage", part de la méthode de Foucault dans L’archéologie du savoir, mais c’est pour en modifier la perspective et poser la question du témoignage à nouveau : il ne s’agit plus de repérer "la marge obscure inscrite dans tout discours, qui cerne et limite toute prise de parole concrète", ni d’observer la disparition du sujet dans le murmure anonyme de "n’importe qui parle", mais de montrer comment le sujet se constitue à partir de sa "contingence", c’est-à-dire à partir de la possibilité qu’il a, ou qu’il n’a plus, "d’avoir ou de ne pas avoir la langue". Parler, c’est à chaque fois choisir la langue, à partir de cette contingence. Si l’impossibilité est là introduite de force par quelque système, alors la contingence est niée, et la possibilité de tout témoignage :
Auschwitz constitue, dans cette perspective, le moment d’une débâcle historique (...)où l’impossible s’est trouvé introduit de force dans le réel. Il est l’existence de l’impossible, la négation la plus radicale de la contingence, donc la nécessité la plus absolue. Le « musulman », produit par lui, est la catastrophe du sujet qui en résulte, sa suppression comme lieu de la contingence et son maintien comme existence de l’impossible. La définition de la politique par Goebbels - "l’art de rendre possible ce qui paraissait impossible" - prend ici tout son sens.
Cela dit, l’analyse d’Agamben va plus loin encore lorsqu’elle propose de voir, à nouveau dans un développement de la pensée de Foucault, mais cette fois-ci appliquée au bio-pouvoir, comment le système mis en place dans les camps - "cette volonté de réaliser dans un corps humain la séparation absolue du vivant et du parlant" - instaure une nécessité qui se répète de notre temps dans la "production d’une survie modulable et virtuellement infinie". En particulier "le corps en coma dépassé, le néo-mort des salles de réanimation". Elle "constitue la prestation décisive du bio-pouvoir de notre temps".
Cependant, si la langue demeure la possibilité pour un sujet d’inventer sa liberté, soit de se tenir "tendu entre dicible et indicible", alors il y a une résistance possible, dès lors qu’est encore maintenue ouverte cette chance.
Il n’est pas indifférent pour nous que, sur la fin de son livre, Agamben se tourne vers la poésie, évoquant en particulier Hölderlin.
On sait combien risque d’apparaître un truisme, ou quelque chose comme la plus fade des banalités de la bonne conscience, que de voir dans la poésie le lieu privilégié de la résistance et du témoignage.
Cependant, la page ci-après, d’Agamben, une des dernières de son livre, vient légitimer cette pensée et ouvrir un avenir...
Ouvrir un avenir ?
Du moins si les temps permettent de maintenir la tension entre le dicible et l’indicible, la possibilité de ce "reste" dans la parole qui toujours échappe à toute forme de discours et de parole : "L’autorité du témoin réside dans sa capacité de parler uniquement au nom d’une incapacité de dire."
Cette langue, où l’auteur parvient à témoigner de son incapacité à parler, est non énonçable, inarchivable. En elle coïncident une langue survivant aux sujets qui la parlent et un parlant qui reste au-delà de la langue. Elle est cette "ténèbre dense" que Levi sentait croître dans les pages de Celan comme "du bruit" ; elle est la non-langue d’Hurbinek (mass-klo, matisklo) qui n’a de place ni dans les bibliothèques du dit ni dans l’archive des énoncés. Et de même que dans le ciel observable la nuit les étoiles brillent cernées d’une épaisse ténèbre, dont les cosmologistes nous disent qu’elle témoigne du temps où elles ne brillaient pas encore, de même la parole du témoin témoigne d’un temps où il ne parlait pas encore, le témoignage de l’homme témoigne du temps où il n’était pas encore homme.