Anthony Poiraudeau | Un montage d’œuvres d’art
Projet El Pocero : dans une ville fantôme de la crise espagnole, (éditions Inculte, février 2013), journal d’avant-parution (3)
Lire la partie 1 et la partie 2 de ce journal d’avant-parution.
Un montage d’œuvres d’art
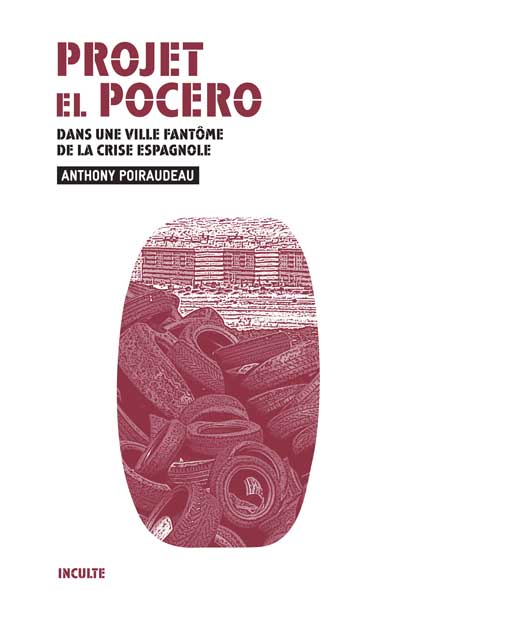
(La couverture du livre, réalisée par Yann Legendre).
D’un point de vue méthodologique, mon approche d’une écriture d’El Quiñon, la ville qui est le sujet du livre, aura d’abord été, sinon indécise, guidée par le souhait de combiner plusieurs angles d’attaque, dont l’intersection serait à la fois le livre lui-même, et un dessin possible de la ville, au travers d’une expérience que le texte ambitionne de transmettre au lecteur. N’étant pas urbaniste, ni sociologue, ni économiste, ni spécialiste d’aucune des disciplines qui permettraient de produire un essai méthodologiquement rigoureux sur cette ville, et souhaitant me situer ailleurs que dans ces champs disciplinaires, j’ai essayé de bricoler un petit piège pour tenter d’attraper textuellement quelque chose des lieux – tout me permettant de faire du livre quelque chose qui serait une tentative littéraire.
Dès le début du travail sur le livre, avant de commencer à écrire, la base projetée pour le texte était un récit de mon expérience des lieux. Je ne commencerai pas à écrire avant d’être allé sur place. Le socle du livre sera le matériau recueilli en visitant et en parcourant la ville, quel que soit la richesse ou la pauvreté de celui-ci. Avant d’être allé voir la ville, je ne sais donc pas précisément quel sera le contenu des fondations du texte.
Aux côtés de ce récit, d’autres registres de texte me semblent nécessaires : une contextualisation économique, incontournable, plus proche du genre de l’essai, et une vie de Francisco Hernando, le promoteur immobilier mégalomane à qui est due la ville (le surnom de l’homme figure dans le titre du livre : El Pocero), la vie étant un genre littéraire auquel je suis particulièrement attaché.
Ces angles d’approche sont un premier appareillage pour dérouler le fil d’une interrogation qui traverse tout le livre, tantôt de façon assez apparente, souvent en sourdine : quel est le montage imaginaire produit par la ville ? C’est certainement de cette question transversale que naîtront d’autres chapitres, de registre hybride, mélangeant le récit, des prémices et des affleurements de fiction, et quelque chose qui est de l’ordre l’association imaginaire d’images, mentales et physiques, et des notions que celles-ci semblent convoquer.
Un extrait du premier chapitre :
C’est ma première vision d’El Quiñon. Quelques instants d’ahurissement devant cette cité exhibée à l’autoroute. Au travers des vitres teintées du car, les couleurs du monde extérieur se peignent d’un aspect liquide qui ajoute au sentiment d’irréalité. Le filtre de verre vient surimprimer au paysage, comme une couche de vernis, la réplique filmée pour le cinéma qu’on peut en imaginer. El Quiñon ressemble à un avant-poste hermétique implanté sur une planète reculée, qu’on aurait chargé de tester les possibilités d’une vie urbaine à la terrienne sur ces contrées méconnues. L’imagination n’a guère à altérer les perceptions des lieux pour consentir à cette transposition outre-espace. La soudaineté du surgissement de la ville, la violence du contraste qu’elle oppose aux placides ondoiements d’herbe et de terre qui l’entourent, la radicale fermeture sur elle-même font d’El Quiñon une forme urbaine crédible pour une telle science-fiction.

Ambrogio Lorenzetti, Les Effets du bon et du mauvais gouvernement, 1338-1339, fresques, détail, "Les effets du bon gouvernement sur la campagne", Palazzo Pubblico de Sienne. (In wikimedia commons)
J’en prends conscience au cours de l’écriture que l’approche de la ville opérée par le livre est la suivante : il la considère comme une œuvre d’art, et tâche de d’y réfléchir en tant que telle. Ainsi, dans les coulisses du livre, sans que ceci figure toujours dans le texte de façon explicite, se trouve, outre des images de villes de science-fiction et de stations balnéaires hors-saison, une série d’œuvres d’art avec lesquelles la ville et son site dialoguent dans mon esprit, comme si le Residencial Francisco Hernando (un autre nom de la ville) épousait momentanément la forme et l’aspect d’autres images, selon une série de modelages plastiques ou le déroulement d’un long fondu enchaîné. La Cité idéale (ou Panneau d’Urbino) de Francesco di Giorgio Martini (une tempera sur bois du cinquecento jadis attribuée à Piero della Francesca) voisine avec Les Effets du bon et du mauvais Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti (une série de fresques peintes dans le Palazzo Pubblico de Sienne en 1338 et 1339), ainsi qu’avec la Vue et plan de Tolède du Greco, une huile sur toile peinte aux alentours de 1610. L’écriture se nourrit, aussi, de la tentative de penser la ville et ces images sur un même plan, comme si tous ces éléments formaient ensemble une même série, ou comme si les uns répondaient aux autres.

El Greco, Vue et plan de Tolède, vers 1610, huile sur toile, Musée Greco à Tolède.
Ou comme si la ville était un monument, pourvu des fonctions et des propriétés du monument plutôt que de celles de la ville, en plus de celles de ville. Là, c’est aussi dans le répertoire des arts plastiques que je trouve les points d’appui qui feront avancer ma perception des lieux, en l’occurrence, dans les œuvres et, plus encore, dans les écrits de Robert Smithson. Un artiste américain du Land Art (même s’il n’a jamais revendiqué le terme), mort en 1973, dont les œuvres monumentales étaient souvent implantées sur des sites très retirés de toute activité humaine, et dont la pensée considérait la contemporanéité prosaïque dans son implication avec la très vaste durée des cycles physiques, et géologiques, propres à la vie de la matière et à l’entropie au travail dans l’univers.

La Cité idéale : Attribué à Francesco di Giorgio Martini, entre 1450 et 1500, tempera sur bois - 60 cm x 200 cm - Galerie Nationale de la Marche à Urbino. (In wikimedia commons)
Un extrait du sixième chapitre :
Vue du sommet de la colline, plutôt qu’une maquette, la vue panoramique sur El Quiñon m’évoque une réinterprétation appauvrie, tridimensionnelle et grandeur nature de la Cité idéale, la grande peinture sur bois longtemps attribuée à Piero della Francesca. Ce tableau d’une ville imaginaire de la Renaissance italienne et El Quiñon sont une saisissante concrétisation de l’ordre géométrique, une réalisation d’un puissant désir cérébral de formes simples, rigoureusement appliqué. La ville du panneau d’Urbino, d’ailleurs, est vide de toute activité humaine postérieure à celle qui l’a bâtie, elle est un décor de théâtre sans autre drame que celui de sa propre existence désertée et muette. En revanche, si la Cité idéale figure les aspects d’une ville conçue selon des principes utopiques, le projet d’El Quiñon, malgré son isolement d’avec le reste du monde, n’a jamais été animé de telles ambitions. Sauf à estimer qu’une cité-dortoir considérant les espaces communs comme de simples vides de séparation entre les immeubles est un terrain propice à la réalisation d’une expérience politique exemplaire. Les milliers de logements vacants du Residencial Francisco Hernando offrent toutefois des locaux disponibles pour une utopie, malgré la réticence des espaces publics à permettre la vie et le sentiment collectifs.

Vue du Recidencial Francisco Hernando, mai 2012, photo Anthony Poiraudeau.