Deguy et sa légende (extrait) par Jean-Pierre Moussaron
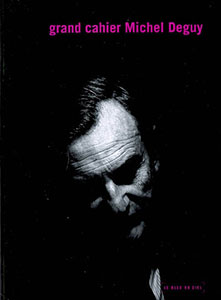
(A l’occasion de la parution de ce grand cahier, Jean-Pierre Moussaron nous a confié un large extrait de "Deguy et sa légende". Sommaire complet du grand cahier ici. On retrouve également sur remue.net le dossier Michel Deguy.[SR])
Il apparaît désormais, après tant de livres signés du nom de Michel Deguy, que l’une des plus fondamentales occupations de sa réflexion aura porté sur la question complexe de la figuration.
Au point que, en surcroît de son élucidation perpétuée au long de l’œuvre, elle se trouve, çà et là, proprement performée en l’une ou l’autre de ses figures. Notamment la comparaison, que l’on rencontre parfois mise en abyme au cours de son effectuation, lorsque le poème qui l’invente se fait aussi discours de sa production et de son fonctionnement. Tel celui-ci, extrait de Aux heures d’affluence [1], amplifiant le rayonnement analogique du « comme » jusqu’à l’universel humain, à travers une déclinaison presque exhaustive de sa parentèle lexicale :
Le commun prend en charge sans ingratitude
Sa bienveillance lève l’immunité,
partage les parts, ajoute et échange,
nomme.
Communal, son lieu n’excommunie pas la propriété,
mais la traverse, la bouleverse, la renouvelle. Au repas du
soir il se communique vulgairement par le et, par le ou, par
le comme. Le pain en commun a le goût d’un dieu
La prose par l’étymologie redonne le comme-un des mortels. [2]
Mais il faut alors souligner que la réflexion deguienne qui s’exerce sur les figures et tropes n’a, littéralement, rien à voir avec toute conception « restreinte » de la rhétorique considérant la figure comme un simple procédé stylistique facultatif, lequel interviendrait seulement par intermittence dans un texte de poésie ou de prose ; ou encore, tel un artefact mécanique plus ou moins ornemental, préposé à produire de la littérature, ou pire : de l’effet “littérature”. Pour Deguy, au contraire, la figure propose et représente le moyen logique du penser. Aussi, dans La raison poétique [3], qualifie-t-il l’affaire rhétorique d’immédiate indivision du penser et du parler en langue, signifiant par là que celle-ci détermine, y renvoyant toujours, ce qu’il nomme la nature tropologique de la pensée.
En quoi Deguy tra-duit dans notre époque la conception de la rhétorique vécue en tant que constructrice de la pensée, et pleinement illustrée par les poètes et penseurs anglais John Donne, puis William Wordsworth et Thomas De Quincey, comme l’a signifié ce dernier : « … le premier rhéteur très éminent de la littérature anglaise, c’est Donne. De manière très incohérente, le Dr Johnson le range avec Cowley, etc., sous l’appellation de Poètes Métaphysiques ; métaphysiques, ils ne l’étaient pas ; Poètes Rhétoriques aurait constitué une désignation plus précise. En disant cela, toutefois, nous devons rappeler aux lecteurs que nous revenons à l’usage originel du terme Rhétorique, en tant qu…˜il insiste principalement sur l’agencement des pensées, et de manière seulement secondaire sur les ornements du style. [4] ». Mais aussi bien Wordsworth : « Il arrive parfois que les images ne soient ni le simple vêtement étranger d’une pensée, ni de nature à être détachées de la pensée, mais qu’elles soient le coefficient qui construit absolument la pensée, parce qu’il s’ajoute à quelque chose d’autre en donnant à cette pensée une existence tierce et distincte. [5] ».
En fait, à relire aujourd’hui, dans leur vaste diachronie, la plupart des pages théoriciennes de M. Deguy, distribuées entre de multiples sujets, thèmes et enjeux, on découvre qu’elles progressent et peuvent se répartir selon le parcours successif de différents tropes, dont chacun sert, quand il n’en est pas l’objet, d’instrument et de blason momentanés à la réflexion en cours.
Par où l’on voit, en autant de jalons, que la rhétorique constitue non seulement la structuration intime de la pensée deguienne, mais aussi la plus insistante et persévérante passion de celle-ci. Si l’on veut bien, pour l’occasion, donner à cette modalité du désir le sens fort de « l’appétit » aristotélicien, faculté générique qui meut les êtres, et, spécialement, de « l’appétit rationnel », qui se confond avec la volonté éclairée parce que réfléchie. Autrement dit, traversant l’entière ampleur du dis-cours propre à Deguy, la question de la figuration rhétorique pourrait elle-même figurer comme le « trait unaire » (Lacan) de son être pensant dispersé entre tant de pages.
Ce pourquoi on peut tenter d’en esquisser brièvement la “chrono-logie”, en remarquant d’abord qu’il s’agit moins, ici, de repérer la première apparition d’une figure, que sa mise en valeur dans la réflexion deguienne, lorsqu’elle atteint en celle-ci suffisamment de concrétion symbolique pour la susciter.
Sur fond de « transmétaphoricité » œuvrant déjà à l’initiale de ce parcours, se détache bientôt la tautégorie, que Deguy procure à la rhétorique moderne en empruntant le terme à Schelling. Grâce à laquelle un poème peut être lu comme la métaphore de lui-même, selon une manière de se dire aussi à lui-même ce qu’il est, à travers ce qu’il dit explicitement de ce qui est autre que lui [6] ». Soit un singulier effet d’autoréférence, produisant une forme insolite de redoublement du discours, puisqu’elle aboutit au dédoublement de ce dernier entre son dire et son faire.
Mais, discernant déjà le double danger de la métaphore : conceptuel, quant à l’identification qu’elle radicalise, et politique, quant à la tentation identitaire qu’elle favorise, Deguy choisit de se consacrer, jusqu’aujourd’hui encore, à la comparaison. Précieuse figure pour sa délimitation, car, fruit d’une analogie explicite déterminée par son « motif » (ou « ground », comme disent les rhétoriciens anglo-américains), elle produit l’affinité poétique en maintenant la distance, i. e. la différence, entre les objets comparés, et sauvegarde ainsi leur qualité propre, et donc incomparable, qui s’y implique ou s’y exprime.
Dès lors, se forment les notions connexes de configuration, et de comparution des étants (puisque l’on conçoit mal la possibilité d’un étant isolé). On traverse ainsi Donnant donnant, Brevets, Choses de la poésie et affaire culturelle [7], série d’ouvrages théoriques et pluriels, où s’instruit aussi la pensée de l’allégorie. Deguy y voit une possibilité capitale d’approximation, puisque, disant une chose, elle en dit en même temps une autre, et donc invente une voix pour cette autre chose à dire ; révélant, de ce fait, sa qualité de vérité « naissante » , ce qu’il souligne dans L’Énergie du désespoir ; et qu’il développe ainsi, plus tard, dans L’Impair [8] :
… l’allégorie est, littéralement, un « autrement dit ». Par là, je veux dire que la possibilité de dire autrement les choses, de proposer un « autrement » doit être fournie par un poème. Le vers doit pouvoir dire autre chose. Comment, sans cela, ma perception et mon vécu (ma « circonstance » mon expérience) pourrait-elle intéresser ; intéresser ces autres, si je ne leur donnais à entendre autrement dans leur vie, à l’interpréter comme on dit, autrement dit à la citer à leur usage dans le contexte de leurs circonstances. [9]
Bientôt, ces diverses figures d’affinité rapprochante tendent à s’élargir. Ainsi, La poésie n’est pas seule [10] conduit l’hyperbate — cette forme extensible d’adjonction de mots et notions dans une assertion paraissant close, et, donc, possibilité d’enchaînements supplémentaires — sur le devant de la scène rhétorique. Ensuite, d’Arrêts fréquents [11] et Aux heures d’affluence à L’Énergie du désespoir, on voit en quelque sorte le rapprochement se tourner vers les contraires, grâce à l’oxymore. Lequel reprend à nouveaux frais la poursuite de telle ou telle vérité poétique sur la trace de l’allégorie. En effet, puisque la vérité, toujours multiple et plurivoque, repose sur la contrariété de positions adverses, l’oxymore, ou ce que Deguy nomme plus finement le paradoxe oxymorisé, ou encore l’oxymorisation paroxystique, peut approcher poétiquement celle-ci, en opérant la jointure des opposés par la méthode de renforcement simultané des extrêmes adverses complémentaires [12].
Voici un remarquable exemple actuel de la manière dont Deguy fait jouer, à travers tout un déploiement logique, cette nouvelle figure de « contrariété paradoxale » qu’il nous propose :
L’homme existe de deux façons (matière en deux « états » ? substance sous deux « modes » ?). D’une part un-par-un, au singulier, en individu, en ousia prôtê kaï deutera, dirai-je à Pachet traducteur des penseurs grecs, ici dans la terminologie catégoriale d’Aristote, apte à distinguer en chacun celui-ci (« Socrate ») et son humanité (la « forme entière de l’humaine condition », dirait Montaigne). Et d’autre part au pluriel, en « Grand-Nombre », en multitude dans le lexique de Negri ; « grégairement », disait-on naguère. Or cette grégarité de oï polloï n’est pas la somme, en un-plus-un-plus-un, d’une petite « grégarité » qui serait le « caractère » commun à chaque-un additionné de sorte qu’il y en ait davantage dans un groupe de mille que dans un groupe de dix. Mais le fait du multiple en acte, ou « masse ». // Il me semble que ne pas d’abord distinguer « eidétiquement » ces deux états de l’humanité, pour ensuite les prendre ensemble c’est-à-dire manœuvrer toute opération de l’intelligence en articulant les deux, conjuguant leur contrariété, c’est risquer de ne pas comprendre les choses (Principe : distinction analytique des intelligibles « ingrédiant » (Whitehead) une situation, en vue de penser (et organiser) une (re)composition par contrariété paradoxale, conjugaison des contraires majeurs, ou « extrêmes », ou « pôles », et non pas comme mélange, mixture de mixages, « métissages » syncrétiques, etc). [13]
Vient, encore, la prosopopée ici resongée. Mais, introduisant l’absent dans le présent du discours au point de frôler l’hallucination, cette étrange figure s’est manifestée plus tôt dans le corpus deguien : aux dernières pages de À ce qui n’en finit pas [14] : Il faut de la prosopopée pour faire de la réciprocité. Il faut donner un visage et une parole à ce qui n’en a pas, ou pas assez.
Précisément — et cela ne semble point un hasard — en un livre issu du deuil, qui, conçu face à l’effraction de la mort et déplorant la perte de l’être aimé à la façon d’un « thrène » antique, hausse sa pensée vers les plus pressantes questions de l’existence, de l’art et du monde. Jusqu’à réinventer, après le Baudelaire du Spleen de Paris, en une forme de prose excédant tout récit et tout poème, composée de fragments détachés et non paginés, une sorte de lyrisme de la douleur. Soit aussi la douleur même du lyrisme, aujourd’hui, en son espacement, sa cassure, sa distance, voire son éloignement. Soit encore, comme on disait autrefois « leçon de ténèbres », une leçon de douleur. Au sens intense et fondateur donné à ce dernier terme par Heidegger dans « La parole », premier chapitre de L’acheminement vers la parole : « Mais qu’est ce que la douleur ? La douleur déchire. Elle est le déchirement. Mais elle ne déchire pas en lambeaux éparpillés. La douleur disjoint assurément, elle distingue, mais de telle sorte que du même coup elle tire tout à soi, rassemble tout en soi. […] La douleur est ce qui joint dans le déchirement qui distingue et rassemble. La douleur est la jointure du déchirement » [15]. De fait, la disjonction du discours et la désarticulation des fragments qu’ajointe ce livre peuvent figurer, aussi, le déchirement du sujet qui l’écrit — tautégorie du dit dans le dire —, puisque, en cette logique de l’algos, la texture du texte mime ce qu’il énonce.
D’où s’institue une méditation continuée qui, liant intimement vie, poésie et pensée, n’aura cessé de “refaçonner” l’être deguien (i. e. l’homme, sa poièse, et son paraphe), comme le fait entendre ce récent poème, s’abîmant, peu à peu, dans la sobriété requise d’une prose désolée :
Dix ans ont passé
Aucun jour ne passe, peut-être aucune heure, sans
que, par ce qu’on appelle la pensée, je me tourne
vers Monique. La pensée, c’est la mémoire, mais
c’est aussi l’envisagement du présent, l’invention de
l’imminence.
La tristesse ne m’a plus jamais quitté.
Ce terrible plus jamais croissant avec les années ; qui
nous endeuille de plus en plus ; le plus jamais de
l’âge qui s’éloigne.
Et en même temps — nous le savons tous, nous mes
amis qui sommes un par un endeuillés, c’est-à-dire en
deuil, faits de, et en, deuil — c’est ce que nous avons de
plus cher, le secret où nous sommes une ipséité, là où
le sujet, comme on le nomme, se recueille dans l’être-
avec-soi-même. Le poète autrichien Georg Trakl disait :
c’est la douleur qui creuse l’intériorité ; qui fraye le
dedans ; sans elle, il n’y a pas de vie intérieure où
demeurer. [16]
Si bien que le langage lui-même peut s’emparer, à tout moment, du poète. C’est ce que le narrateur de Boris Pasternak nomme « l’inspiration », dont il décrit le processus en cours chez son héros, Iouri Andréiévitch [17], : « Après deux ou trois strophes qui coulèrent facilement et quelques comparaisons qui l’étonnèrent lui-même, il fut pris tout entier par son travail et sentit l’approche de ce que l’on appelle l’inspiration. Le rapport des forces qui régissent la création paraît alors se renverser. Ce qui reçoit la priorité, ce n’est plus l’homme et l’état d’âme auquel il cherche à donner une expression, mais le langage par lequel il veut l’exprimer. Le langage, patrie et réceptacle de la beauté et du sens, se met lui-même à penser et à parler pour l’homme, et devient tout entier musique, non par sa résonance extérieure et sensible, mais par l’impétuosité et la puissance de son mouvement intérieur. Pareil alors à la masse roulante d’un fleuve dont le courant polit les pierres du fond et actionne les roues des moulins, le flux du langage, de lui-même et par ses propres lois, crée en chemin, et comme au passage, la mesure, la rime et mille autres formes, mille autres figures encore plus importantes, mais jusqu’ici inconnues, inexplorées et sans nom. // Dans ces moments-là, Iouri Andréievitch sentait que ce n’était pas lui qui faisait l’essentiel de son travail, mais quelque chose de plus haut qui le dominait et le dirigeait : l’état de la poésie et de la pensée universelles, leur avenir, le pas que devait accomplir maintenant leur développement historique. Et il sentait qu’il n’était que le prétexte et le point d’appui de ce mouvement ».
Enfin, dans la continuité du rapprochement que je viens d’ébaucher entre rhétorique et logique, suivant le très long cours de cette œuvre, L’Impair amène l’hypallage :
Le secret du poème (un des secrets du secret du poème) c’est l’hypallage [18] — qui est comme un peu moins qu’une comparaison […] C’est un échange court, un service de proximité, une reconnaissance « symbolique » par l’échange ; un procédé de bon voisinage, une manière d’être bien ensemble. [19]
Finalement, si puissante perdure et s’avance la passion de M. Deguy pour la rhétorique, qu’elle se fait, en son œuvre, patience, “pathein” et pensée de la pensée même. À juste titre. Car la pensée n’est-elle pas, en chacun de nous, la possibilité inaugurale de se figurer les êtres et les choses ?
Ce pourquoi, aussi, on peut, à l’encontre de tant de dénis actuels, affirmer que, irremplaçable précipité de figures (au triple sens, dirai-je, de dépôt inventif, de mixité et d’accélération), la poésie pense. Non pas intransitivement puisqu’elle vise toujours un objet de circonstance, mais constamment.
Jean-Pierre Moussaron
[1] Le Seuil, Paris, 1993, p. 54-55.
[2] Autrement scandée et disposée sur la page, une première version de ce poème apparaît dans le recueil collectif, L’Hexaméron (Le Seuil, Paris, 1990, p. 29) réunissant, outre ceux de Michel Deguy, des textes de Michel Chaillou, Florence Delay, Natacha Michel, Denis Roche et Jacques Roubaud.
[3] Galilée, Paris, 2000, p. 167, et 157.
[4] Thomas De Quincey : La Rhétorique, dans Essais sur la rhétorique, le langage, le style, traduits par É. Dayre, José Corti, Paris, 2004, p. 39.
[5] Extrait de l’Essai sur les Épitaphes, cité par le traducteur du même ouvrage, dans sa dense préface, « Idéale Rhétorique », p. 13.
[6] Extrait de l’article « Vers une théorie de la figure généralisée », publié dans Critique, n° 269, d’octobre 1969, Minuit, Paris, p. 858-859.
[7] Respectivement : DD, Gallimard, Paris, 1981 ; B, Champ Vallon, Seyssel, 1986 ; CPAC, Hachette, Paris, 1986.
[8] PUF, Paris, 1998, p. 91 ; Farrago, Tours, 2001.
[9] p. 74.
[10] Le Seuil, Paris, 1988.
[11] Métaillié, Paris, 1990.
[12] Cette dernière formulation se lit dans le bref ouvrage du même auteur, Spleen de Paris, Galilée, Paris, 2001, p. 30.
[13] Extrait de « Fumer — ne pas fumer. La discussion avec Pachet », dans le n° 702 de Critique, novembre 2005, Minuit, Paris, p. 841-842..
[14] Le Seuil, Paris, 1995.
[15] Trad. F. Fédier, Gallimard, Paris, 1976, p. 30 et seq.
[16] Deuxième poème du bref recueil privé, non paginé, à tirage limité, L’amour et la vie d’une femme, Le Bleu du Ciel, Bordeaux, 2004.
[17] Dans Le docteur Jivago, sans nom de traducteur, Gallimard, Paris, 1958, p. 521.
[18] À propos de cette figure, je rappelle, outre la définition qu’il en donne, le riche commentaire de Du Marsais, dont voici deux extraits : « Cette figure est bien malheureuse. Les rhéteurs disent que c’est aux grammairiens à en parler ï ›…ï et les grammairiens la renvoient aux rhéteurs. ï ›…ï Après tout, dans quelque rang qu’on juge à propos de placer l’hypallage, il est certain que c’est une figure très remarquable. // Souvent la vivacité de l’imagination nous fait parler de manière que, quand nous venons ensuite à considérer de sang-froid l’arrangement dans lequel nous avons construit les mots dont nous nous sommes servis, nous trouvons que nous nous sommes écartés de l’ordre naturel, et de la manière dont les autres hommes construisent les mots quand ils veulent exprimer la même pensée ; c’est un manque d’exactitude dans les modernes ; mais les langues anciennes autorisent souvent ces transpositions. Ainsi, dans les anciens, la transposition dont nous parlons est une figure respectable, qu’on appelle hypallage, c’est-à-dire changement, transposition, ou renversement de construction. Le besoin d’une certaine mesure dans les vers a souvent obligé les anciens poètes d’avoir recours à ces façons de parler ; il faut convenir qu’elles ont quelquefois de la grâce : aussi les a-t-on élevées à la dignité d’expressions figurées », Le Traité des Tropes (1730), réédité par les soins d’André Dalmas, d’après l’édition de 1842, dans le cahier 15-16 du Nouveau Commerce, Paris, 1970, p. 154.
[19] p. 77.