La nuit du second tour d’Eric Pessan. Une traversée du désastre
La nuit du second tour, une traversée du désastre
L’œuvre d’Eric Pessan dessine les liens secrets de l’intime. Souvent ses livres explorent les tremblements intimes, ceux qui font basculer les vies sur des chemins incertains, arides ou violents, à la rencontre de soi, de son passé, de son enfance. On se souvient de la jeune fille de Muette (Albin Michel, 2013) s’arrachant de la violence du monde pour se trouver face à l’extraordinaire incertitude de soi, au milieu de l’étrangeté de la nature que l’on retrouve dans La Hante (L’Atelier contemporain, 2015) dans N (Les Inaperçus, 2012). L’enfance ne cesse de traverser l’œuvre de Pessan, non seulement parce qu’il écrit des livres qu’on estampille « jeunesse » mais aussi parce que l’enfance et l’adolescence traversent ses livres, y compris lorsqu’il écrit sur Shining de Stephen King dans l’essai ôter les masques (Cécile Defaut, 2012). Dans le roman Le démon avance toujours en ligne droite (Albin Michel 2015), c’est une hantise cachée de l’enfance qui oblige le personnage David à se précipiter dans les incertitudes du passé paternel, à Lisbonne. Eric Pessan mesure toujours l’impact des dérèglements sur nos existences, notre intimité et nos trajectoires : c’est l’homme qui se couche pour ne plus se relever dans Chambre avec Gisant (La Différence, 2002), c’est la nuit silencieuse et les souvenirs qui nouent l’attente et lient peut-être les êtres dans ce train immobile d’Incident de personne (Albin Michel, 2010).
Dans La nuit du second tour(Albin Michel, 2017), un homme et une femme, séparés par un océan, affrontent les bruits de l’époque, la violence d’une nuit d’élection pour retrouver quelques fragments d’une intimité perdue.
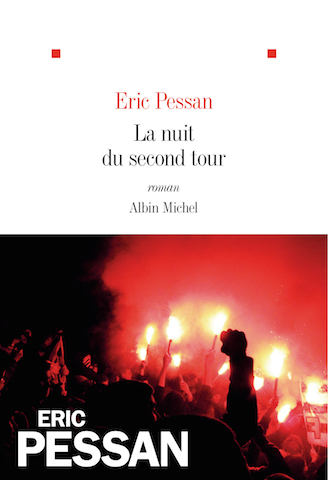
Ceci n’est pas un traité politique
Dans La nuit du second tour le lecteur semble être invité à découvrir un récit de politique fiction. En effet, le livre s’ouvre sur un soir d’élection présidentielle française qui voit l’arrivée au pouvoir de la frange la plus extrémiste de la politique française. Elle n’est jamais nommée, seulement suggérée par ceux qui décident de résister par des « chansons antifascistes » (p. 13) ou « des orchestres qui jouent Le Temps des cerises ou L’International » (p. 14) et d’autres qui mettent aussi fort que possible les Bérurier noir.
Une ville s’embrase. Elle n’est jamais nommée. Aucun indice pour satisfaire une géographie, c’est n’importe quelle ville traversée par une rivière. C’est donc une vie quelconque qui s’embrase :
« A quelques rues vers la gauche, ça barde. Les cris sont devenus des huées, des gens courent, des détonations retentissent. La déception, la colère, l’envie de justice ou la frustration engendrent la violence. Ceux qui scandent dans la rue ne regardent pas plus à la dépense que ceux qui répliquent derrière leurs boucliers de plexiglas : des projectiles volent, des salves répondent. » (51)
Tout au long roman, la violence enfle et se dilate autour du personnage de David, le romancier insistant sur la dimension virale de cette violence : « Et la nuit n’en finit pas de bruire de cris et de détresses. La maladie a infecté la ville. C’est la nuit de la grande contagion généralisée. Attaquée par un virus, l’organisme élève sa température en dernier recours. La fièvre est le symptôme d’une maladie qui a empoisonné chaque habitant du pays. » (75)
Ce qu’Eric Pessan décrit, c’est une « ville blessée » où se mêlent désormais voitures brulées, groupes d’émeutiers, police, lacrymogènes et matraques, cocktails Molotov, gyrophares, explosions, pétards ou coups de feux.
Comment traduire le flux et l’ampleur de ce désastre ? Outre l’amplification de l’embrasement urbain au fil de l’errance de David, Eric Pessan ponctue son livre de trois courts chapitres reposant sur le même dispositif : une phrase répétée mais l’anaphore se disloque à mesure que le récit avance : « Il y a le feu sur la terre » (11), « Au même moment, il y a le feu sur la terre » (97) « Alors qu’il y a le feu sur la terre ». Jouant sur la variation, la répétition crée un effet de distance, les locutions conjonctives ou nominales, loin de confirmer la répétition s’en écartent, ou plus exactement, en écartent la narration et les personnages. D’autre part, ces chapitres nous mettent face au bruit du monde, aux réactions de chacun, Eric Pessan choisissant la parataxe avec de courts fragments sans point, créant un dialogue infini entre les paroles arrachées du réel et du flux.
Ce dont nous parle Eric Pessan, au milieu de l’effondrement démocratique prévisible, c’est d’une autre catastrophe, mais l’une n’excluant pas l’autre.
« La catastrophe se déploie lentement, elle est intime, insidieuse, elle s’installe par petites touches et métastase le présent. La catastrophe n’envoie pas bouler les immeubles à grand renfort d’effets spéciaux, elle est une plume qui s’ajoute au poids d’une autre plume qui s’ajoute à celui d’une autre plume ; et ainsi de suite depuis des années. La catastrophe avance comme poussent les ongles ou les cheveux. Le processus est invisible à l’œil nu. » (113).
De l’analyse politique à la description d’une mécanique intime, il n’y a parfois pas de différence.
Le désastre intérieur
La nuit du second tour est le récit de deux solitudes, l’histoire de deux êtres qui n’ont pas su s’aimer et se sont séparés. David et Mina errent dans leur propre existence, sans véritable but ni intention, chacun à leur manière. Ils sont là, au bord d’eux-mêmes et de la cassure intérieur. Après leur séparation, Mina est retournée vivre chez ses parents, entre la folie du père et la soumission de la mère. David continue d’aller au travail, de porter le même costume-uniforme. Alors que Mina décide de réagir, David s’enfonce dans sa propre idiotie. Mina cherche à empêcher la « pétrification » (61) et part sur un cargo vers les Antilles. Elle est au milieu de l’océan la nuit du second tour. David est au cœur de la ville qui s’embrase la nuit du second tour. Tout semble les opposer, la mouvance liquide de l’une, la dureté des pierres et la violence des flammes de l’autre. L’une traverse les ponts au milieu du roulis et des attentions du capitaine du bateau, l’autre est projeté dans une ville qui le dépouille et le rejette.
Comment retrouver l’intimité et le temps de soi par gros temps, entre la tempête océanique et celle politique ? Entre l’errance de David et la traversée de Mina, il y a deux trajectoires qui permettent de retrouver l’instant de soi. C’est au prix de l’écart et du dénuement que les personnages peuvent envisager de communiquer avec le monde extérieur et tenter d’explorer leurs propres sentiments perdus. Peut-être est-ce là la clé du politique, retrouver lucidement les termes de son intimité.
Le traitement des outils de la communication dans le roman est de ce point de vue assez significatif. Les téléphones mobiles ont un rôle symbolique. Les deux personnages retrouvent ce temps de soi en dehors des outils de communication (la batterie du téléphone de David est à plat et Mina est au milieu de l’océan, absente de tout réseau). Mais ce temps de déprise n’est pas érigé en modèle ou en dogme de comportement. Il permet de retrouver ses propres sentiments et son désir. Il permet aussi de trouver le courage d’envoyer un sms qui rendra possible un dialogue nouveau (celui de David p. 94, celui de Mina p.143).
La traversée
La nuit du second tour est le temps d’une déprise. David se retrouve démuni, vide et vidé de tout. Mina est dans un univers dans lequel elle n’a qu’une place de spectatrice, à peine celui de lectrice.
David se retrouve donc au milieu du tumulte. Sortant d’un cinéma, il retrouve sa voiture brûlée. Il n’a plus rien, plus de papiers, plus d’ordinateur de travail, plus de carte bancaire. Il lui reste quelques pièces de monnaie pour rentrer à pied. C’est pour lui une longue odyssée. Comme Ulysse, il est constamment freiné dans son désir de retour. Comme le personnage d’Homère, ou comme Paul Hackett, le personnage de After Hours (1986) de Martin Scorsese, David traverse les dangers de la ville, rencontre des personnages étranges et dangereux, curieux ou amicaux (des clochards hargneux, des errants, des groupes violents, des punks paumés, un couple qui danse, une femme attentive qui s’appelle Carole). Plus il avance et court dans la ville furieuse, plus il se perd, plus il perd son identité sociale, celle à laquelle il s’accroche le plus : son costume se délite progressivement. De l’accroc (64) au pantalon déchiré (104), de la blessure à la veste donnée, David se défait de tout, petit à petit et commence à claudiquer. En s’enfonçant dans le désastre du monde, David plonge un petit peu plus loin au fond de son désastre intérieur :
« Incapable de savoir quand il a glissé, David se retrouve le cul par terre, assis, les jambes écartés. Il n’a plus mal, il est secoué d’un rire gigantesque. Il est ivre sans avoir bu. La mue est douloureuse pense-t-il, et il rit de plus belle. Il se relève et reprend sa route, les yeux au ciel, espérant une aube qui ne vient pas. » (135) Il n’est d’ailleurs pas surprenant que cette mue de David soit suivie d’un appel à l’énergie de l’enfance : « David veut être l’enfant qui pique sa crise sous le regard noir des adultes, il veut être déraisonnable, impulsif, humain, vivant. » (136)
Mina, elle, traverse l’océan et d’autres tumultes, ceux du mal de mer et de l’impossibilité de trouver une place. L’océan est un espace réel et métaphorique, celui du trop. Ce qu’elle traverse, c’est un délestage progressif.
« A bord du porte-conteneurs, l’environnement résiste. Et ça résiste en elle. Ca reste coincé, son attention n’arrive pas à se fixer. Trop de choses, trop d’émotions, trop de nouveautés, trop de voix qui lui expliquent ce qu’est un bateau, trop de violence dans le résultat des élections, trop de douleur en elle, Mina est victime d’une embouteillage de sensations. » (58). Si le récit pose les chemins séparés des deux personnages, les phrases tissent de curieux liens souterrains, comme cette métaphore urbaine pour caractériser l’état d’esprit de Mina au milieu de l’océan.
La nuit du second tour ne se termine pas par des retrouvailles, ni par des lendemains qui chantent. Mais comme ce roman n’est pas un traité politique qui scruterait seulement la structure du désastre, le roman s’achève par une ouverture. Le monde ne s’achève pas, il y a un lendemain, une résistance à penser, à anticiper peut-être. Il y aurait alors des retrouvailles possibles après la traversée de la nuit. Il y aurait à entendre les mots de cette femme croisée par David au terme de son odyssée et de son dénuement : « Prenez soin de vous » lui dit-elle (153). Prendre soin serait peut-être le premier geste politique de résistance face aux extrêmes. Sans doute est-ce là le discours politique du roman d’Eric Pessan, celui qui lui permet de terminer son livre par l’idée de « vivre dans l’espoir ».