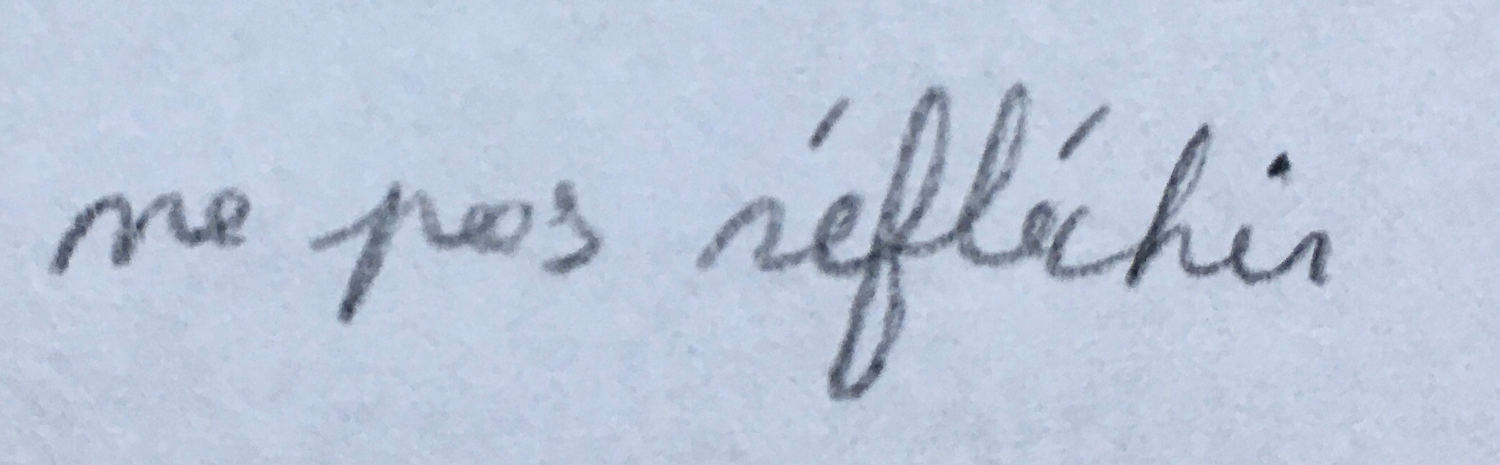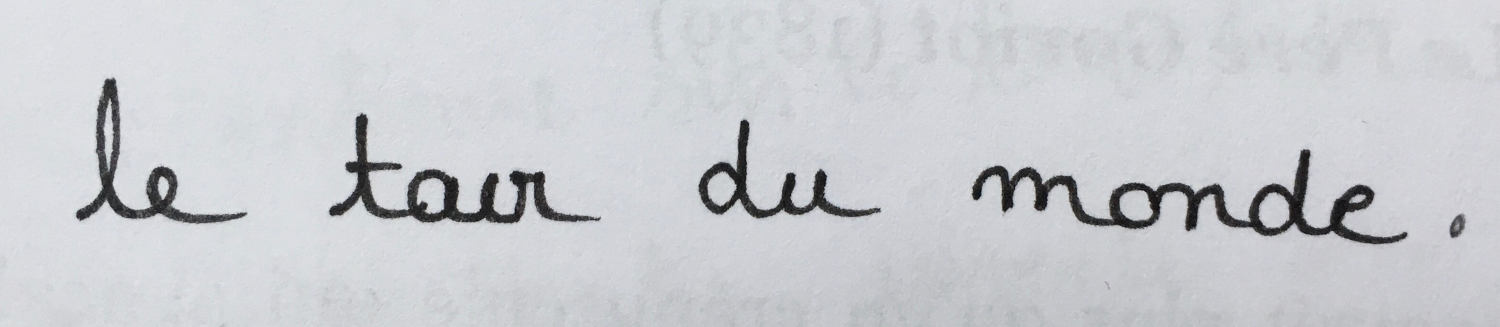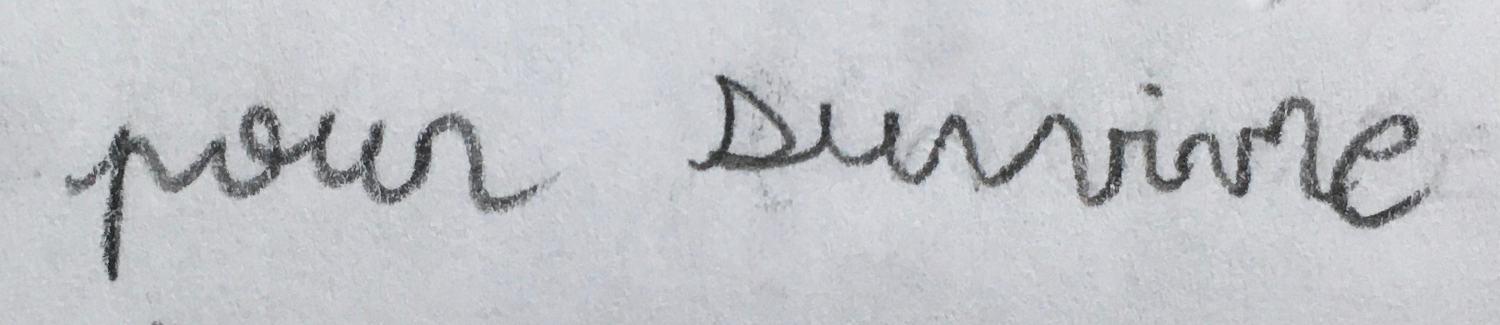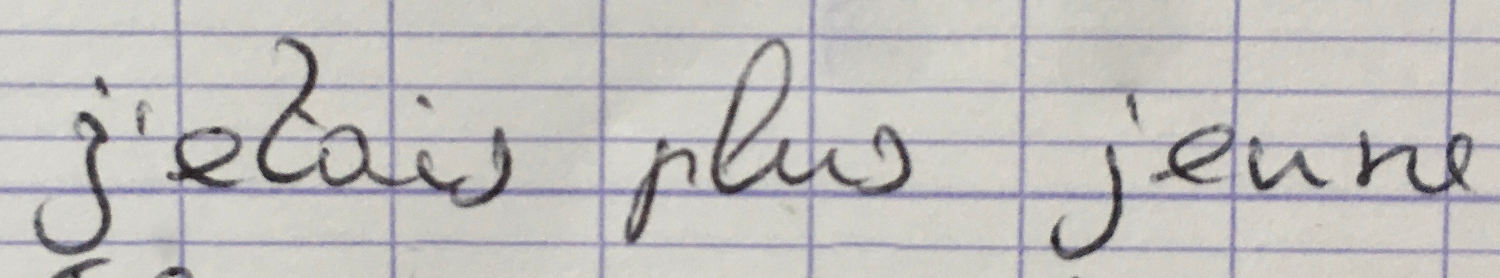Ils sont en plein dedans
J’avais dit aux profs : « Je veux être présent au lycée dès le jour de la rentrée, pour que les élèves s’habituent à ma présence. » C’était vrai, mais ce n’était pas la seule raison de mon empressement. Je redoutais surtout que les élèves disparaissent, avant même que j’aie pu les voir. Je craignais l’annonce d’un confinement tel qu’au printemps dernier, et de devoir travailler à distance avec des gens que je n’aurais jamais vu en vrai — avec qui je n’aurais jamais partagé cette simultanéité (j’ai failli écrire « cette intimité ») : celle de mon corps et de leurs corps, dans le même espace, pendant cinquante-cinq minutes.
Ma mission, dans ces ateliers d’écriture, c’est de faire tomber les obstacles, de franchir les frontières entre moi (pour qui la vie est liée à la lecture et à l’écriture) et eux (qui ont souvent des réticences à lire, et croient qu’ils n’aiment pas écrire). Faire tomber les barrières, au temps des « gestes barrières » : tu parles d’un défi ! Dire aux élèves : « Voilà qui je suis, dites-moi qui vous êtes », quand la moitié du visage est masquée ? Les injonctions contradictoires… Comment faire un pas vers l’autre, quand « l’autre » est considéré comme un danger potentiel ? L’atelier d’écriture est un exercice physique : nous ne sommes pas de purs esprits, et encore moins des algorithmes. Alors que le corps est devenu encore plus tabou qu’avant, comment puis-je dire (sans choquer personne) que je bouge beaucoup pendant un atelier, que je parle tout le temps, que je transpire, que je me déplace d’une personne à l’autre, que j’entre dans la bulle de chacun, de chacune ? Ma mission, c’est de « transmettre » ma passion — puis-je encore utiliser ce mot, sans qu’on me soupçonne de transmettre un virus ?
Je travaille avec des adolescents. L’année dernière, ils n’avaient pas le corps qu’ils ont aujourd’hui et, l’année prochaine, ils auront encore changé. Je ne peux pas faire comme si de rien n’était : cette question de la présence physique n’est pas anodine. Et le rapport au groupe : il y a celles et ceux qui occupent tout l’espace ; il y a les autres qui voudraient être invisibles. Alors… alors… travailler avec eux dans une « classe virtuelle » ? Vraiment ? Est-on bien sérieux ? Ce qui s’est passé en septembre au lycée, ça n’aurait pas pu avoir lieu sur un écran.
Et voilà : pendant les vacances d’automne, le confinement est annoncé. Mais c’est une nouvelle sorte de confinement : le lycée continuera de fonctionner. Ah ? bon. Quelles données médicales ont donc prouvé qu’il était moins dangereux de fréquenter une salle de classe que, par exemple, de se promener le soir dans la ville ? (Les mêmes, sans doute, qui décident que les cinémas sont des lieux plus risqués que les grands magasins.) La décision est incompréhensible, rapport à l’épidémie ; mais elle m’arrange, rapport à mes projets. Car je tiens à mes ateliers. J’y crois. J’aime ça. Ils me maintiennent en contact avec les élèves, avec les profs, avec les rues que je parcours pour me rendre au lycée. Avec les gens, avec la ville encore vivante.
Avant chaque séance, j’hésite. Faut-il demander aux élèves de parler du confinement ? Faut-il bouleverser mes projets, en centrant mes séances sur cette nouveauté ? On n’en peut plus, de l’épidémie ! Ça fait un an qu’on ne nous parle que de ça. Alors, faut-il que mes ateliers d’écriture soient une pause, dans le flot d’anxiété qu’on déverse chaque jour ? Ou bien, qu’ils soient l’occasion de s’exprimer enfin sur ce sujet, grâce aux outils que je propose ? Je réfléchis. Je balance. Et je ne choisis pas. Je voudrais les laisser choisir, eux. Je propose des pistes assez ouvertes qui permettent, soit de parler de cette actualité, soit de parler d’autre chose. Quand je propose de décrire la ville « en regardant par la fenêtre », je tends une perche à ceux qui voudraient me parler d’enfermement, mais je n’oblige personne à le faire. De la même façon, quand j’ai lancé le sujet « À nous deux maintenant », j’ai suggéré aux élèves de me parler de leurs ambitions, de leurs craintes (de leur vie, quoi)… mais la porte de la fiction était ouverte aussi, pour les élèves tentés par l’imaginaire.
Bizarrement, quand je laisse aux élèves la liberté de s’exprimer, ils ne choisissent pas le sujet du confinement. Je me demande pourquoi… alors que les adultes ne parlent que de ça ! Je m’interroge. Il faut dire que les élèves ne sont pas vraiment confinés. Ils ne télétravaillent pas : ils vont au lycée. Ils n’ont plus le droit de faire du sport, de sortir avec les copains et les copines, de quitter leur quartier, de rendre visite à la famille quand elle habite loin. Ils sont certes empêchés de mille choses cruciales, mais ils ne sont pas enfermés comme au printemps dernier. Nous, les adultes, faisons des comparaisons entre cette vie empêchée et « comment la vie était avant » ou « comment la vie aurait dû être en ce moment ». Par exemple, je me dis : « S’il n’y avait pas le confinement, j’aurais fêté dignement mon nouveau livre, au lieu de cette sortie en catimini », parce que j’ai le souvenir des parutions précédentes, et des fêtes que j’avais organisées alors. J’attendais un scénario précis : la répétition d’un plaisir déjà connu, et la réalisation d’un désir nouveau. Parce qu’à mon âge (même si j’espère continuer d’apprendre tous les jours), cette année n’aurait pas été radicalement différente des années qui la précèdent et qui la suivent. Avoir trente et un ou trente-deux ans, ça change quoi ? Je suis un grand garçon, je fais des choix, je mène ma petite barque.
Quand j’avais seize ans, je naviguais à vue. Tout était nouveau. Chaque année était une première fois, et donc : une fois unique. Pour des lycéens, quel sens cela a-t-il de regretter « ce que cette année scolaire aurait dû être, s’il n’y avait pas eu l’épidémie » ? Savent-ils seulement ce que c’est, une année de Seconde normale ? C’est la première fois qu’ils sont en Seconde, et ce sera la seule fois de leur vie. Peuvent-ils regretter de n’avoir pas fêté dignement leur fin de collège ? Moi, j’ai connu trois « pots de départ » dans mes boulots successifs : j’ai une petite idée de « comment ça pourrait être », si une quatrième fois se présentait. Mais eux ? La dernière fois qu’ils ont quitté une école, c’était la fin du CM2, ils étaient des enfants. Jamais de leur vie ils n’avaient quitté une école à quatorze ans, et ils ne le feront plus jamais. Moi, à trente-deux ans, j’ai la nostalgie des dernières soirées que j’ai passées dans des bars, avec les copains, il y a plusieurs mois. Mais eux, les élèves ? Regrettent-ils ces soirées ? Peut-être n’ont-ils jamais mis les pieds dans un bar. Même dans un appartement, peut-être n’ont-ils encore jamais participé à « une fête d’ados ». Sans cette épidémie, peut-être que leur première soirée de ce genre aurait eu lieu cette année… mais non, elle n’a pas eu lieu. Regrette-t-on quelque chose qu’on n’a pas connu ?
Un jour, ils auront mon âge. Ils seront peut-être nostalgiques d’une époque qu’ils n’auront pas vécue. Je pourrais, moi, regretter de n’avoir pas commencé ma vie amoureuse avant l’apparition du sida. Je pourrais regretter de n’avoir pas cherché du travail à l’époque où mes parents, eux, en trouvaient sans difficulté et sans diplôme. Je pourrais regretter de ne pas être un écrivain du XIXe siècle, quand la littérature paraissait en feuilleton dans les journaux populaires. Je pourrais regretter de n’avoir pas connu le tramway Louvre-Romainville via Bastille. Je pourrais regretter de n’avoir aucun souvenir du métro parisien avant le plan Vigipirate de 1995. Mais cette nostalgie, c’est un truc de vieux. Quand j’avais seize ans, je ne regrettais pas les seize ans virtuels que j’aurais pu avoir. J’avais mes seize ans à moi, avec mes problèmes à moi. Les épidémies, le terrorisme, le chômage n’étaient pas des problèmes d’actualité, qu’on peut considérer comme tels parce qu’on sait qu’ils n’ont pas toujours existé. L’actualité d’une année (une année entière, rendons-nous compte !) n’était pas le marqueur d’une époque, elle était mon présent. Toute ma vie.
Voilà peut-être, me suis-je dit, pourquoi les élèves ne parlent pas tellement du confinement. Je fais cette supposition. Nous autres les vieux, nous prenons des airs importants : nous parlons du monde d’avant et du monde d’après. Eux, ils sont en plein dedans : dans le monde de maintenant.