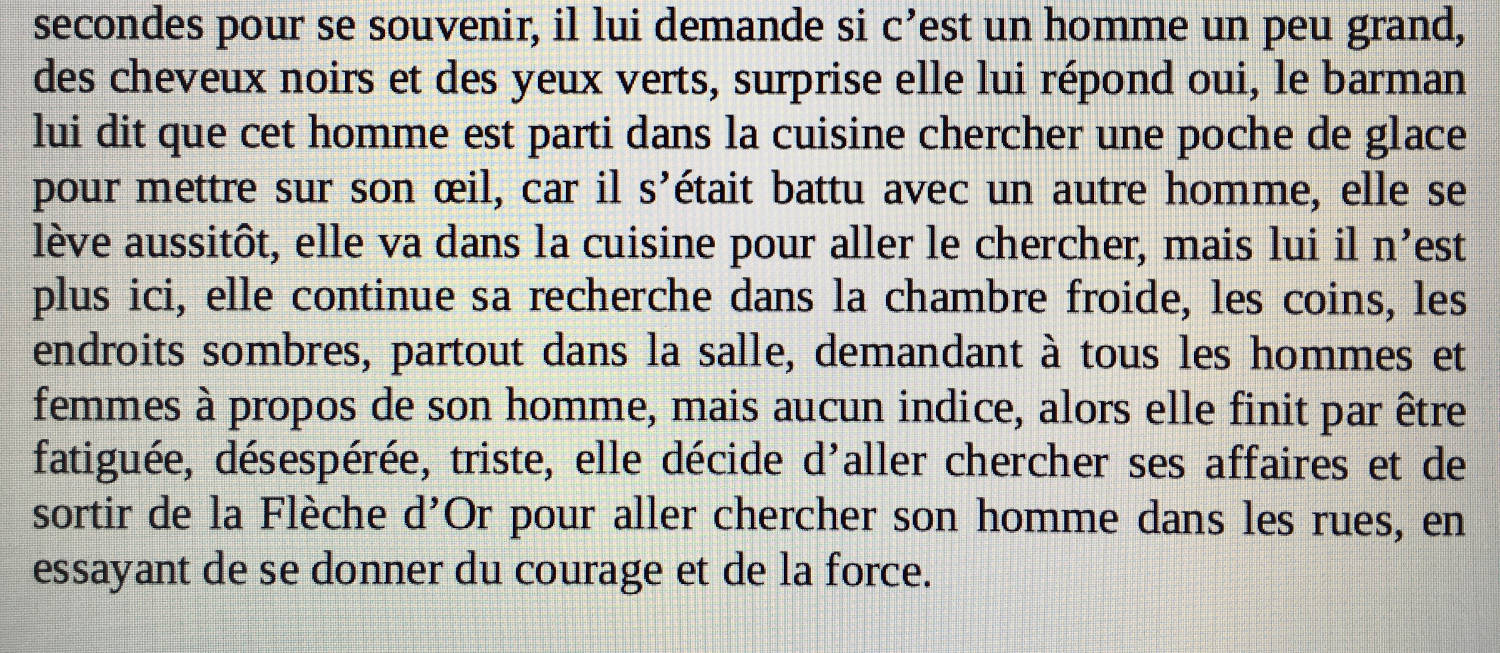On s’est dispersés
Quelque chose ne marche pas avec ce « roman collectif ». Juste avant la fermeture du lycée (une séparation d’au moins quatre semaines qui, si elle se prolongeait, reviendrait à ne plus voir les élèves du tout, puisqu’ils partiront en stage à la fin du mois de mai), on a organisé une séance in extremis pour les plus volontaires. Résultat : ils étaient trois au CDI avec moi. Les deux plus fidèles (celui et celle chez qui je perçois une personnalité plus affirmée dans les sujets choisis, et un travail véritable) et une troisième que je n’avais pas vue depuis longtemps. Pendant une heure, la discussion est enjouée et pertinente : on fait avancer le récit, on interroge les motivations des personnages. On s’installe devant les ordinateurs et on écrit, en choisissant les mots, en les remplaçant par d’autres. À la fin, il est même question d’écrire le chapitre final à quatre mains : S. et M. quittent le CDI après avoir convenu d’échanger leurs idées à distance, sur la messagerie d’un réseau social. Je sais que les élèves ne font pas semblant — il n’y a aucune raison de m’arnaquer, car je n’ai aucune faveur à accorder en échange, aucune bonne note à attribuer — quand ils ont l’air enthousiastes, c’est qu’ils le sont vraiment. Mais alors, où s’envole cet enthousiasme entre deux séances ? Il disparaît dans les limbes ? il s’égare dans les ondes et les câbles des réseaux ? il est dispersé par le vent (comme le virus, dit-on, quand on fait la classe les fenêtres ouvertes) ? Pendant les semaines qui suivent, je ne reçois de nouvelles de personne. Nous sommes dispersés : chacun chez soi. Ce qu’il faut, maintenant, c’est écrire ce qui a été convenu ; j’écris quelques messages d’encouragement aux élèves sur un groupe WhatsApp créé par Frédéric, leur professeur. Assez vite, je me persuade qu’une panne de réseau généralisée s’est abattue sur les adolescents parisiens (aux heures ouvrables) et je me rends à l’évidence : ils ne répondront pas, je suis donc en vacances.
Je pense aux autres élèves : la classe d’UPE2A dont je mets en ligne les écrits de février et mars, à propos de la chambre et de la ville. À nouveau, je suis ému par certains récits, les mots choisis tout en finesse. Après ça, quoi d’autre ? Ah, oui, je l’ai dit : je suis en vacances. C’est du temps pour moi. Je me souviens de la réunion de décembre, pour faire un point sur ma résidence, avec Isabelle de la Région Île-de-France. Elle m’avait demandé ce que j’écrivais : les ateliers au lycée, c’est bien, mais elle n’oublie pas que c’est une résidence de création, c’est-à-dire du temps et de l’argent pour me permettre d’écrire, moi. C’est donc ce que je fais en avril : je me plonge entièrement dans mon chantier de Rue des Batailles. Je me suis dispersé, ces temps-ci, multipliant les petits projets. Je n’aime pas faire une seule chose à la fois. J’ai besoin d’alterner et de mélanger. Quand j’avais un emploi à la Ville de Paris, mon temps d’écriture était plus rare, donc plus rationnel : j’écrivais des récits suffisamment organisés pour être présentés à des éditeurs. Quelques semaines de congés par-ci par-là, mises bout à bout, ont composé les mois nécessaires à l’écriture de mon roman L’épaisseur du trait et des livres précédents. Depuis que je suis « écrivain à plein temps », j’ai écrit autrement. Avec tout ce temps libre, je pourrais enchaîner trois romans dans l’année, non ? Ce serait absurde (personne ne voudrait les publier) et de toute façon, j’en serais incapable : un gros chantier me demande du temps. Non pas un temps condensé, mais un temps long. S’il me faut deux ans pour comprendre où je vais dans un récit, je dois vraiment prendre ce temps ; je ne l’abrégerai pas en écrivant douze heures par jour. J’avance ce projet doucement et, en parallèle, je fais d’autres trucs. Écrire sur mon blog me permet d’affiner mes idées, à force de les retourner et de les ressasser ; je m’y débarrasse aussi de désirs d’écriture qui n’ont rien à faire dans le roman et que je dois écrire quand même. Cette diversité m’est nécessaire : le web, les revues, les nouvelles auto-éditées, les ateliers d’écriture, les conversations avec les camarades qui écrivent, la lecture, la lecture, la lecture. J’écris mieux depuis que j’ai pris ce temps (et qu’on me paie pour continuer d’en disposer). Malgré cela… je me connais : souvent, je m’invente des excuses. Des manœuvres dilatoires. « Tiens, j’écrirais bien un billet de blog sur les pigeons qui viennent sur ma fenêtre le matin » ou « Tiens, il faudrait que je me mette à jour sur tous les sites d’auteurs auxquels je suis abonné et dont je n’ai pas lu les derniers articles. » Vraiment, c’est cela, l’urgence du jour ? Passer deux heures à fignoler mon journal ? ou à lire des trucs intéressants, certes, mais qui ne résoudront jamais le grand-drame-de-la-vie (savoir qu’on n’aura jamais lu tout ce qu’on aimerait lire) ? Non. Je me disperse. Aujourd’hui, je ferme tous les onglets parasites, je me colle devant mon écran noir, et j’écris Rue des Batailles. Je l’ai déjà expliqué ici et j’en parle souvent dans mon autre journal : pour ce chantier, j’ai un plan — pour organiser mon récit et, surtout, faire le tri dans ma documentation. Pour ne pas me disperser trop, quoi.
La fiction est exigeante. Il faut construire et réfléchir beaucoup. Bien que mes personnages me ressemblent et vivent des choses que j’ai déjà vécues, ou dans lesquelles je me projette (pour le dire simplement : bien que mes romans parlent de moi), c’est plus difficile d’écrire ces histoires que mon journal — cet espace d’expression déroulé au jour le jour, à la première personne et au premier degré. Je pense que certaines entrées de mon journal sont de bons textes, mais elles sont toujours plus faciles à écrire que les passages les moins bons de mes fictions. Je me demande si tout le monde ressent la même difficulté (et, en corollaire de celle-ci, la même fierté quand le truc finit par aboutir). Je ne serais pas étonné que, pour les élèves, le roman collectif patine à cause des mêmes raisons. Je sais qu’ils sont capables d’exprimer des choses puissantes, en atelier, quand il s’agit d’écrire sans filtre : parler de soi ; de ce qui compte pour soi. Mais là, dans ce roman (bien qu’ils aient construit l’intrigue en fonction de leurs goûts et de leurs envies), il faut faire l’effort de transposer ses émotions sur un personnage fictif ; il faut articuler les images mentales (nées spontanément dans l’imagination de chacun) de façon à former un récit cohérent. C’est difficile. Alors, la plupart laissent tomber.
Frédéric me propose un « déjeuner de travail ». Je perçois l’ironie dans son message : s’il s’agissait seulement de caler les prochaines dates du projet, on le ferait par téléphone, mais, puisqu’il faut bien trouver des avantages au télétravail et aux classes virtuelles, nous nous retrouvons aux Buttes-Chaumont pour pique-niquer. Avec ce petit soleil de printemps, on y est mieux installés qu’en salle des profs. Il me dit que les élèves, en ligne, sont moins absents qu’on pouvait le craindre : la plupart se connectent à l’heure dite. Le lycée rouvre la semaine prochaine, avec le principe des « demi-jauges ». Nous programmons mes prochains rendez-vous avec la classe de première, celle du chef-d’œuvre : concevoir un livre à partir des textes écrits en ateliers. Si le roman tombe à l’eau, au pire, on a largement assez de poèmes, de fictions courtes, de récits variés et intéressants pour composer un recueil. Tant pis pour le roman. Tant pis ? Ah, mais au fait. J’oubliais. À la fin du mois, juste avant de boucler ce journal, une élève de ce groupe m’envoie un signe de vie, sous la forme d’un chapitre de ce fichu roman. Je le trouve très bien. Il y a un rythme, une atmosphère. Ouf ! Quelque chose s’est donc passé pendant ces semaines. Ça me fait plaisir. Alors je colle ici les derniers mots de son texte : « se donner du courage et de la force. »