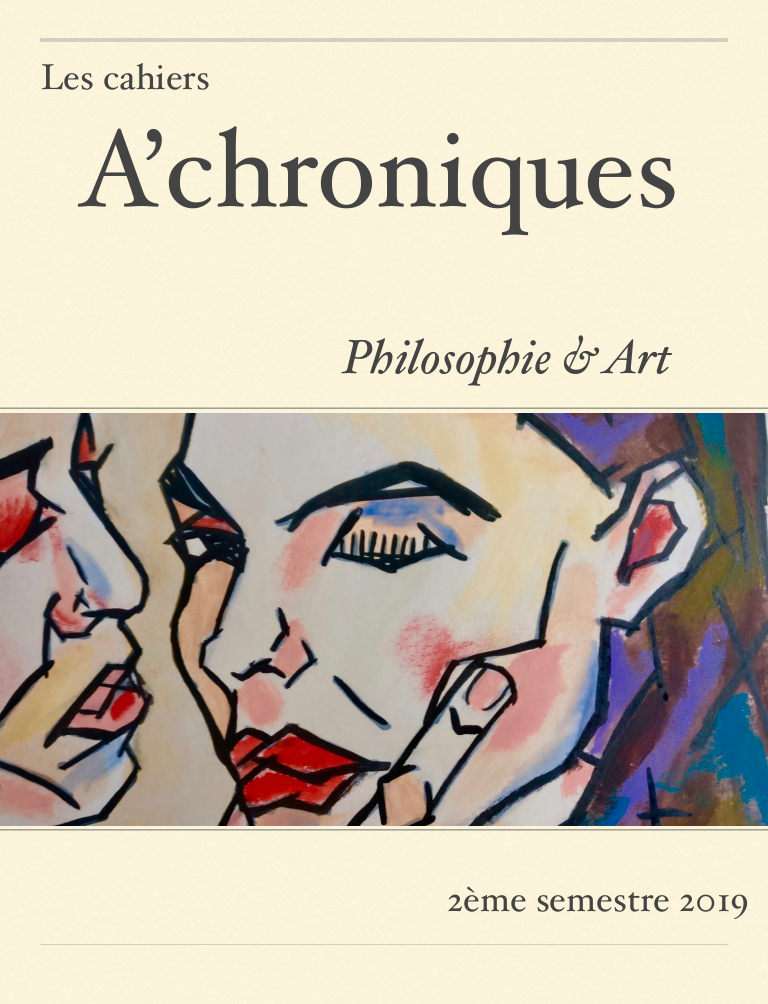Les corps caverneux : entretien avec Caroline Guth
Dans Les cahiers A’chroniques, 2e semestres 2019 (Dossier : Poésie vs faits-divers, entretien avec Laure Gauthier, p. 16-42), publiés par Caroline Guth, je réponds à de nombreuses questions de Caroline Guth au sujet de ma résidence Ile-de-France, de la rédaction de « Les corps caverneux » et du lien entre poésie et faits divers. En voici quelques extraits :
Caroline Guth : A présent, approchons davantage du livre que vous rédigez dans le cadre de votre résidence d’écrivain Île-de-France en partenariat avec l’Achronique : Les corps caverneux.
Laure Gauthier : Les corps caverneux ne parlent pas de cabanes à habiter à l’extérieur de nous, mais d’espaces creux et vides en nous tous, à apprivoiser, à laisser résonner : habiter ces trous, ces interstices que je considère comme l’une des seules données « universelles ». Chaque être humain de la planète, tout milieu social confondu, toute religion confondue, toute culture confondue est en butte au vide, à la fragilité, à l’angoisse, sent résonner le vide en lui et est tenté de le combler que cela soit par des drogues, par dieu, par des achats. Aucune société n’a essayé de façon aussi violente et radicale que notre société occidentale capitaliste de combler les trous : par des achats, des faits divers, des statistiques, du sucre, du sensationnalisme. Il s’agit de combler l’être, de le remplir, de le rendre dépendant, inactif, en prétendant le rendre heureux, le bonheur étant l’attrape-nigaud du capitalisme. Or ces jachères en nous, ces failles, sont des espaces importants, c’est le plein du vide oriental : il faut les entendre, les laisser respirer si l’on veut aussi pouvoir résister à la pression du monde extérieur. Ce livre poétique propose de faire entendre la musique de nos trous, c’est là pour moi le lien entre l’intime et le politique.
Le livre est parcouru par une réflexion poétique sur l’intérieur et l’extérieur ; il pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Je suis partie d’un postulat qui s’inscrit dans le prolongement de ce qu’affirme Georges Bataille dans son livre sur Lascaux : il s’agit de toucher le fond de la caverne avant de pouvoir sortir à la lumière de la connaissance. Appréhender singulièrement « nos cavernes » intérieures, adopter leur musique, pour entrer en vigilance, avoir la force de se cabrer, ne pas se laisser combler.
J’ai choisi de faire entendre dans chacune des séquences du livre une « musique » de nos cavernes. Dans la séquence « les corps cav » il s’agit même d’une musique des cavernes, des grottes préhistoriques : « rodez-blues », « epadh-mélodie », « une rhapsodie pour qui ? » etc. Il y a un semblant de narration, une narratrice qui traverse des lieux, Rodez, un pavillon en Corrèze, une cour de lycée la nuit sur les traces de l’adolescence, un hypermarché, un Epadh, à la recherche d’une musique intérieure qui nous rendrait vigilants.
Le mouvement et le sens du toucher sont centraux dans ce livre. Le sens tactile qui peu à peu s’est atrophié dans nos sociétés : où la poésie peut-elle se situer pour ne pas être en deçà du toucher ? Comment inventer une langue qui présentifie, dégage, plus qu’elle ne re-présente ?
Je m’adresse aussi aux attaques qu’on fait subir à l’intime, à la langue, au corps de la langue dans notre société. Atrophier la langue et la soumettre à l’efficacité bien sûr est une attaque profonde sur la singularité et sur la capacité de résistance. Dans la séquence « rodez-blues », la dernière que j’ai écrite, il est question du tourisme et des lieux commémoratifs, une autre fois dans une rhapsodie de supermarché (« rhapsodie pour qui ? »), c’est la mise à mort par le trop-plein qui devient musique. Mais dans tout le texte apparaissent des faits divers plus ou moins retravaillés sous une forme sans cesse renouvelée.
Tout est organisé aujourd’hui pour nous gratter dans le sens du poil, nous avoir par nos bas instincts que ce soit en consommant à outrance, à tout sucrer, à ne jamais nous laisser de silence ou de temps mort de réflexion, à nous encombrer d’objets, de sons, d’achats. Mais le pire est sans doute que la langue majoritaire ou la littérature la plus répandue est la langue des faits divers ou la « fait-diversification » du journalisme sur tous les écrans : toute la journée nous sommes abreuvés de titres sensationnels et même les faits politiques sont traités dans la langue via les gros-titres comme des faits divers dans une langue sensationnelle. Malheureusement, cette langue est omniprésente et on assiste à une sorte de contamination ; pour beaucoup ce vocabulaire du « choc », de l’effroi, gagne le dialogue intérieur, la façon de présenter sa pensée aux autres. Cela entraîne une complaisance envers la violence intime et aussi une sorte de dépolitisation de l’information traitée sous un aspect privé ou sensationnel. Une des questions que je me suis posées avant d’écrire ce texte était de savoir si j’allais trouver une langue suffisamment résistante pour rendre compte de la violence de l’attaque faite à la langue par la fait-diversification.
Pour finir, pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments sur ce livre qui est en train de s’écrire et qu’on a hâte de découvrir ?
Les deux dernières séquences que j’ai écrites sont « une rhapsodie pour qui ? » et « rodez- blues ». J’avais pris des notes cet été pour « une rhapsodie pour qui ? » qui entend dire la musique de nos trous, des cavernes en nous, ces creux qu’on tente d’ensevelir en nous faisant consommer à outrance, une rhapsodie d’hypermarché donc. J’ai beaucoup lu, écrit de notes, écouté de rhapsodies. Mais, c’est en revoyant le film River of no return avec Marilyn Monroe, que j’étudiais pour un autre texte, que j’ai eu la vision de cette séquence, et que son architecture s’est imposée. En exergue de « une rhapsodie pour qui ? », je cite une des chansons du film, un western raciste, misogyne faisant l’apologie du capitalisme sauvage :
One silver dollar, bright silver dollar,…¨ changing hands, changing hands.…¨ Endlessly rollin’, wasted or stolen,…¨ changing hands, changing hands.
J’ai écrit avec comme arrière-fond ces chansons, le cynisme de ces couplets faisant l’apologie de l’argent, de la chasse des Indiens notamment. J’oppose une rhapsodie de fond à ce couplet simplet et ravageur. Je fais corps contre la chanson, pour tenir la ligne d’horizon du massacre qui se passe dans les grandes « surfaces ». Cette séquence débouchera sur « Dyptique linda brown » où je mets en regard la sur-représentation de Marilyn Monroe depuis Warhol jusqu’à aujourd’hui et la non-représentation de la jeune Linda Brown, qui au moment où est tourné le film River of no return, se bat pour que la loi autorise les enfants noirs à être scolarisés dans des écoles blanches. Et bien sûr, ce visage est presque totalement hors champ de l’histoire de l’art et de la représentation. Or, la poésie est pour moi un film du hors champ. Il n’est plus temps que les poètes s’emparent de Marilyn, non, il y a d’autres lumières inaperçues.
Dans « rodez blues », je dialogue avec le blues bien sûr, et la séquence est construite comme un hommage à Artaud. Je mène une trajectoire fictive dans Rodez à la recherche du 1, rue Vieussens, là où Antonin Artaud a été enfermé entre 1943 et 1946. On voit comment on nous remplit en tant que touristes, et détourne notre attention en multipliant les gestes et les lieux commémoratifs. Ce qui fausse notre rapport dialectique au passé, nous force à une attitude passéiste au lieu d’entendre les questions non résolues et vivantes du passé qui font signe vers l’avenir. S’ensuit une réflexion sur le dénuement, la pauvreté, le chamanisme et aussi la nécessité de ne pas rester rivé à la seule notion d’espace mais de réarticuler une poétique du temps. La fin est un long chant qui dialogue avec les « Tarahumaras » d’Artaud et propose une vision d’un monde, la ré-articulation d’une langue après le naufrage de la société capitaliste.