Cuisiner c’est écrire à nouveau
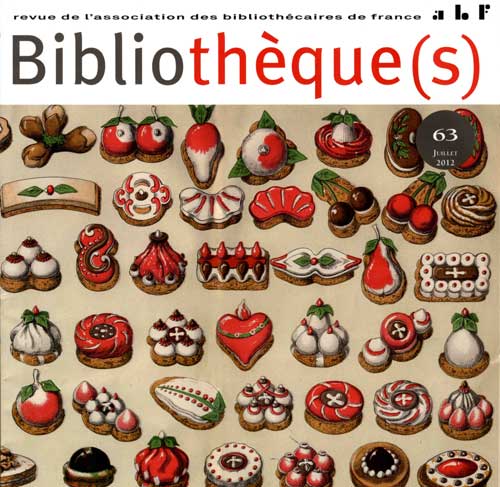
Bibliothèque(s), revue de l’Association des Bibliothèques de France, est une revue professionnelle "ouverte sur la vie des bibliothèques, la filière du livre et les problématiques de l’image et du son."
Son numéro 63, consacré à la cuisine, interroge plusieurs auteurs à ce sujet (Maryline Desbiolles, Michèle Barrière, Paul Fournel), dont Ryoko Sekiguchi - et n’a pas manqué de s’intéresser à sa résidence à la Cocotte.
Ce texte est une manière de bilan, une traversée de ces quelques mois ont présenté de particulier, pour Ryoko, pour son écriture, pour les personnes rencontrées lors de ces nombreuses rencontres.
Consultez le sommaire de ce numéro en pdf, et commandez-le ici.
Cette question, je l’ai posée dix mois durant à différents auteurs et éditeurs. Il s’agissait des rencontres littéraires que je menais dans le cadre de ma résidence d’écrivain de l’Île-de-France, financée par le Conseil Régional.
Cette résidence, je l’ai intitulée « Raconte-moi une histoire de cuisine ». Dix mois durant, j’ai reçu un invité par mois. Il s’agissait chaque fois de personnes travaillant dans l’édition en rapport avec la cuisine, mais non pas forcément d’auteurs de livres de recettes. En invitant tour à tour éditeurs, photographes, directeurs de collection, traducteurs, illustrateurs de livres de jeunesse, poètes ou compilateurs d’anthologies, je souhaitais faire apparaître toutes les facettes induites par la réalisation d’un livre. Tous les mois, l’un d’entre eux venait donc nous raconter son « histoire de cuisine » à la Cocotte, lieu dédié à la création culinaire, dans le 11e arrondissement de Paris.
Parallèlement à ces rencontres, j’ai publié chaque mois un petit livre de la revue dans une collection conçue tout spécialement pour ma résidence. Il s’agissait de nouvelles ou d’essais portant sur la cuisine, choisis dans la littérature japonaise, que j’ai traduits pour l’occasion, en collaboration avec Patrick Honnoré : un livre de recettes de tôfu paru au XVIIIe siècle, l’histoire d’un jeune homme dans le Japon d’après-guerre, des contes rapportant, au XIIe siècle, l’effet de champignons hallucinogènes sur un groupe de nonnes, un poème spirituel évoquant un aliment céleste, un essai sur la faim… C’était pour moi une façon de « raconter des histoires de cuisine » que j’avais aimé lire et que je voulais partager avec les lecteurs Français.
Puisqu’il m’importait que les rencontres prennent véritablement la forme d’un échange, j’ai voulu que le public à son tour nous raconte ses histoires de cuisine. J’ai donc lancé un « appel à histoire » auquel plusieurs personnes ont répondu, curieusement toutes des femmes. Parmi les histoires de cuisine qui m’ont été envoyées, certaines ont été publiées en ligne, sur le blog que j’ai tenu pendant ma résidence ; cinq autres sont publiés dans le dixième et dernier volume de la petite collection.
S’agissant de cuisine, il n’était pas question, bien sûr, de discuter à jeun : chaque rencontre était suivie d’une petite dégustation avec le public de plats que j’avais préparés exprès. Nous avons ainsi pu goûter, selon le thème du jour, du canard à la japonaise, des sushi, un assortiment de plats de porc à l’okinawaïenne, de l’alcool de fruits maison, une salade de kakis, et d’autres choses encore. Quelqu’un dans le public, fidèle à nos rencontres, est venu me parler à la fin de la résidence. Il m’a dit qu’en hiver, la Cocotte avait pris des allures de refuge, petite lumière dans la rue Paul Bert où l’on pouvait venir écouter des histoires et se réchauffer autour d’un encas à l’abri du froid ; et qu’au printemps, les rencontres s’étaient transformées en pique-niques joyeux, avec les enfants venus parfois nous écouter sagement.
Si je vous raconte mon expérience, ce n’est pas pour dresser le rapport de ma résidence ; c’est pour dire combien ces dix mois passés autour de la cuisine et des textes m’ont changée en tant qu’auteur.
Le projet de cette résidence, je le mûrissais déjà avant 2011. Nous le concoctions depuis deux ans avec Andrea Wainer, qui tient la Cocotte. Finalement, le hasard a fait que la résidence m’a été accordée au moment précis où j’en avais besoin, c’est-à-dire, juste après le 11 mars 2011.
Avant de commencer la résidence, bien sûr, je n’avais pas idée de ce qui nous attendait. Mais rétrospectivement, quand j’y pense, cela tombait à pic : j’avais vraiment besoin de rapports concrets avec d’autres personnes, dans un lieu concret, autour de ce thème bien concret de la cuisine.
Le métier d’écrivain, inutile de le rappeler, est un métier solitaire et abstrait. Après la triple catastrophe de mars 2011, me trouvant loin de mon pays et sans pouvoir détacher une seconde ma pensée de cet évènement, je me suis sentie plus isolée encore, et plus fragile. Le rythme des rendez-vous de la résidence, les rencontres, ces rapports concrets, m’ont aidé à équilibrer même mon écriture, puisque je m’étais imposée, comme je l’ai dit, de traduire tous les mois une nouvelle japonaise en français.
En outre, le thème de la nourriture avait en moi une résonance particulière liée au Japon. Ma mère est cuisinière et a tenu un temps une petite école de cuisine. J’ai donc été élevée dans une atmosphère à la fois très culinaire et féminine (à l’époque, la plupart de ses élèves étaient des jeunes filles à marier), mais aussi éditoriale et littéraire, puisque mon grand-père était éditeur.
Ainsi l’association des thèmes « cuisine » et « histoire », tout anodine qu’elle puisse paraître, touchait en moi le sommet de la nostalgie, associée à ce qui m’avait formée dans mon enfance et dans mon adolescence. Au début, en montant ce projet, je n’avais pas du tout envisagé ce thème en rapport avec « mon » Japon. Mais après le 11 mars, il m’a comme embarquée vers un retour au pays, littérairement parlant.
Jusqu’alors, en tant que poète, je n’avais jamais envisagé d’écrire spécifiquement sur le Japon ; plus même, il y avait de ma part comme un refus stoïque : je ne voulais pas me vendre sous mon étiquette de « japonaise ». Ce refus était, je crois, judicieux à l’époque ; mais désormais, le « retour » m’était nécessaire. Le thème culinaire m’a aidé à opérer ce « retour aux racines » naturellement et en douceur. J’ai appris à parler du Japon, de « mon » Japon, en mêlant une fois encore le concret à l’abstrait. Comme un apprenti cuisinier entreprend pour la première fois de couper des légumes et de faire un bouillon, j’ai réappris à écrire de nouveau, alors même que je vis dans le monde de l’écriture depuis plus de vingt ans. Ce qu’il y a de merveilleux dans le métier d’écrivain, c’est qu’à la différence de notre vie d’être humain, avec un corps périssable et une trajectoire à sens unique, la vie d’écrivain est une vie parallèle où tout devient possible. Ce n’est certes pas toujours facile, mais on peut rajeunir, recommencer à zéro, changer d’identité, ressusciter… Cette année, je suis redevenue un écrivain débutant face à un nouveau thème à découvrir. Comme fruit de cet « apprentissage », deux livres, L’Astringentet Manger fantôme, sont parus pendant ma résidence, dans lesquels je mêle la question du goût à l’esthétique, à l’histoire, à l’imaginaire et à la littérature.
Au cours de chaque rencontre à la Cocotte, j’ai posé dix questions, toujours les mêmes, aux invités. Les questions étaient simples, de l’ordre de la curiosité : « quel mot relatif à la cuisine et à la nourriture (quelle que soit la langue) aimez-vous / détestez-vous / vous intrigue le plus ? Pourquoi ? » Ou bien, « Avec quel auteur (vivant ou mort, tous genres littéraires confondus) voudriez-vous dîner ? Et autour de quel plat ? »
En réponse à ces questions si anodines, j’ai été surprise de découvrir que mes invités se confiaient parfois sur l’essentiel de leur travail : Johan Faerberracontant comment, issu d’une famille d’immigrés, les quiches confectionnées en toute occasion par les Françaises le faisaient rêver ; Valérie Lhomme conservant le dernier pot de confiture de sa grand-mère pour son premier bébé… Lors d’un débat organisé au Salon du Livre de Paris, j’ai eu l’occasion de poser les mêmes questions à Pierre Gagnaire. A la question « Un beau matin (ou soir, au choix) vous vous retrouvez transformé en repas… En quel plat vous êtes-vous transformé ? Pourquoi ? », Pierre Gagnaire a répondu : « Je serais transformé en eau, parce qu’elle est aujourd’hui la nourriture la plus précieuse et qu’elle traverse tout aliment ».
Au cours de la dernière rencontre de ma résidence, j’ai moi-même répondu au questionnaire. À la question de savoir ce que je pourrais bien manger pour mon dernier repas, j’avais cru longtemps avoir une réponse précise : un verre de saké de telle région particulière avec les œufs d’un poisson préparés de telle façon, etc. Mais je me suis rendue compte d’une chose : si demain le monde s’arrête, je ne pourrai pas aller dans un bar et demander à être servie. Chacun, cuisiniers compris, souhaitera prendre son dernier repas ! Forcément, pour son dernier repas avant la fin du monde, chacun devra se débrouiller, c’est la règle d’or. Alors je me dis que j’irai dans une cuisine – si je suis à Paris, ce sera peut-être chez moi, si je suis dans une autre ville, je me faufilerai dans les cuisines d’un restaurant vidé pour cause de fin du monde, enfin, tout dépend où je me trouve à ce moment-là – et je nous ferai à manger, à moi et à mes amis. Parce que, ce que la résidence m’a appris, c’est que pour un repas, et pour le dernier à plus forte raison, il est impératif d’être à plusieurs, et mieux encore, avec ses amis.
Si, donc, demain, c’est la fin du monde, appelez-moi : je serai quelque part en train de préparer à manger avec ce que je trouverai dans le frigo de la cuisine. Et on refera le monde !