Le mot ciel
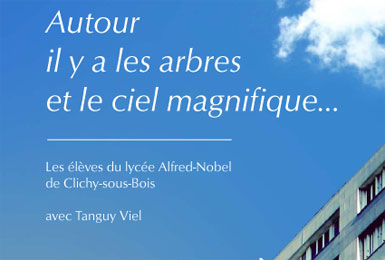
« Moi qui ai eu la chance de vivre mon enfance et mon adolescence dans la campagne, de vivre cinquante et un ans plus tard dans ces mêmes lieux, d’avoir eu un père ouvrier agricole, d’avoir travaillé dans les champs en sa compagnie, de savoir, grâce à lui, ce que sont les saisons, les ciels et leurs géographies, les signes de la nature et ses leçons philosophiques (la formule cyclique des temps, le sens de la durée, le nécessaire exercice de la patience, la puissance du déterminisme, la construction de la sérénité par la soumission au nécessaire, la construction de soi en harmonie avec elle et, plus sûrement, avec le cosmos), je mesure ma chance. Mais pour ceux à qui cette fortune a manqué ? [...] N’avoir connu dès son plus jeune âge que le béton urbain, les quadrillages citadins, les pollutions sensorielles (saturation en décibels, puanteurs toxiques, lèpres visuelles publicitaires, gazons dépoilés sur terres mortes, squares étriqués parfumés aux crottes de chien, immeubles clonant la cage à lapins, périphéries urbaines constellées de centres commerciaux hideux, vomissures des poubelles sur le sol, etc.) ; n’avoir jamais rien vu de la Voie lactée dissimulée par la lueur des lampadaires ; ne savoir des saisons que la neige maronnasse fondue des caniveaux ou les arbres secs de l’hiver dessinés sur fond d’architectures décrépites, c’est immanquablement se retrouver coupé du monde, sectionné de soi, ignorant les rythmes, les pulsions et les forces qui nous déterminent. »
Ce texte est effrayant. Il est effrayant parce qu’une première lecture un peu rapide pourrait se mettre le lecteur dans la poche (après tout, qui, au nom de Dame Nature, ne hiérarchiserait pas aussi vite entre l’air vivifiant de la campagne et la densité usante des grandes villes ?). Il est effrayant aussi parce qu’il fut écrit par un philosophe ayant pignon sur rue, et dont il y a fort à parier qu’il est un bon baromètre de l’humeur des temps. Il est effrayant enfin parce qu’il n’a suscité aucune réaction. Or il n’y a pas besoin d’être un grand exégète pour lever tous les fantasmes dont il est issu, ayant jeté sur la réalité un voile plus que déformant, tout simplement délirant.
Ce n’est rien de dire que cette représentation de la banlieue française est un tissu de dangereuses hyperboles au lexique nauséabond, servies par le plus lourd dédain, indigne de l’investigation philosophique. Ce n’est rien non plus de se demander à quel état nostalgique ou pastoral du monde il fait référence, incapable de prendre à bras-le-corps, avec quelque bienveillance initiale, le présent tel qu’il est, avec ses strates, ses déchirements, ses contradictions, sa complexité et ses fragilités. Ce n’est rien de dire qu’il divise grossièrement le monde en deux, selon une paresse à penser, une paresse à voir et à aller voir la vie en vrai, comment elle se passe (au fond une paresse à comprendre, à embrasser, à supporter le divers). Mais plus encore, en refusant d’arpenter ainsi la réalité, en refusant de l’accueillir dans son épaisseur et sa multitude, de se mettre à l’écoute des murmures si nombreux de son feuilleté, Michel Onfray fait bien pire que cela : il dénie aux habitants des banlieues eux-mêmes l’épaisseur de leurs facultés sensibles. Il leur refuse l’accès à la couleur du ciel, au monde, au cosmos et même à eux-mêmes. D’un simple urbanisme supposé ingrat, il parvient à la conclusion d’une humanité atrophiée. Tout cela est effrayant.
Mais j’insiste sur ce point : le plus grave encore n’est peut-être pas la petite opinion d’un philosophe douteux, mais bien que cette opinion elle-même soit depuis des années allègrement relayée dans les grands médias, symptôme d’un temps las de supporter son inénarrable complexité. Et inénarrable est bien le mot : c’est parce que sans doute il n’y a pas de narration simpliste qui parvienne à résoudre l’équation du pluriel-de-nous-tous-ensemble, que certains, fatigués, tendus de ne pouvoir tout ressaisir d’une main philosophiquement ferme et totalisante, finissent par se crisper et, pour le dire simplement, disent n’importe quoi. Le problème est que ce « n’importe quoi » n’est plus l’apanage d’une irréductible minorité d’aboyeurs mais celui d’une compagnie de plus en plus large naviguant sur un fleuve dont il semble décidément de plus en plus difficile d’endiguer la crue.
Gageons que nous nous y essayons ici, avec les armes mineures, volontairement mineures qui sont les nôtres. Car sans doute, usant de l’écriture, la jeunesse de Clichy n’est pas à égalité d’armes avec les forces rhétoriques de simplification. D’ailleurs, elle le sait très bien. Et ils le savent très bien aussi, eux, les réducteurs. Mais ce déficit, pour n’être que rhétorique, ne saurait en rien réduire la sensibilité, l’acuité d’une émotion, la charge poétique inhérente à tout être humain. À ce jeu-là, parmi les pièges auxquels nous mène de porter la contradiction, il y aurait la tentation de forcer le trait d’une banlieue pensante et contemplative. Mais il n’y a aucun trait à forcer. La vie est partout. Elle s’immisce et se ramifie dans tous les yeux de la terre, dans toutes les rues de toutes les banlieues du monde. La conscience est un endroit dense et irisé, constellée d’impressions et d’instants secrets, éclats d’intensité, de lumière diffractée qui traverse chacun d’entre nous, n’importe où, à chaque heure du jour. C’est en partant de cette évidence que nous avons commencé à travailler avec les lycéens de Clichy-sous-Bois, cherchant à circonscrire, à scénographier tous ces paysages intérieurs et leurs environnements, s’enquérant de savoir ce que pouvait vouloir dire pour chacun habiter, vivre ou penser, et regarder le ciel. Le postulat est simple : un lycéen de Clichy-sous-Bois perçoit autant de nuances du ciel qu’un philosophe. Au pire, il manque de lexique pour les dire et ça n’a pas beaucoup d’importance. Il connaît lui aussi l’herbe verte des pelouses. Il ressent lui aussi le tremblement du monde. Il éprouve lui aussi la cartographie de son enfance. Il sait même se penser lui-même en train de le faire. Il est loin d’être « coupé du monde » ou « sectionné de soi ».
La banlieue a ses problèmes et ses plaintes, elle a ses endroits indignes et ses grandes détresses qu’il convient d’écouter et de résoudre mais pour autant, qu’on ne dénie pas, jamais, à aucun être humain, ni la capacité à contempler, ni la capacité à penser, ni la densité de ses émotions. Qu’on ne hiérarchise jamais l’âme humaine. Puisse ce travail contribuer à la reprise du partage.