Le polar
Soirée du 27 janvier à la Bibliothèque Georges Brassens de Chelles.
Ça me rappelait la radio de mon enfance, avant l’entrée massive de la télévision dans les foyers… À l’époque où ils parlaient poliment et distinctement : « Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous prions d’écouter ce soir une causerie du professeur Machin… »
À l’opposé de la conférence où l’on imagine tout de suite la salle Pleyel, ses draperies cramoisies, son public guindé… et souvent clairsemé, la causerie implique quelque chose d’intime, de chaleureux, le coin du feu, si possible un petit verre de cognac…
Vérification faite auprès de Robert (je parle du dictionnaire), la causerie se définit comme une « conférence sans prétention ».
Ce qui, en fin de compte, me va très bien.
En effet, je n’ai pas la prétention de vous expliquer des chose inoubliables, encore moins de vous asséner des vérités. Tout ce que je vais vous raconter ce soir est subjectif et contestable.
Je ne suis ni historien, ni journaliste, je n’ai pas de formation universitaire, mais il se trouve que j’ai écrit quelques bouquins, ce qui me vaut d’être ce soir devant vous. En bonne compagnie, puisque Sylvie Granotier et Jean-Hugues Oppel ont bien voulu participer à cette soirée, qu’ils en soient remerciés.
Ceci étant, j’ai sévèrement flippé. Qu’est-ce que j’allais pouvoir vous raconter sur le polar ?...
Dans le doute, j’ai ouvert la Bible.
Le premier texte littéraire connu, ou peu s’en faut.
Les hommes sont sur terre depuis une seule génération et déjà on a déjà commis le premier meurtre. C’est la fameuse histoire de Caïn et Abel.
Je vous la rappelle en deux mots : Caïn et Abel sont frères, Abel élève des moutons, Caïn, lui, semble s’être tourné vers l’agriculture. Ils sacrifient à Dieu, c’est la coutume. Et là, catastrophe : le fumet du mouton grillé au charbon de bois monte agréablement aux narines de Dieu, alors que le pauvre Caïn qui a disposé quelques légumes sur une pierre plate fait un bide sévère, je suis navré de le dire. Dieu a préféré le sacrifice d’Abel et ne se prive pas de le faire savoir. Fureur et frustration de Caïn qui assomme son frère à coups de pierre, un peu plus tard.
Dieu l’a vu, évidemment. Il voit tout. On s’imagine qu’il va foudroyer le meurtrier mais non, pas du tout ! Il condamne Caïn à fuir. Ce dernier fonde une famille, une ville etc. Au final, il s’en sort plutôt bien, l’assassin. Il n’y a que Victor Hugo qui lui ait concocté une punition affreuse. Rappelez vous : « L’œil était dans la tombe… »
Du point de vue d’un lecteur de polar averti, évidemment, c’est un peu court. On sait tout de suite qui est le coupable, c’est décevant.
On imagine ce qu’Agatha Christie aurait pu faire de cette histoire : après qu’Hercule Poirot ait découvert le pauvre Abel baignant dans son sang à l’occasion d’une promenade digestive, il aurait réuni Adam, Eve, Dieu et Caïn à l’heure du thé dans le jardin d’Eden pour dire : « J’ai la certitude que le coupable est l’un de vous quatre ! Je vous donnerai son nom dans une quinzaine de pages… Mais auparavant, permettez-moi de résumer les faits... »
Reste que l’histoire est frustrante : on comprend mal ce meurtre. La jalousie de Caïn envers son frère comme unique motif ? On n’y croit pas beaucoup.
Alors je me suis souvenu de ce vieil adage tant prisé des détectives anglais en gabardine et chapeau mou, prononcé avec l’accent : « Cherchez la femme ! »
La femme, je l’ai trouvée… dans le Coran. Sourates 5/25 à 5/31. Le Coran présente les faits d’une manière très différente, et, je dois dire, nettement plus convaincante : Eve faisait les enfants par paires. Il y a donc des sœurs jumelles promises à Kabil et Habil (Caën et Abel). Problème : Caën voulait l’autre sœur, pas celle qu’on lui a attribuée. La moche, probablement… Il est furieux, il tue son frère. Logique.
Mais l’histoire, dans le Coran, ne s’arrête pas là. Caïn ne sait pas quoi faire du cadavre… Il le trimballe sur son dos, il est malheureux. Alors Dieu envoie un corbeau. C’est en l’observant creuser le sol de son bec que Kabil a enfin l’idée d’enterrer le cadavre de Habil pour le dissimuler aux regards. Voilà une histoire qui a inspiré plus d’un auteur de polar. Et comment ne pas penser ici à une certaine scène de Miller’s Crossing des Frères Cohen…
Après cette édifiante plongée dans les textes sacrés, je me suis mis en quête d’une définition, pensant que des gens bardés de ces diplômes que je ne possède pas allaient avoir des choses à dire sur le sujet…
Madame Anne Pambrun écrit : « Un récit rationnel dont le ressort dramatique est un crime vrai, ou supposé ». Oui…
Monsieur Régis Messac : « Un crime mystérieux graduellement éclairé par les raisonnements et les recherches d’un policier ». Pourquoi pas…
Jusqu’ici, ça va encore. Mais le pire est à venir…
3 extraits d’une thèse de doctorat sur le polar (il y en a) :
« (...)L’instance réceptrice représente la pièce maîtresse dans le dispositif textuel policier ; notre réflexion s’inscrit donc dans le cadre de l’esthétique de la réception, laquelle repose, comme nous le savons, sur la notion d’ ’horizon d’attente’ ».
« Dans les polars, c’est sans doute le personnage du coupable qui exerce le plus de fascination sur le lecteur. Le criminel représente en effet une figure fantomatique, absente, certes, de l’arène textuelle, en ce sens que c’est son silence qui permet au dire policier de se profiler en syntagme textuel, mais toujours présente à travers les indices (mégot, vêtements, arme, lettre, etc.) qu’elle lègue sur la scène du meurtre ou ailleurs. »
« Sur le plan purement diégétique, la dialectique de présence-absence est au cœur même du dispositif textuel policier. »
Ailleurs, sur un blog que je n’aurai pas la cruauté de citer, je trouve ceci :
« Le roman policier est une forme de roman dont la trame est constituée par une enquête policière ou une enquête de détective privé.
Le genre policier comporte six invariants : le crime ou délit, le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire et l’enquête. »
Avis à ceux qui voudraient se lancer dans l’écriture d’un roman policier surtout, respectez bien ces consignes !
La perle suit :
« Il peut être un roman noir, on l’appellera alors polar. »
Et pour terminer en beauté :
« Si l’action est transposée au minimum un siècle en arrière, on pourra le qualifier raisonnablement de roman policier historique. »
Bien… Voyons maintenant ce que dit l’Encyclopedia Universalis :
« L’expression roman policier a toujours constitué une dénomination réductrice, et les multiples tentatives faites pour le définir ou le codifier n’ont jamais été satisfaisantes. Dès sa naissance, ce genre littéraire est vite devenu insaisissable parce que multiforme et indéfinissable globalement. Sa nouvelle appellation argotique, le polar, n’a pas davantage résolu le problème. Le polar, en effet, constitue un espace de créativité sans limite et il peut se décliner de diverses façons. Détection, suspense, étude de mœurs, noir, aventures, chronique sociale, politique-fiction, thriller, autant de types de récits différents qui, tous, peu ou prou se rattachent au tronc originel. Parfois, et de plus en plus souvent, le polar peut emprunter à plusieurs de ces sous-genres. Il lui arrive même aujourd’hui de s’acoquiner avec la science-fiction ou de flirter avec le roman historique. En fait, le polar n’a presque plus de frontières, car, au fil de sa chronologie, il s’est toujours trouvé des romanciers pour faire exploser les archétypes et explorer de nouvelles pistes. Un de leurs soucis premiers encore aujourd’hui dominant a été de dire le monde tel qu’il est et tel qu’il devient. En tentant de cerner le Mal, qu’il s’agisse du crime ou des pouvoirs visibles ou occultes qui manipulent la planète, le polar s’efforce de raconter l’homme, avec ses doutes, ses peurs, ses obsessions, ses angoisses et ses frustrations. »
Pas mal, l’encyclopédie.
Je vous ai cité la Bible, le Coran et l’Encyclopedia Universalis. Je vous épargnerai Œdipe qui est souvent donné comme le précurseur du genre… La recherche du père, l’énigme du Sphynx, l’inceste… Tous les ingrédients d’un polar bien noir !
En fait, on s’accorde assez volontiers pour dire que le roman policier est né, au dix-neuvième, avec la civilisation industrielle.
J’en profite pour vous rappeler que deux des monuments de la littérature française s’inspirent directement de « faits divers » : Le Rouge et le Noir et Madame Bovary . Stendhal a repris l’histoire de ce jeune homme trop doué et très orgueilleux qui a tiré sur son ancienne maîtresse (et patronne) dans une église… il colle de très près à la réalité. À l’époque, on ne risquait pas le procès en diffamation comme notre consœur Lalie Walker qui s’est retrouvée récemment en correctionnelle pour avoir situé l’action d’un de ses bouquins dans l’un des magasins du marché St Pierre…
Flaubert, auquel ses amis conseillaient d’écrire quelque chose de plus accessible – aujourd’hui on dirait sans doute de plus consensuel ! – que La tentation de Saint-Antoine , s’est inspiré d’une triste histoire survenue dans un village du nom de Ry… Amusant.
Dirait-on aujourd’hui que ces deux romans sont des polars ? Ce sont, en tout cas, des romans noirs.
Et s’il était besoin de rappeler que les cloisons ne sont pas étanches et que « le polar, à l’instar du Droit, mène à tout », Jean Vautrin, immortel auteur de « À bulletins rouges » et « Billy the kick » en Série Noire s’est tout de même chopé un Goncourt. Mes amis, nous ne sommes pas à l’abri !
Donc plutôt que de repasser dans des sillons déjà largement creusés par d’autres, et parfois très bien… Je vais donc vous parler des liens que j’ai pu entretenir et que j’entretiens toujours avec le polar.
Ce qui nous oblige à remonter très loin dans le temps, j’en suis désolé…
Au début, il y eut, je crois… Les aventures de Bob Morane. Je me souviens surtout de Bill Ballantine, l’ami écossais de Bob Morane, le costaud de service, avec ses poings « gros comme des têtes d’enfants ». Je pense que c’est depuis cette lecture que je m’efforce de faire la chasse aux clichés dans mes bouquins… Je n’ai jamais relu Bob Morane depuis mes huit ans, mais il me semble que c’était d’un racisme que je qualifierais de « réjouissant » au risque de vous choquer. Je veux dire par là que qualifier systématiquement les Asiatiques de fourbes et cruels me paraît plus ridicule que méchant… Je ne sais pas ce qu’ils avaient tous contre les Asiatiques dans les années 50, ça tenait peut-être au Viet-Nam qui était en train de nous échapper, mais on retrouve à peu près la même thématique dans Blake et Mortimer ( Le secret de l’espadon ), que je lisais également avec passion.
Moralité, et c’est rassurant : les lectures de l’enfance ne façonnent pas obligatoirement l’adulte à venir.
Mais très vite j’ai eu envie de nourritures plus épicées, d’alcools plus forts… J’ai d’abord découvert Le Saint de Leslie Charteris. Totalement démodé aujourd’hui, Le Saint ! Jolies voitures, jolies filles (jolies pépées comme on disait alors…) Le Saint (pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ses initiales : ST, Simon Templar), un charme fou, un culot d’enfer… De quoi faire rêver le petit garçon timide que j’étais… Le Saint est une sorte d’Arsène Lupin à l’anglaise, moins moral, plus sarcastique.
Arsène Lupin, parlons-en, justement. Une valeur incontournable de la littérature policière. Je vous assure qu’on ne voit plus Étretat de la même façon une fois qu’on a lu l’Aiguille creuse !… J’étais attaché à la Normandie où habitait une de mes grand-mères, j’y étais d’autant plus sensible… Dans Arsène Lupin, ce n’étaient plus les Asiatiques qui avaient le mauvais rôle, mais les Allemands… Lupin, le personnage, naît en 1905, ça explique…
Mais ces cocoricos et ces lupinades ont fini par me lasser un peu… C’est alors que j’ai découvert les aventures de Sherlock Holmes, sur la recommandation d’une bibliothécaire, grâces lui soient rendues. Je fréquentais alors – faute d’une bibliothèque municipale à distance raisonnable – une petite bibliothèque paroissiale qui n’était pas si mal que ça. C’était, il m’en souvient, au moment des vacances de Toussaint, et avant le réchauffement climatique, ce qui fait que le temps était froid et maussade… Il me fallait ma provision de livres pour passer ces quelques jours. Et là, le choc ! Je me retrouve à Londres, en plein brouillard, j’entends le trot de chevaux de fiacre sur les pavés, les sirènes de bateaux qui mugissent sur la Tamise, et bien au chaud dans l’appartement de Baker Street – une des rues les plus dépourvues de charme de Londres, au demeurant – il y a ce type formidable qui déchiffre les énigmes les plus complexes parfois sans même bouger de son canapé…
Rien à voir cependant avec Lupin, perpétuellement amoureux de créatures distinguées, et admirables. Holmes est avec les femmes d’une exquise politesse, mais il conserve une distance que je qualifierais de « prudente »… Celles qui viennent le consulter ont évidemment des problèmes, parfois des problèmes graves, Holmes, très chevaleresque, leur vient en aide. Mais c’est un homme qui ne mêle pas les affaires et le plaisir. Au contraire de Lupin qui s’enflamme facilement, Holmes ne nous laisse rien deviner de ses sentiments. À tel point que des exégètes ont suggéré la possibilité d’une relation homosexuelle entre Holmes et Watson. J’avoue qu’à dix ans, ça me passait largement au-dessus de la tête.
Mais les ambiances me sont restées à jamais et le couple Holmes-Watson est à mon avis l’une des créations littéraires les plus efficaces qu’on ait jamais lues.
Dans le genre anglais, j’ai un peu butiné la collection du « Masque », ces bouquins à couverture jaune : Agatha Christie et quelques autres vieilles dames anglaises, tricoteuses de crimes plus ou moins parfaits, dont j’ai oublié les noms. Pas vraiment ma tasse de thé… Je n’étais jamais assez finaud pour résoudre l’énigme avant la fin, comme certains prétendaient le faire, et ces relations de bon ton entre golf et parterre d’iris m’ont assez vite barbé…
Il y a eu, alors, la lecture accidentelle d’un J.H. Chase dans la Série Noire.
Le livre lui-même, noir avec ses caractères jaunes, avait déjà quelque chose de délicieusement transgressif. Je ne sais pas comment il était arrivé entre mes mains, mais j’ai tout de suite compris devine que je tenais là une littérature explosive qui allait me valoir la réprobation de mes parents et celle de mes professeurs !
Aujourd’hui, on peut rire de Chase (qui ne doit plus être beaucoup lu) et surtout de l’image de la femme qui y est présentée. Comme dans la chanson de Souchon (« Les Filles électriques »…), les métaphores sont toujours à 220 volts, le héros mâle ressent une secousse, des frissons, voire des picotements rien qu’en croisant le regard de la femme qui sera fatale, forcément fatale aurait pu dire Marguerite Duras.
Je cite :
« Son regard rencontra le mien : J’eus l’impression de recevoir une décharge électrique et je remarquai ensuite que sous son chemisier vert émeraude se dessinaient des formes à vous faire perdre la tête. »
« Ça vous est arrivé de tripoter un appareil électrique et de prendre le jus dans les pattes ? Naturellement. Vous connaissez la secousse que ça donne. On ne peut pas s’empêcher de sursauter. Ça vous tape dans les muscles et ça vous coupe la respiration. C’est l’effet que m’a fait cette femme-là. »
« Morgan avait prévu que l’apparition de la fille produirait un choc, mais ce qui l’intéressait, c’était la force de ce choc. (…) Kitson avait tout de l’homme qui vient de recevoir un coup de matraque sur l’occiput. Il regardait la fille comme le taureau torturé regarde le matador au moment de l’estocade… »
Saluons, au passage, la qualité des traductions…
Une petite dernière : « J’entendis alors un léger bruit derrière moi et sans la moindre raison, j’éprouvais une impression bizarre. La chair de poule m’envahit soudain l’échine et me fit dresser les cheveux sur la tête… »
Même de dos, voyez l’effet qu’elles font !
Mais il faut re-situer ça dans le contexte : pour le gamin pré-pubère que j’étais alors, c’était fascinant !
Il n’y a pas que ça, heureusement. Les romans de Chase fonctionnent comme des moteurs à explosion : une fois qu’il y a l’étincelle, provoquée par la femme fatale, tout s’enclenche dans une mécanique assez implacable et si j’ai ironisé sur un aspect de ces romans, certaines intrigues sont admirablement ficelées, qu’il s’agisse de se débarrasser discrètement d’un vieux mari devenu gênant, de braquer une chambre forte ou un fourgon blindé. Mais il y a toujours, chez Chase, le providentiel grain de sable. Providentiel parce qu’il préserve la morale et réduit à néant les efforts des protagonistes dans le crime. L’un de mes préférés est l’histoire de ce mari assassiné qu’on a fourré dans un grand congélateur avant de le déplacer vers une sépulture plus discrète. Plutôt bien joué. Mais l’appareil tombe en panne en pleine canicule…
Je passerai rapidement sur Ian Fleming et son James Bond 007, mieux qu’OSS 117… Du Bob Morane adultes.
Il y eut ensuite Simenon et son fameux commissaire Maigret… Là, plus que les intrigues pas forcément excitantes, ce sont les ambiances que j’ai goûtées. Je vous disais tout à l’heure qu’on ne voyait plus Étretat de la même façon après avoir lu Maurice Leblanc, je vous avouerai que je ne passe jamais Boulevard Richard Lenoir sans me dire : « Tiens, c’est là qu’habite le commissaire Maigret ! »
Simenon a un talent exceptionnel pour planter les décors, que ce soit dans le plat pays de ses origines, ou dans un Paris qui, aujourd’hui, a presque entièrement disparu. Je pense que ça tient à la précision de certains détails et à la manière de les agencer.
Dans le domaine de la bande dessinée, on retrouve quelque chose de Simenon chez Maurice Tillieux, Les aventures de Gil Jourdan, dont certaines sont de petits chefs d’œuvre. Il y a des ambiances de bistrot absolument inoubliables…
(Un extrait de Maigret , écrit en 1934. Censément le dernier de la série. Simenon, à la demande Gaston Gallimard en écrivit près de 80 après celui-là…) :


Arrive l’adolescence, où je délaisse complètement le polar. Je découvre la poésie et des romans aussi divers que L’écume des jours de Boris Vian, Au dessous du volcan de Malcolm Lowry, La faim de Knut Hamsun, ou Le festin nu de William Burroughs… pour n’en citer que quelques uns.
Un mot maintenant sur Aix-en-Provence ! Pas grand-chose à voir à le sujet de cette causerie. Sauf à citer Aix abrupto de Jean-Paul Demure, un bouquin qui explore avec talent l’envers du décor…
Dans une vie antérieure, j’ai vécu à Aix presque trois ans et j’y suis tombé sur la caverne d’Ali-Baba. Une petite librairie « d’occasions et d’échanges », située dans un passage pittoresque, à deux pas du fameux Palais de justice. Un local carré, tapissé de polars, du sol au plafond ! Un rêve ! C’est là que j’ai découvert ceux qui allaient devenir mes deux auteurs favoris : Donald Westlake et Elmore Leonard. Avec une petite préférence pour le premier. J’ai croisé Leonard une fois, au festival de Frontignan, je n’ai sorti que des banalités… Comme quoi… Westlake est mort et j’en suis bien triste. L’un et l’autre partagent un humour ravageur, une façon bien à eux de mettre en scène des crétins malfaisants pour Leonard, ou des idiots sympathiques pour Westlake. Il y a du Flaubert chez Elmore Leonard.
Auteur prolifique, Westlake, lui, écrit parfois dans un registre plus grave sous le pseudonyme de Richard Stark : il crée Parker, un héros imperturbable, efficace, implacable. Westlake possède même un troisième pseudo, Tucker Coe pour des romans situés entre ces deux extrêmes. En même temps les passerelles existent entre les deux œuvres, les collaborateurs que Parker est contraint de recruter pour ses coups sortent parfois de chez Westlake, et la précision des cambriolages chez Westlake doit pas mal à Richard Stark…
Je n’ai pas vu toutes les adaptations cinématographiques de l’un et de l’autre. Je trouve que Point Blank , Le point de non retour en français, de l’excellent John Boorman, est une réussite absolue au point qu’il est difficile, ensuite, de ne pas imaginer Parker sous les traits de Lee Marvin. Même chose pour Jackie Brown , de Tarantino ( Punch creole est le titre original) où le casting est parfait, l’esprit du livre sublimé. Difficile d’oublier De Niro dans un rôle de sombre crétin qui flingue une fille à bout touchant… parce qu’elle parle trop.
En revanche quand Costa-Gavras adapte Le couperet, ça ne marche pas. La transposition, d’un côté de l’Atlantique à l’autre, passe mal, et surtout, l’humour et la distance, eux, sont passés à la trappe au profit d’une fable sociale édifiante et vaguement indigeste.
(Un extrait de Westlake tiré Adios Shéhérazade , un livre dont le héros, auteur de romans porno à la chaîne, peine soudain à trouver l’inspiration.)
J’ai découvert là, dans cette étonnante librairie, d’autres excellents auteurs anglais ou américains : Dick Francis, Tony Kenrick, James Ellroy, Tony Hillerman, Charles Williams, Stuart Kaminski, David Goodis, Newton Thornburg, pour n’en citer que quelques-uns.
Les romans de Dick Francis se déroulent exclusivement dans l’univers du cheval et des courses, les ambiances sont merveilleusement rendues, les intrigues solides, les héros toujours différents, bref, c’est du bon boulot comme savent le faire les Anglais…
Hillerman, c’est le monde des Indiens, des Navajos en particulier, c’est merveilleusement dépaysant, si vous n’avez pas la chance de pouvoir partir vous balader en Arizona ou au Nouveau Mexique, prenez un bouquin de Hillerman et vous verrez passez les tumbleweeds, je vous le garantis…
Goodis, c’est un peu le Kafka du polar américain, des ambiances de rêves noirs, glauques et poisseuses à souhait…
Charles Williams, je l’aime surtout pour son délicieux Fantasia chez les ploucs, qui est un des romans plus drôles et les plus truculents que j’aie lus. À ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous conter une petite anecdote : il y a quelques années, à l’occasion de cette célébration d’automne intitulée « Lire en fête », je suis invité, en tant qu’ancien lauréat du « Prix polar SNCF », à venir lire Gare de l’Est. Le principe est simple : les lecteurs se relaient toute la nuit pour lire… J’écope du créneau 23 heures-23 heures 30, et je me retrouve dans un courant d’air glacial, à lire, précisément, un extrait de Fantasia chez les ploucs à un parterre de clodos plus ou moins avinés dont la plupart ronflent bruyamment. Jamais lecture ne fut moins drôle et plus humiliante pour le lecteur. Comme quoi, il n’est pas toujours judicieux de vouloir sortir le livre du cocon de la bibliothèque… J’espère que la lecture qui va suivre rencontrera un meilleur accueil !
(Un extrait de Charles Williams, Fantasia chez le ploucs. Le point de vue délicieusement naïf d’un petit garçon de huit ans en vacance chez son oncle Sagamore qui n’est pas vraiment un saint.)
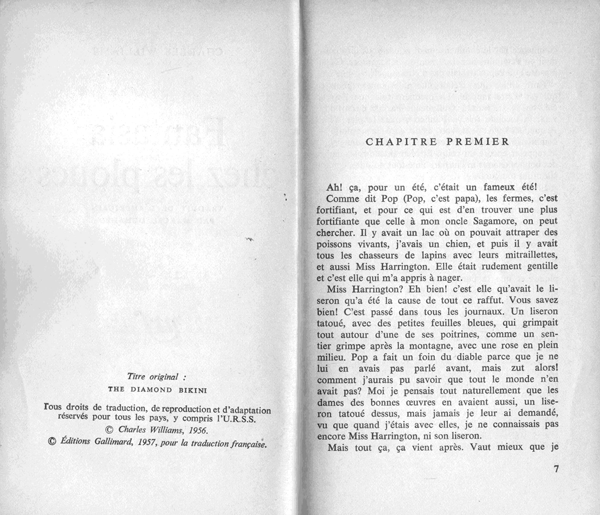
Passons à un auteur nettement moins drôle… James Ellroy. Est-il nécessaire de le présenter ? Si quelqu’un mérite le qualificatif de noir , c’est bien lui !
Thornburg est de ces auteurs qui se passionnent pour leurs personnages et dont les personnages nous hanteront à jamais. Il y a, entre autres, dans Fin de fiesta à Santa Barbara, Cutter, un ancien combattant du Viet-Nam qui ne vous laissera pas indifférent, formant avec Bone, cadre dévoyé, un duo improbable et attachant.
Quant à Kenrick, qui est australien, il s’inscrit plutôt dans la lignée de Westlake. Avec quelques superbes idées d’arnaques comme je les aime, mais que je ne puis vous révéler sans déflorer le bouquin…
Je terminerai ce bref tour d’horizon des auteurs anglo-américains par un petit mot sur la traduction : j’ai la chance de posséder l’anglais assez convenablement, ce qui fait que je lis ces auteurs dans leur langue quand c’est possible. (Ce qui explique pourquoi on ne vous a pas lu un extrait de Elmore Leonard, je n’en possède aucun en français)
Parfois je tombe sur des traductions qui me font dresser les cheveux sur la tête. Les pires sont celle où l’on peut rétablir directement l’anglais tant le travail a été bâclé.
Alors je vais sortir un peu de cadre de cette causerie pour vous citer un auteur que je vénère et qui pourtant n’a rien à voir avec le polar. Simon Leys.
Simon Leys nous dit en substance que bien traduire, c’est d’abord bien posséder sa propre langue… À la décharge des traducteurs, le fait qu’ils sont souvent mal rétribués, ce qui fait dire à Leys : le traducteur a le choix entre bousiller l’ouvrage ou mourir de faim…
On ne peut bien traduire que les livres dont on aurait souhaité être soi-même l’auteur.
Histoire de Lin Shu : sans connaître un seul mot d’aucune langue étrangère, Lin Shu a traduit près de 200 romans européens ! Il travaillait avec un ami qui lui, connaissait la langue étrangère. Lin Shu la transcrivait en chinois classique. C’est ce qui est arrivé avec La dame aux camélias. De ce roman plutôt moyen de Dumas fils, Lin Shu a fait un chef d’œuvre. Au point que lors de la visite d’une délégation française, le président Mao Tsé Toung a longuement évoqué ce monument de la littérature française : La dame aux camélias. Incompréhension des diplomates…
Simon Leys cite aussi le fameux roman de Steinbeck : Les raisins de la colère. Grapes of wrath en anglais. Pour ma part, j’avais toujours trouvé ce titre un peu bizarre. En fait, il a été imposé par une édition pirate belge. La traduction qui aurait convenu et que proposait Coindreau, était : Le Ciel en sa colère, car le mot « grapes » a, en anglais, une forte connotation biblique. Les Hauts de Hurlevent pour Wuthering heights est en revanche une trouvaille de génie. Et il est intéressant de savoir pourquoi God’s little acre de Caldwell a été traduit : Le petit arpent du bon Dieu. Parce que Le petit arpent de Dieu sonnait mal, et Arpent de Dieu ressemblait à un juron canadien ! Fin de la parenthèse.
Vous allez me dire : Et les Français dans tout ça ?… J’y arrive. S’il en est un que j’ai lu dans ma petite librairie d’Aix, c’est Francis Ryck. Un auteur assez prolifique et pour moi très intéressant qui a pratiquement sombré dans l’oubli vers la fin de sa vie. Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours eu l’impression qu’il avait été boudé par le milieu du polar, mais je n’en pas non plus la certitude. Il est mort, aujourd’hui, je ne l’ai jamais rencontré et je n’ai jamais rencontré personne qui l’ait rencontré.
Bin, finalement, je me suis un peu renseigné, et voici, en bref, ce que j’ai trouvé, sous la plume de Patricia Tourancheau de Libération :
Francis Ryck, 85 ans, vieil auteur original de la Série noire, finit dans la dèche et la désespérance.
Il a des parents « cinglés, alcoolos mais touchants », lui assureur, elle pianiste et chanteuse, « le grand amour et les coups, une histoire terrible de passion et de bataille ». Les Delville flambent puis manquent, oscillent entre le luxe et la misère, les huissiers et les saisies rue du Mont-Cenis, à Montmartre. Le fils unique, cancre et curieux, traîne avec ses copains russes émigrés, sèche les cours pour aller aux putes à Barbès, emmène les filles dans les bois, se fait virer à 16 ans du lycée Janson-de-Sailly.
En 1938, le voilà engagé dans la Marine ; « J’adorais la guerre, parce qu’on était des pirates. » Il sert pendant la campagne de Norvège en 1939-40 sur un torpilleur qui finit par couler. Prisonnier des Allemands, il simule la folie pour échapper aux camps, échoue à Saint-Servan dans un asile pour vieillards alcooliques. Il y tombe fou amoureux d’une belle religieuse irlandaise de 22 ans mais reste marqué au fer rouge par la violence en hôpital psychiatrique.
« C’est terrible de vieillir, ça devrait être défendu. », dit Ryck. Il en veut à ce « siècle d’une incroyable prétention » qui « prône la longévité » et laisse ses vieux dans la misère et rumine des idées aussi noires que ses romans.
Revenu à Paris en 1943, Yves Delville, son vrai nom, se marie, fait deux enfants, et commence à écrire sur tous ces marginaux qu’il a côtoyés. Il déteste le monde des gens normaux, des « petits-bourgeois étriqués » et du même coup l’univers de Simenon !
Ce nomade qui vagabonde en auto-stop d’Espagne en Inde, du Tibet à Ceylan met en scène des hippies, routards, néobouddhistes, agents dormants, à Ibiza aux Baléares ou dans un ashram en Provence. Il a nourri le cinéma français de sept de ses romans et publié une quarantaine de livre. Il a traité « d’employé de bureau » un chef de collection choisi par Antoine Gallimard. Un directeur littéraire l’a accusé de lui avoir fourgué « de vieux manuscrits ». Faux a répondu Ryck. « C’est moi qui suis vieux. Vous préférez publier des livres passables de jeunes signatures. » Patrick Raynal loue le talent de « ce dur à cuire » en ces termes : « Il a un caractère de cochon, vous lance des bordées d’insultes puis vous apporte un manuscrit qui dégage une émotion à vous couper le souffle.
De fait, Ryck est un sacré raconteur d’histoires et il a su, mieux qu’aucun autre, rendre l’atmosphère et l’esprit des années 70. Quand j’ai une petite bouffée de nostalgie, je m’y replonge. Dans ces mêmes années, l’espionnage était à la mode, grâce, peut-être à l’excellent John Le Carré, et Ryck a exploité le sujet d’une manière très personnelle. Un de ses meilleurs bouquins, sur le sujet, est Le secret qui a d’ailleurs été adapté au cinéma avec Trintignant, Noiret et Marlène Jobert (un film de Robert Enrico) dans les rôles principaux. Le secret, c’est l’histoire d’un type qui débarque chez un couple de hippies, au fin fond des Cévennes. Ils finissent par comprendre qu’il est recherché par toutes les polices. Mais est-ce un fou évadé d’un asile qui prétend détenir un secret, genre secret d’état, ou ceux qui le pourchassent aimeraient-ils le faire passer pour fou parce qu’il détient réellement un secret ?... On est dans cesse à se demander où est la vérité dans cette histoire, et les deux hippies passent par toutes les phases : empathie, méfiance, parano, détestation… C’est très angoissant, et très réussi. Un autre bouquin de Ryck qui a mes faveurs, c’est : Nos intentions sont pacifiques, porté lui aussi à l’écran d’ailleurs, avec Marielle, Lanvin et Dutronc. Un film de Gérard Pirès, en 1980, Herman, alias Vautrin, au scénario, Audiard aux dialogues. C’est à peine un polar, d’ailleurs, il ne s’y commet que de minces délits, mais l’ambiance de ces jeunes embarqués au fin fond des campagne pour vendre une encyclopédie médicale est drôle, triste et absurde.
Il serait injuste également de ne pas citer Simonin et Le Breton. Plus pour leur langue que pour leurs intrigues souvent minimalistes….
(Un extrait de Le cave se rebiffe )

J’ai donné un jour un texte de Simonin à traduire à une brochette d’apprentis scénaristes âgés de 20 à 30 ans. Il n’en ont pas compris un mot. L’argot de Simonin est en voie de disparition…
Une petite anecdote à propos de cinéma : vous aimez peut-être comme moi Le Cave se rebiffe, un film de Jacques Grangier avec Gabin, Blier, et le délicieux Maurice Biraud. Si vous lisez le livre, vous serez assez surpris : les adaptateurs n’ont en fait utilisé que le titre et un seul chapitre, qu’ils ont développé sur une heure et demi. Et c’était un bonne idée. Pour une fois, l’œuvre cinématographique est supérieure au roman dont elle est issue.
Pour paraphraser le célèbre « Enfin Malherbe vint » de Boileau, je dirais : « Enfin Manchette vint. » !
(Voici les premières pages du Petit bleu de la côte ouest )

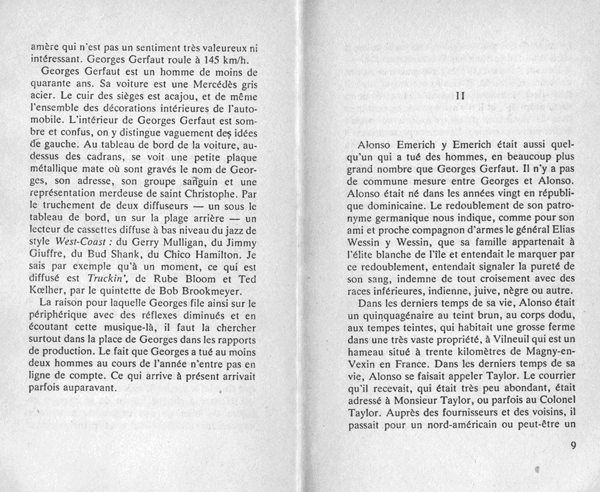
Comment ne pas craquer pour un auteur aussi particulier ?!
Toutefois, ce qui m’a frappé, chez Manchette, c’est la forme plus que le fond.
« Le bon roman noir est un roman social, un roman de critique sociale, qui prend pour anecdote des histoires de crimes », semble avoir écrit Manchette qui s’inscrit, d’après les spécialistes, dans le droit fil de l’œuvre de Dashiell Hammett.
Moi, il me semble qu’on enfonce là des portes ouvertes : écrire sur la société, c’est implicitement faire de la critique sociale, non ?
Il y a chez Manchette une sorte d’existentialisme désespéré qui m’a bien plu et qui en a influencé plus d’un : notre ami Oppel ne dira pas le contraire, lui qui fait joujou avec la « déposition du tireur couché » ou pire « l’imposition du cireur Touchet » !
Et pour ceux qui ont lu cet auteur délicieux qui n’est pas considéré comme un auteur de polar : Jean Echenoz. Lequel a tout de même raflé les prix Médicis et Goncourt… Quand je vous dis que le polar mène à tout !
(On écoute un extrait de Je m’en vais )

Les auteurs français de polar, je les ai découverts, et rencontrés, encore bien plus tard. Pouy, Raynal, Daeninckx, Tito Topin, ADG, Jonquet, à la fin des années 80, et plus tard encore, après que je me sois mis moi-même à écrire, Jean-Hugues Oppel, Sylvie Granotier, Dominique Manotti, Romain Slocombe, Maurice Attia, Dominique Sylvain, Chantal Pelletier, Caryl Ferey… J’en oublie sans doute. Qu’ils me pardonnent.
Au terme de cette longue énumération d’auteurs, deux questions se posent encore : pourquoi écrire des polars, et pourquoi si tard ?!
À la seconde question, je répondrai que, pendant longtemps, j’ai pensé être incapable d’écrire comme tous ces auteurs que j’admirais (ce qui, peut-être, reste vrai ?!) et puis ils avaient fait de si bons livres, pourquoi ne pas m’en contenter ?…
La tempête de 99 allait tout changer.
En quoi ?
Eh bien parce qu’en découvrant l’étendue des dégâts, l’idée d’un cambriolage m’est venue : plus d’électricité donc plus de systèmes d’alarme, des flics et des pompiers occupés ailleurs… pourquoi ne pas en profiter pour se faire la banque du coin ? Le plus amusant de l’histoire est que j’étais persuadé que quantité d’auteurs allaient avoir la même idée. Ce qui n’est pas été le cas. À peine un livre ou deux sur cet événement, et pas des polars.
Quelques difficultés pour entrer dans mon histoire, une centaine de pages détruites avant de trouver un ton qui me satisfasse… Ainsi est né Noël au balcon .
Alors pourquoi le genre polar ? Cette question, je la poserai également à mes deux invités dans un instant. Pour ma part, je pense que c’est avant tout la peur d’ennuyer mon lecteur. La nécessité d’une histoire trépidante, pleine de rebondissements, de surprises. En plus, se cacher derrière les aventures ou les mésaventures de personnages pittoresques est un excellent moyen pour ne pas parler de soi, L’anti Christine Angot, en somme !
En outre, je venais de passer les vingt dernières années à distraire mes contemporains par des séries ou des comédies légères ; écrire du polar n’était, finalement, pas vraiment changer de registre.
Je pense également que le polar a pour moi une fonction cathartique : si je n’avais pas écrit Barnum TV, j’aurais peut-être frappé un dirigeant de l’audiovisuel. Grâce à ce roman, j’ai pu en assassiner un certain nombre avec des raffinements de cruauté et conserver ainsi mon équilibre mental…
Le fait de jouer avec les codes, ceux du polar en l’occurrence, est rassurant pour l’auteur comme pour le lecteur d’ailleurs. Ce sont des garde-fous, c’est le filet pour l’équilibriste…
L’inconvénient de rencontres comme celles-ci est qu’elles vous amènent, précisément, à vous poser des questions, à vous remettre en question ! Envolée l’ingénuité et l’impétuosité des débuts ! ... Du coup, je suis allé explorer d’autre genres : le fantastique en jeunesse, la BD, version fantastique-gore également, des texte jeunesse, très mignons, qui mettent en scène de petits animaux, et je m’interroge sur ce que je vais écrire ensuite après avoir récemment osé un récit où personne ne meurt de mort violente, où personne ne meurt tout court d’ailleurs, mais où la loi est un peu malmenée, tout de même, je vous rassure !…
Il est vrai qu’en lisant le dernier William Boyd je me suis dit : Ah, ah, lui aussi a besoin d’un crime pour faire exister son roman ! En revanche David Lodge s’en passe très bien, de même que Paasilinna, deux autres de mes auteurs favoris…
Alors polar ou pas polar pour le prochain opus ? Telle sera la question !